Quoique grand adaptateur de romans à la scène, Guy Cassiers ne s’était jamais intéressé à Dostoïevski jusqu’ici. Il faisait exception parmi ses contemporains, et plus largement au sein de la longue et riche histoire des relations que la scène entretient avec les romans de Dostoïevski. En 1999, Cassiers avait adapté Anna Karénine de Tolstoï – comme Fernand Gémier, Georges Pittoëf ou Jean-Louis Barrault, qui avaient aussi préféré un russe au détriment de l’autre. Cassiers a néanmoins été amené à choisir un roman de Dostoïevski, pour fêter avec la Comédie-Française le bicentenaire de la naissance de l’auteur. Comme Ivo van Hove, Julie Deliquet ou Christophe Honoré récemment, le metteur en scène flamand en effet été invité à diriger la troupe. Le spectacle apparaît le fruit d’un concours de circonstances, voire d’une commande, plutôt qu’un véritable projet né du fin fond des entrailles de l’artiste. Cela explique peut-être pourquoi Cassiers, qui propose d’ordinaire un théâtre profondément littéraire et dramaturgique, manque complètement son coup avec cette adaptation.
 Avec ce spectacle, Les Démons entrent au répertoire de la Comédie-Française. Plusieurs œuvres de Dostoïevski y figuraient déjà : Crime et châtiment, adapté par Michel Vitold et Gabriel Arout en 1963, L’Idiot, par le même duo en 1975 et L’Éternel Mari, par Victor Haïm et Simon Eine en 1975. Parmi les « grandes » œuvres de Dostoïevski, ne manquera plus que Les Frères Karamazov, justement créés par Sylvain Creuzevault dans quelques jours au Théâtre de l’Odéon – Creuzevault qui a lui-même créé Les Démons en 2018, dernière adaptation en date de ce roman. C’est dans cette histoire dense qui ne cesse de s’écrire que Cassiers prend sa place, en s’emparant du roman le plus directement politique de Dostoïevski. Les Démons décrit – entre autres – les actions d’un groupuscule révolutionnaire dans une petite ville de province russe. Avec Mefisto for ever, Les Belles endormies, Bloed & Rozen, Les Bienveillantes et deux pièces de Shakespeare, Cassiers s’était efforcé de poser les questions du mal et du pouvoir en les mettant en regard avec l’histoire récente de l’Europe. Il semble que ce soient les mêmes questions qu’il souhaite à nouveau aborder avec les personnages de Dostoïevski. Si elles sont bien soulevées dans le roman, ce prisme de lecture ne lui permet pas de s’en emparer pleinement.
Avec ce spectacle, Les Démons entrent au répertoire de la Comédie-Française. Plusieurs œuvres de Dostoïevski y figuraient déjà : Crime et châtiment, adapté par Michel Vitold et Gabriel Arout en 1963, L’Idiot, par le même duo en 1975 et L’Éternel Mari, par Victor Haïm et Simon Eine en 1975. Parmi les « grandes » œuvres de Dostoïevski, ne manquera plus que Les Frères Karamazov, justement créés par Sylvain Creuzevault dans quelques jours au Théâtre de l’Odéon – Creuzevault qui a lui-même créé Les Démons en 2018, dernière adaptation en date de ce roman. C’est dans cette histoire dense qui ne cesse de s’écrire que Cassiers prend sa place, en s’emparant du roman le plus directement politique de Dostoïevski. Les Démons décrit – entre autres – les actions d’un groupuscule révolutionnaire dans une petite ville de province russe. Avec Mefisto for ever, Les Belles endormies, Bloed & Rozen, Les Bienveillantes et deux pièces de Shakespeare, Cassiers s’était efforcé de poser les questions du mal et du pouvoir en les mettant en regard avec l’histoire récente de l’Europe. Il semble que ce soient les mêmes questions qu’il souhaite à nouveau aborder avec les personnages de Dostoïevski. Si elles sont bien soulevées dans le roman, ce prisme de lecture ne lui permet pas de s’en emparer pleinement.
Contrairement à ses contemporains et une partie de ses prédécesseurs, Cassiers n’adapte pas lui-même l’œuvre de Dostoïevski. Il a fait appel à un auteur, qui est aussi adaptateur, Erwin Mortier, qui a écrit une pièce de théâtre à partir du roman, au point de faire disparaître toute trace romanesque, de lisser toutes les aspérités qu’implique l’opération d’adaptation. Des scènes dramatiques s’enchaînent donc, plus ou moins fermement liées entre elles, du retour de Dacha d’Europe, et du projet de mariage qu’imagine pour elle Varvara Petrovna avec son ancien tuteur, Stépan Verkhovenski, jusqu’à l’avalanche de catastrophes finales : l’incendie du faubourg, la mort des Lébiadkine, celle de Lisa, le suicide Stavroguine, etc. De nombreuses scènes mènent d’une borne narrative à l’autre, mais pour suivre une trajectoire aussi linéaire que possible, l’adaptateur a considérablement simplifié le roman : exit Kirilov – personnage de penseur et suicidaire que Camus, qui a adapté le même roman en 1959, a rendu célèbre par plusieurs de ses écrits, et par ailleurs rouage important de la conspiration de Piotr, qui n’est ici pas même évoqué ; exit Lébiadkine, le capitaine ivre frère de Maria, exit Fedka le bagnard, exit l’évêque Tikhone à qui se confie Stavroguine – pièce maîtresse du roman frappée par la censure au moment de sa publication ; exit Maria Chatov, simplement mentionnée… et de manière plus problématique encore, sont évacuées des scènes déterminantes dans la (non) compréhension du personnage de Stavroguine, telles que ses frasques ou son duel.
 Ces suppressions ne s’expliquent pas par un réaxage particulier du roman, sur une intrigue ou un personnage au détriment d’autres – à l’exemple de Nemirovitch-Dantchenko en 1913, qui proposait une adaptation de la même œuvre intitulée « Nicolas Stavroguine ». Cassiers et son adaptateur conservent les trois personnages principaux du roman : Stépan Verkhovenski, le révolutionnaire idéaliste représentant de la génération de 1820 ; Piotr Verkhovenski, son fils, nihiliste qui a renoncé à tout idéal au nom de la destruction pure ; et Nicolas Stavroguine, être cynique qui éprouve ses sentiments par de multiples crimes, dans l’espoir de comprendre d’après quelles valeurs mener sa vie. Tous trois se retrouvent donc dans cette adaptation, pour représenter le mal sous plusieurs de ses formes, mais le metteur en scène et l’adaptateur sabrent leurs trajectoires. Piotr est le moins entamé, représenté par ses manigances, les réunions qu’il anime avec ses conjurés, ses supplications à Stavroguine. Stépan, en revanche, fait entendre ses discours du salon de Varvara à la fête de la gouverneure, mais sa mort est éludée. Stavroguine, le personnage principal du roman, est quant à lui réduit à son ombre… Il n’est pas même attendu avant sa première apparition, et aussitôt ramené à une figure de séducteur invétéré, dont le cynisme n’a rien de bien terrifiant et dont le dégoût de la vie n’a rien d’énigmatique. De troublant (mais à peine), ne reste que son rire vaguement fou… L’interprétation de ce personnage par Christophe Montenez ne réussit pas à étoffer ce personnage, alors qu’il endossait le rôle de Martin von Essenbeck dans Les Damnés d’Ivo van Hove en 2016. Or, ce personnage de Luchino Visconti est profondément inspiré par Stavroguine. Martin dérangeait vraiment par son comportement sur scène, et il était même terrifiant lorsqu’il partait à la poursuite d’une enfant dans les couloirs du Palais des Papes – scène mémorable. Le Stavroguine de Cassiers n’a pas souillé d’enfant et il n’a pas causé le suicide d’une petite fille. À la fin du spectacle, les différentes figures du mal se superposent – littéralement grâce à la vidéo –, mais leur superposition qui évoque le monstre cerbère ne suffit pas à faire frémir… Le mal dont il est question reste abstrait, les costumes et décors déployés avec force détails ancrent dans la Russie du XIXe siècle, et le langage vulgaire de Piotr ne suffit pas à donner de la perspective à la réflexion de Dostoïevski.
Ces suppressions ne s’expliquent pas par un réaxage particulier du roman, sur une intrigue ou un personnage au détriment d’autres – à l’exemple de Nemirovitch-Dantchenko en 1913, qui proposait une adaptation de la même œuvre intitulée « Nicolas Stavroguine ». Cassiers et son adaptateur conservent les trois personnages principaux du roman : Stépan Verkhovenski, le révolutionnaire idéaliste représentant de la génération de 1820 ; Piotr Verkhovenski, son fils, nihiliste qui a renoncé à tout idéal au nom de la destruction pure ; et Nicolas Stavroguine, être cynique qui éprouve ses sentiments par de multiples crimes, dans l’espoir de comprendre d’après quelles valeurs mener sa vie. Tous trois se retrouvent donc dans cette adaptation, pour représenter le mal sous plusieurs de ses formes, mais le metteur en scène et l’adaptateur sabrent leurs trajectoires. Piotr est le moins entamé, représenté par ses manigances, les réunions qu’il anime avec ses conjurés, ses supplications à Stavroguine. Stépan, en revanche, fait entendre ses discours du salon de Varvara à la fête de la gouverneure, mais sa mort est éludée. Stavroguine, le personnage principal du roman, est quant à lui réduit à son ombre… Il n’est pas même attendu avant sa première apparition, et aussitôt ramené à une figure de séducteur invétéré, dont le cynisme n’a rien de bien terrifiant et dont le dégoût de la vie n’a rien d’énigmatique. De troublant (mais à peine), ne reste que son rire vaguement fou… L’interprétation de ce personnage par Christophe Montenez ne réussit pas à étoffer ce personnage, alors qu’il endossait le rôle de Martin von Essenbeck dans Les Damnés d’Ivo van Hove en 2016. Or, ce personnage de Luchino Visconti est profondément inspiré par Stavroguine. Martin dérangeait vraiment par son comportement sur scène, et il était même terrifiant lorsqu’il partait à la poursuite d’une enfant dans les couloirs du Palais des Papes – scène mémorable. Le Stavroguine de Cassiers n’a pas souillé d’enfant et il n’a pas causé le suicide d’une petite fille. À la fin du spectacle, les différentes figures du mal se superposent – littéralement grâce à la vidéo –, mais leur superposition qui évoque le monstre cerbère ne suffit pas à faire frémir… Le mal dont il est question reste abstrait, les costumes et décors déployés avec force détails ancrent dans la Russie du XIXe siècle, et le langage vulgaire de Piotr ne suffit pas à donner de la perspective à la réflexion de Dostoïevski.
Avant cette vision finale supposée constituer le clou du spectacle, Cassiers souhaite donner à voir une société qui sombre dans la destruction. Leurs costumes qui laissent croire qu’un grand couturier s’est mêlé de ce spectacle disent cette décadence : ils sont extrêmement sophistiqués, mais tous tachés. À eux seuls ils sont représentatifs de cette mise en scène, qui interpelle constamment le regard mais ne dit pas grand-chose… Pour mettre en valeur la façon dont cette société se soucie d’elle-même sans jamais prendre l’autre en considération, Cassiers, comme à son habitude, déploie un système de captation en direct extrêmement pointu. Trois écrans surplombent la scène, en outre cernée par d’autres sur lesquels différents décors sont projetés : décor d’un salon, d’une pauvre maison ou d’une grande verrière comparable à celle du Grand Palais (le Crystal Palace de Londres). Grâce à des caméras fixes invisibles, les acteurs apparaissent en gros plan sur les écrans supérieurs. Pour que l’image triptyque soit harmonieuse, de nombreuses distorsions sont nécessaires au plateau. Les acteurs en viennent à se tourner le dos, ou à jouer suivant des coordonnées opposées : quand, à l’image, ils se rapprochent, sur scène, ils s’éloignent. Les interactions sont ainsi sérieusement entamées, et la médiation de démons tout en noir, simplement revêtus de manches pour assurer le raccord, est nécessaire pour esquisser des gestes. La virtuosité visuelle est incontestable, mais le jeu y perd considérablement. Et paradoxalement, l’effet de zoom que permet l’entremise de la caméra éloigne des acteurs, qui paraissent isolés sur le plateau, inaccessible. Cassiers dit vouloir qu’ils soient leurs propres metteurs en scène à l’écran, qu’ils soient eux-mêmes les éditeurs du film projeté. Cette responsabilité immense qui leur incombe les prive de leurs personnages et d’eux-mêmes. Elle situe Cassiers exactement aux antipodes de Frank Castorf, autre grand adaptateur de Dostoïevski qui a joué un rôle déterminant dans l’usage de caméras sur scène il y a près de vingt ans. Alors que lui met ses acteurs dans des situations extrêmes pour les pousser à exprimer des états tout aussi extrêmes, dont il décuple la puissance par la captation en direct, Cassiers oblige à la retenue et au calcul.
 Quand la médiation de l’écran disparaît et laisse enfin place aux acteurs, avec la première réunion des conjurés, le spectateur peut enfin arrêter de décrypter les ressorts ultra sophistiqués du film créé en temps réel pour se concentrer sur ce qui se passe sur scène. Les acteurs de la Comédie-Française, qui peuvent à nouveau se regarder, s’interpeler, tout simplement jouer, se révèlent bien plus à leur aise dans cette nouvelle configuration de la scène. Cela ne suffit cependant pas pour que le spectacle prenne. Les personnages restent esquissés et les intrigues simplifiées. Manque l’essentiel du roman : son tourbillon narratif, son abondance, l’espèce de folie qui s’emparent des personnages – ce débordement impalpable que Sylvain Creuzevault plaçait au cœur de son adaptation, et que Camus, à une autre époque, s’efforçait de reproduire par de multiples moyens. Il paraît symptomatique que la figure du narrateur ait disparu, alors qu’il joue un rôle déterminant dans cette impression de débordement narratif. Ce qui reste ici des Démons, c’est une pièce de théâtre à la fois simple et un peu compliquée. Dacha, « sœur d’Ivan Chatov » et « protégée de Varvara Stavroguine », est aussi désignée comme « amoureuse de Nikolaï Stavroguine » dans le programme de salle. Cette formule est également représentative de la simplification extrême du roman. La compassion infinie du personnage se trouve ramenée à un sentiment d’amour banal. Plus encore, Cassiers définit la polyphonie comme le fait que, dans le roman, « chaque voix a sa propre ligne distincte des autres ». La notion que Mikhaïl Bakhtine a forgée à partir des œuvres de Dostoïevski, qui a ensuite été multiplement réutilisée, cherche à exprimer le fait que de multiples points de vue coexistent dans ces œuvres, mais assortie à celle de dialogisme, elle met également en évidence le fait que chaque discours est poreux, traversé par la voix de tous les autres personnages.
Quand la médiation de l’écran disparaît et laisse enfin place aux acteurs, avec la première réunion des conjurés, le spectateur peut enfin arrêter de décrypter les ressorts ultra sophistiqués du film créé en temps réel pour se concentrer sur ce qui se passe sur scène. Les acteurs de la Comédie-Française, qui peuvent à nouveau se regarder, s’interpeler, tout simplement jouer, se révèlent bien plus à leur aise dans cette nouvelle configuration de la scène. Cela ne suffit cependant pas pour que le spectacle prenne. Les personnages restent esquissés et les intrigues simplifiées. Manque l’essentiel du roman : son tourbillon narratif, son abondance, l’espèce de folie qui s’emparent des personnages – ce débordement impalpable que Sylvain Creuzevault plaçait au cœur de son adaptation, et que Camus, à une autre époque, s’efforçait de reproduire par de multiples moyens. Il paraît symptomatique que la figure du narrateur ait disparu, alors qu’il joue un rôle déterminant dans cette impression de débordement narratif. Ce qui reste ici des Démons, c’est une pièce de théâtre à la fois simple et un peu compliquée. Dacha, « sœur d’Ivan Chatov » et « protégée de Varvara Stavroguine », est aussi désignée comme « amoureuse de Nikolaï Stavroguine » dans le programme de salle. Cette formule est également représentative de la simplification extrême du roman. La compassion infinie du personnage se trouve ramenée à un sentiment d’amour banal. Plus encore, Cassiers définit la polyphonie comme le fait que, dans le roman, « chaque voix a sa propre ligne distincte des autres ». La notion que Mikhaïl Bakhtine a forgée à partir des œuvres de Dostoïevski, qui a ensuite été multiplement réutilisée, cherche à exprimer le fait que de multiples points de vue coexistent dans ces œuvres, mais assortie à celle de dialogisme, elle met également en évidence le fait que chaque discours est poreux, traversé par la voix de tous les autres personnages.
La virtuosité visuelle ne suffit pas à compenser cette simplification flagrante de l’œuvre adaptée. Dès les premières secondes, le public tombe dans un piège tendu par Cassiers : un ensemble de cordes se lève avant de commencer à jouer, et les spectateurs applaudissent. Leur présence n’est pourtant pas évidente, au loin, derrière une espèce de toile, et il semble qu’il y ait un problème d’échelle, qu’ils soient trop petits à cette distance – impression confirmée par l’information dans le programme de salle qu’il s’agit d’une projection vidéo. Ce piège, comme beaucoup des effets ménagés sur scène, reste impénétrable, immotivable du point de vue dramaturgique. Cassiers dit vouloir faire passer de l’illusion de la représentation médiée par la vidéo à la présence authentique des acteurs sur scène. Le problème est que l’illusion n’a jamais cours, que les coulisses sont d’emblée visibles et que le caractère faux des interactions des personnages est évident – d’une évidence qui ne stimule pas le sens.
 Quelques belles visions surgissent, notamment celle de Lisa (Jennifer Decker) traversant le faubourg en flammes avant de s’effondrer au sol. Elles ne suffisent cependant pas à contrebalancer le fait que tout ce dispositif prive du plaisir du jeu, de voir les personnages de Dostoïevski incarnés sur scène, de voir par exemple Dominique Blanc, qui paraît tout indiquée pour le rôle de Varvara Pétrovna, jouer les grandes duègnes, de percevoir sa folie, son hystérie. Tous paraissent extrêmement raisonnables, jusqu’à Maria Lébiadkine (Suliane Brahim), l’authentique folle, la seule à pouvoir mettre en échec la folie volontaire de Stavroguine. De Lisa Touchine seule émane quelque chose d’électrique, une intensité qui évoque l’énergie déréglée qui traverse tout le roman. Pour le reste, le jeu et la mise en scène lissent la matière romanesque, la domptent jusqu’à l’assécher. Si l’on perçoit bien que c’est un discours sur le mal qui est en jeu, au-delà du roman qui l’inspire, il n’est pas évident de le reconstituer. Ivo van Hove, avec Les Damnés, avec des moyens similaires et la même troupe d’acteur, tapait beaucoup plus fort pour exprimer la perte des valeurs et le chaos. Ici, la sophistication esthétique l’emporte – alors que ces moyens ont auparavant révélé leur puissance dramaturgique. Est-ce Dostoïevski qui ne convenait pas à Cassiers ? son ampleur opposée à la concentration narrative d’Au cœur des ténèbres de Conrad qu’il a adapté par le passé ? sa polyphonie qui déstabilise profondément la subjectivité que Cassiers avait sondée dans cette œuvre comme dans Sous le volcan de Lowry ? Probablement tout cela à la fois. Ce qui est certain, c’est que la rencontre de ce metteur en scène avec cet auteur n’a pas lieu, à notre plus grand regret.
Quelques belles visions surgissent, notamment celle de Lisa (Jennifer Decker) traversant le faubourg en flammes avant de s’effondrer au sol. Elles ne suffisent cependant pas à contrebalancer le fait que tout ce dispositif prive du plaisir du jeu, de voir les personnages de Dostoïevski incarnés sur scène, de voir par exemple Dominique Blanc, qui paraît tout indiquée pour le rôle de Varvara Pétrovna, jouer les grandes duègnes, de percevoir sa folie, son hystérie. Tous paraissent extrêmement raisonnables, jusqu’à Maria Lébiadkine (Suliane Brahim), l’authentique folle, la seule à pouvoir mettre en échec la folie volontaire de Stavroguine. De Lisa Touchine seule émane quelque chose d’électrique, une intensité qui évoque l’énergie déréglée qui traverse tout le roman. Pour le reste, le jeu et la mise en scène lissent la matière romanesque, la domptent jusqu’à l’assécher. Si l’on perçoit bien que c’est un discours sur le mal qui est en jeu, au-delà du roman qui l’inspire, il n’est pas évident de le reconstituer. Ivo van Hove, avec Les Damnés, avec des moyens similaires et la même troupe d’acteur, tapait beaucoup plus fort pour exprimer la perte des valeurs et le chaos. Ici, la sophistication esthétique l’emporte – alors que ces moyens ont auparavant révélé leur puissance dramaturgique. Est-ce Dostoïevski qui ne convenait pas à Cassiers ? son ampleur opposée à la concentration narrative d’Au cœur des ténèbres de Conrad qu’il a adapté par le passé ? sa polyphonie qui déstabilise profondément la subjectivité que Cassiers avait sondée dans cette œuvre comme dans Sous le volcan de Lowry ? Probablement tout cela à la fois. Ce qui est certain, c’est que la rencontre de ce metteur en scène avec cet auteur n’a pas lieu, à notre plus grand regret.
F.
Pour en savoir plus sur « Les Démons », rendez-vous sur le site de la Comédie-Française.
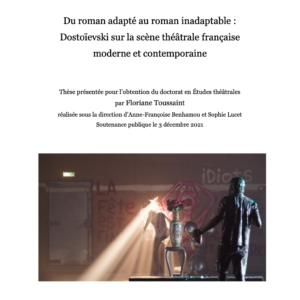









Tout à fait d’accord. Merci pour cette critique