Article paru dans la revue Fabula-LhT, n°19,
Les Conditions du théâtre : le théâtralisable et le théâtralisé, dir. Romain Bionda, en ligne, 2017.
Dostoïevski est fait pour la scène. Non seulement il est fait pour la scène, mais Dostoïevski a toute sa vie voulu écrire pour la scène. Il ne l’a jamais fait, pour une raison toute simple, c’est qu’il n’y avait pas de concordance possible, à l’époque, entre l’état du théâtre, ce qui s’écrivait au théâtre de son vivant, et lui[1].
André Markowicz, traducteur de l’intégralité de l’œuvre de Dostoïevski chez Actes Sud depuis les années 1990, formule dans ces propos une inadéquation entre les aspirations de l’auteur russe et le théâtre de son époque, tout en affirmant de façon catégorique une compatibilité de ses romans avec « la scène ». Le nombre important d’adaptations de Crime et châtiment, des Frères Karamazov, des Démons ou de L’Idiot — pour ne citer que ses œuvres majeures — qui ponctuent la vie théâtrale du xxe siècle jusqu’à nos jours, paraît soutenir son point de vue[2].
Cette compatibilité avec la scène illustrée par plus d’un siècle de théâtre, reste encore à en définir la nature. Markowicz la fonde sur les qualités dramatiques de ses romans qui en font selon lui des « poèmes en action[3] ». Avant lui, dès le début du xxe siècle, Dmitri Merejkowski qualifie les œuvres de Dostoïevski de « roman-tragédies[4] » — expression ravivée à sa suite par Viatcheslav Ivanov. Depuis, la critique n’a cessé de mobiliser le modèle théâtral pour penser son art. Le point de départ de cette intuition est l’importance des dialogues dans le cours de la narration, vers lesquels l’ensemble de l’œuvre paraît converger au point de prendre l’apparence d’une suite de scènes-crises. Même Bakhtine qui prête un soin particulier à distinguer ce qu’il nomme le dialogisme du dialogue théâtral invoque le théâtre pour cerner certains aspects de sa poétique. Il écrit en effet de façon éloquente :
Dans la vision artistique de Dostoïevski, la catégorie essentielle n’est pas le devenir mais la coexistence et l’interaction. Il voyait et pensait son monde principalement dans l’espace et non pas dans le temps. D’où son penchant prononcé pour la forme dramatique. Il essayait d’organiser en une unité temporelle, sous forme d’un rapprochement dramatique, et de développer extensivement tous les matériaux interprétatifs, tous les éléments de la réalité auxquels il avait accès.[5]
Jacques Catteau, qui a consacré ses recherches aux modes de création chez Dostoïevski[6], va plus loin encore : il envisage dans ses romans l’espace comme un décor du fait de sa description minimale, et les incises des dialogues comme des didascalies qui indiqueraient les éclairages, les intonations, les gestes et les entrées en scène des personnages. Une véritable tension de l’œuvre de Dostoïevski vers le genre dramatique est ainsi mise en valeur, qui semble pouvoir prendre la forme d’un potentiel théâtral sollicitant l’adaptation et invitant à surmonter la résistance de ses romans à la scène — en effet éprouvée par leur ampleur, par l’enchevêtrement de plusieurs intrigues, par le nombre conséquent de personnages qu’ils rassemblent ou encore par les multiples lieux de l’action.
Quoiqu’elle soit encore souvent invoquée par les metteurs en scène pour justifier leur démarche, cette approche poétique semble insuffisante pour expliquer la régularité remarquable des adaptations des romans de Dostoïevski à la scène sur plus d’un siècle. Pour la comprendre, il semble pertinent de dépasser la notion d’adaptable – par laquelle on entend une simple adéquation avec la scène, selon des critères qui changent avec le temps[7] –, en mobilisant celle de « théâtralisable » : parce que le théâtralisable cherche à penser les objets qui intéressent le théâtre même s’ils ne sont pas complètement compatibles avec lui – ou pour cette raison précisément –, qui paraissent appropriables dans une certaine mesure seulement, et encore parce que cette adéquation est mise en rapport avec une représentation du théâtre — théâtre qui par ailleurs évolue, tant du point de vue de ses conventions que de ses aspirations. La mobilité des critères — de l’objet que l’on s’approprie, des conditions dans lesquelles on se l’approprie, des différents degrés d’appropriation, et des attentes liées à cette appropriation par rapport au théâtre —, semble en effet pouvoir permettre de penser les rapports pluriels de Dostoïevski à la scène.
Pour démontrer le caractère chaque fois différent de ce qui semble théâtralisable chez Dostoïevski d’un artiste à l’autre, on s’appuiera sur les exemples de trois adaptations de trois de ses romans, par trois metteurs en scène français à trois époques différentes, et selon trois conceptions du théâtre : la pièce de Jacques Copeau, Les Frères Karamazov, en 1911 ; l’adaptation d’Albert Camus des Possédés, en 1959, et le spectacle de Vincent Macaigne d’après L’Idiot, en 2009. Malgré les cinquante ans qui se sont écoulés entre leurs deux spectacles, une certaine continuité lie les démarches de Copeau et Camus. En revanche, si la même durée sépare V. Macaigne de Camus, l’écart de l’un à l’autre est qualitativement plus grand. V. Macaigne hérite en effet des entreprises décisives de Bertolt Brecht et de Heiner Müller dans l’Allemagne de la deuxième moitié du xxe siècle, qui renouvellent la réflexion sur le théâtre et amènent – avec d’autres – Hans-Thies Lehmann à fonder la notion de postdramatique pour tenter de cerner certaines tendances du théâtre contemporain[8].
Prenant en compte ce bond historique, il s’agira de questionner d’un metteur en scène à l’autre les désirs de théâtre suscités par les œuvres de Dostoïevski et d’envisager par les processus de théâtralisation mis en place les représentations du théâtre impliquées. La réflexion sera chronologique, ce qui permettra de tisser progressivement des liens entre les spectacles, de poser des termes de comparaison, ainsi que de suivre les évolutions parallèles du théâtre et de la pratique de l’adaptation mises en jeu.
Copeau et Les Frères Karamazov : repenser le jeu théâtral avec les personnages de Dostoïevski
Lorsqu’en octobre 1907 Copeau pense à adapter les Frères Karamazov de Dostoïevski, il ne s’est pas encore distingué ni comme auteur dramatique, ni comme metteur en scène. Son rapport au théâtre est alors celui d’un spectateur et d’un critique, déjà préoccupé par la qualité et l’avenir de cet art. Pour l’homme de lettres qui exprime dans ses articles la nécessité de réformer le théâtre de son temps, cette adaptation créée en avril 1911[9] représente donc une première expérience qui a valeur de manifeste.
Rénover le théâtre par l’adaptation d’un roman, alors même que Copeau dénonce l’emprise trop grande de la littérature sur cet art, la démarche paraît a priori paradoxale[10]. Pour justifier son entreprise, Copeau invoque le caractère adaptable des œuvres de Dostoïevski, et plus particulièrement des Frères Karamazov, accordant ainsi son désir de théâtre à celui qu’il perçoit dans l’œuvre de Dostoïevski. Dans sa démarche, le théâtralisable — compris ici comme ce qui suscite un désir d’adaptation —, se confondrait donc avec l’adaptable, simple adéquation d’ordre formel. Néanmoins, Copeau se repose finalement peu sur ce potentiel dramatique de l’œuvre, et la refonte totale à laquelle il procède invite à penser que son intérêt pour le roman se trouve ailleurs.
Dans le programme du spectacle distribué lors de sa reprise au Théâtre du Vieux-Colombier en 1914, Copeau affirme : « Tel fut […] notre point de départ : la valeur dramatique en soi de l’œuvre de Dostoïevski et, tout particulièrement, des Frères Karamazov[11] ». Plusieurs éléments ont pu l’amener à faire de ce caractère adaptable du roman de Dostoïevski la raison déclarée de son projet de théâtralisation.
Tout d’abord, la lecture de l’œuvre alors récemment traduite de Dmitri Merejkowski, Tolstoï et Dostoïevski, qu’il cite lui-même dans le programme du spectacle. Il a en effet pu y trouver une première invitation à l’adaptation théâtrale quand il lisait que « les œuvres principales de Dostoïewsky ne sont, en réalité, ni des romans, ni des épopées, mais des tragédies[12] ». Pour soutenir cette affirmation, Merejkowski met en valeur le caractère agonique des personnages, en lutte permanente avec eux-mêmes, et souligne l’importance des dialogues, qui apparentent le roman à un scénario. Copeau fait sienne cette analyse et en reprend les éléments dans le programme du spectacle :
Non seulement y abondent incidents et péripéties sous une forme directe et qui touche les sens, mais encore toute manifestation psychologique s’y présente en action. En lisant ces romans, on y assiste. Les personnages s’y analysent, s’y expriment uniquement par le dialogue. A tel point que le texte non dialogué fait souvent penser à des indications scéniques intercalées entre les répliques[13].
Avec une telle comparaison entre la poétique de Dostoïevski et les codes dramatiques, Merejkowski légitimait une entreprise d’adaptation théâtrale des Frères Karamazov.
Avant cela, Copeau avait déjà pu avoir entrevoir le potentiel dramatique de l’œuvre à la lecture des traductions qu’il avait à sa disposition[14]. Celle d’Halpérine-Kaminsky et Morice en particulier — par laquelle Copeau a découvert le roman — multiplie les amputations et les manipulations, allant même jusqu’à l’invention[15], ceci pour soulager le public français des longues descriptions et des nombreuses digressions du roman et pour le faire davantage correspondre à son goût. Plus qu’une traduction, les traducteurs proposaient finalement une première forme d’adaptation, qui rapprochait encore l’œuvre du genre dramatique.
Selon un certain théâtre — le théâtre réaliste de l’époque, hérité du xixe siècle qui s’emparait volontiers de romans —, le caractère adaptable des Frères Karamazov ainsi mis en valeur peut suffire à susciter un désir d’adaptation. La démarche vise dans ce cas à transformer le roman en une pièce de théâtre qui, mise en scène, pourrait donner vie aux personnages. André Gide, qui a été un interlocuteur privilégié de Copeau tout au long de son travail, rend compte d’une telle approche quand il écrit dans Le Figaro quelques jours avant la première des Frères Karamazov au Théâtre des Arts que le défi à relever tient selon lui à la question de l’interprétation des personnages :
Il s’agit de savoir, aujourd’hui qu’on les porte sur le théâtre (et de toutes les créations de l’imagination et de tous les héros de l’histoire, il n’en est point qui méritent davantage d’y monter), il s’agit de savoir si nous reconnaîtrions leurs voix déconcertantes à travers les intonations concertées des acteurs[16].
Cependant, s’il y fait référence, Gide ne s’en tient pas à cette conception de l’adaptation, comme simple incarnation de personnages romanesques par des comédiens, sur une scène de théâtre. Il suggère en effet que ceux de Dostoïevski ne sont pas n’importe lesquels, qu’ils « méritent » plus que tout autre de monter sur scène, et qu’en outre leurs voix sont « déconcertantes ». Ces formulations laissent entrevoir une appréhension particulière des personnages de Dostoïevski, que Gide approfondit quelques années plus tard, dans une série d’articles et de conférences[17]. De ses analyses, il dégage notamment la notion désormais positive de « complexité ». Elle tient selon lui à l’intrication dans ses romans de l’idée — jamais définitive —, du personnage — irréductible à un quelconque type ou symbole, et au caractère qui plus est instable — et du réel — donné à voir dans sa confusion. A cela s’ajoute encore l’opinion que Dostoïevski, mieux que tout autre avant lui, saisit à travers eux la vie-même[18] — raison pour laquelle ces êtres, que Gide considère comme vivants dès la lecture, méritent selon lui plus que d’autres de monter sur scène.
Copeau est sensible à ces réflexions que Gide partage avec lui depuis plusieurs années déjà, et il tente à son tour de formuler ce qui fait selon lui la singularité des personnages de Dostoïevski et de leurs relations à l’occasion d’une recension pour La Nouvelle Revue Française d’une étude d’André Suarès sur Dostoïevski :
Je sens qu’ils vivent sur les confins, sur les limites les uns des autres. Et c’est ainsi qu’ils s’aiment ou se haïssent, s’attirent ou se menacent de si près, si dangereusement. C’est ainsi que se propagent, parmi eux, de si soudaines, de si foudroyantes contagions. On dirait que chacun, étant trop plein de sa substance et de sa flamme, les laisse déborder[19].
Dans le dégagement de cette proximité qui oscille entre la complicité et la rivalité, qui fait basculer d’une attitude à l’autre, Copeau entrevoit une psychologie d’un autre type que celle logique et causale qui domine alors en littérature, et plus encore sur la scène de théâtre de son temps. Cette conception nouvelle du personnage, parce qu’elle ouvre d’autres possibilités de jeu théâtral, est peut-être ce qui paraît théâtralisable à Copeau. De fait, lorsqu’en 1913 il entreprend une régénération complète du théâtre avec l’ouverture du Théâtre du Vieux-Colombier, pour combattre « l’esprit de cabotinage et de spéculation[20] » qui selon lui dominent alors cet art, il place au cœur de son projet réforme la question du jeu du comédien. Les Frères Karamazov de Dostoïevski constituerait ainsi le point de départ de ses recherches.
L’enjeu de l’adaptation serait dès lors pour Copeau d’y réinvestir cette psychologie nouvelle. Par là peut s’expliquer le fait qu’il ait refusé de se contenter de procéder à « de simples découpures pratiquées au vif du texte original et présentées sans lien, sur un plan unique[21] », et qu’il ait au contraire entrepris de donner au roman « la forme précise, un peu étroite, presque géométrique que nous imposons ordinairement à nos drames[22] ». Cette forme qui caractérise le drame selon lui s’apparente à celle du théâtre classique : des douze livres du roman de Dostoïevski et de ses quelques mille pages, il écrit une pièce composée de 5 actes et de 44 scènes. De même, Copeau se soumet en partie à la règle des unités[23]. Un tel respect de ces contraintes dramatiques paraît manifester le désir d’ordonner la matière romanesque, d’en dynamiser la narration, d’en reproduire les effets, mais plus encore une volonté de créer des scènes et de recomposer des situations capables de donner à percevoir la complexité des personnages et de leurs relations. Elle transparaît tout particulièrement dans la confrontation d’Ivan et de Smerdiakov à l’acte V, qui mieux qu’aucune autre paraît illustrer l’analyse de Copeau citée précédemment en donnant à percevoir l’infra-langage qui sous-tend le dialogue des deux personnages, qui tantôt se confondent, tantôt se dissocient violemment. L’importance que Copeau accorde au choix des comédiens[24], ainsi que le réglage minutieux de leurs déplacements et de leurs gestes prennent également sens dans cette perspective.
Si les différentes déclarations de Copeau sur son désir d’adapter Les Frères Karamazov mettent bien en valeur la tension dans laquelle il est pris entre le théâtre de son temps et ses aspirations encore latentes pour rénover cet art, il apparaît finalement qu’il pense cette rénovation à partir de Dostoïevski, qui apparaît comme un levier de transformation possible. L’importance de ce premier spectacle et l’influence durable de Dostoïevski sur la réflexion de Copeau, on peut encore en prendre la mesure avec ces lignes au vocabulaire significatif qu’il écrit quelques années plus tard, sur la relation que doit avoir un comédien à son personnage :
Vous dites d’un comédien qu’il entre dans un rôle, qu’il se met dans la peau d’un personnage. Il me semble que cela n’est pas exact. C’est le personnage qui s’approche du comédien, qui lui demande tout ce dont il a besoin pour exister à ses dépens, et qui peu à peu le remplace dans sa peau. Le comédien s’applique à lui laisser le champ libre.
Il ne suffit pas de bien voir un personnage, ni de le bien comprendre, pour être apte à le devenir. Il ne suffit même pas de le bien posséder pour lui donner la vie. Il faut en être possédé[25].

Camus et Les Possédés : rénover le tragique par les questionnements philosophiques
1938, Alger. Albert Camus reprend au Théâtre de l’Équipe qu’il a fondé l’adaptation de Copeau, Les Frères Karamazov, dans laquelle il interprète le rôle d’Ivan. A ce sujet il confie : « Je l’ai aimé par-dessus tout, je le jouais peut-être mal, mais il me semblait le comprendre parfaitement. Je m’exprimais directement en le jouant[26] ». Plus encore qu’au personnage tel qu’adapté par Copeau, il est probable que Camus se réfère directement à l’Ivan du texte de Dostoïevski pour interpréter ce rôle.
Les réflexions d’Ivan irriguent en effet largement le dialogue que Camus entretient avec Dostoïevski dans chacune de ses œuvres, un dialogue au long cours qui prend fin avec Les Possédés[27]. Les figures d’Ivan, de Stavroguine ou de Kirilov et les réflexions qu’ils portent ayant déjà nourri toute sa création, pourquoi Camus en vient-il à une adaptation en 1959 ? Qu’est-ce qui lui paraît théâtralisable dans Les Démons, le roman le plus idéologique de Dostoïevski, celui que son auteur désignait lui-même comme un pamphlet ?
Lors d’un entretien pour la revue Spectacles, Camus se souvient : « J’ai rencontré l’œuvre de Dostoïevski à vingt ans et l’ébranlement que j’en ai reçu dure encore, après vingt autres années[28] ». Aussitôt après cette déclaration, il cite en particulier Les Possédés, qu’il place aux côtés de L’Odyssée, Guerre et Paix, Don Quichotte et le théâtre de Shakespeare. Camus formule là la genèse d’une connivence profonde de sa pensée avec celle de Dostoïevski, une connivence qui se déploie dans presque toutes ses œuvres et qui est couronnée par son adaptation des Démons.
Dès Caligula, en 1938, Camus s’inscrit dans le sillage de la réflexion de Dostoïevski et pousse au plus loin la logique du « tout est permis » formulée par Ivan dans Les Frères Karamazov. Par la suite, les conséquences d’une telle affirmation sont encore discutées dans La Peste ou Les Justes. Outre ses œuvres dramatiques et romanesques, Camus se réfère encore aux personnages de Dostoïevski dans ses essais. Dans L’Homme révolté en particulier, il convoque Ivan pour illustrer un aspect de la révolte métaphysique et les personnages des Démons pour la partie qu’il consacre à la révolte historique[29]. Selon Peter Dunwoodie, qui a étudié les différentes formes prises par cette relation[30], si le dialogue est si soutenu, c’est que Camus trouve dans les romans de Dostoïevski de quoi nourrir sa réflexion sur l’absence de Dieu, l’absurde, le suicide, la révolte, le meurtre, la justice, la souffrance ou encore le désarroi moral — autant de questions posées dans Les Démons.
Mais si Camus en vient cette fois à adapter le roman à la scène, poussant au plus loin son dialogue avec lui, c’est peut-être plus encore car l’actualité philosophique et politique de la pensée de Dostoïevski dans ses romans est de celles dont Camus et certains de ses contemporains veulent nourrir le théâtre de leur temps. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, une partie des intellectuels affirme en effet la nécessité de faire du théâtre un art engagé. Il s’agit pour eux de donner à voir sur scène le drame de l’homme moderne, en prise avec les questions de son époque.
Une telle préoccupation transparaît chez Camus au cours d’un entretien à l’occasion de son adaptation, lorsqu’il dit :
On a longtemps cru que Marx était le prophète du xxe siècle. On sait maintenant que la prophétie a fait long feu. Et nous découvrons que le vrai prophète était Dostoïevski. Il a prophétisé le règne des grands inquisiteurs et le triomphe de la puissance sur la justice[31].
Ce qui est à ses yeux théâtralisable dans Les Démons, il semble ainsi que ce soient les idées formulées par Dostoïevski, et plus particulièrement la thèse du roman, qu’il dégage en ces termes : « les mêmes chemins qui mènent l’individu au crime mènent la société à la révolution[32] ». Parce que le roman illustre le nihilisme et pose la question du mal — sous deux de ses formes, le mal ontologique et métaphysique avec Stavroguine, et le mal empirique et historique avec Verkhovensky —, le spectateur des Possédés était ainsi invité à assister à la pièce en prenant la mesure des discours qu’elle faisait entendre à l’aune des révolutions et des dictatures de son époque.
Néanmoins, cette affinité avec la pensée de Dostoïevski, qu’il considère comme actuelle et qu’il a pu vouloir transposer sur scène de façon encore plus explicite que précédemment, paraît insuffisante pour expliquer sa démarche. Deux assertions de Camus mènent sur une autre voie. D’une part, lorsqu’il écrit dans le programme du Théâtre Antoine où est présenté le spectacle : « Il y a près de vingt ans […] que je vois ses personnages sur la scène » ; de l’autre, lorsqu’il affirme au cours d’une émission télévisée : « ces Possédés […] résument ce qu’actuellement je sais et je crois du théâtre[33] ». Ces propos amènent à envisager cette adaptation au-delà du dialogue philosophique des deux auteurs, dans une perspective proprement théâtrale.
Dans le Mythe de Sisyphe, Camus écrit :
Tous les héros de Dostoïevski s’interrogent sur le sens de la vie. C’est en cela qu’ils sont modernes, ils ne craignent pas le ridicule. Ce qui distingue la sensibilité moderne de la sensibilité classique, c’est que celle-ci se nourrit de problèmes moraux et celle-là de problèmes métaphysiques. Dans les romans de Dostoïevski, la question est posée avec une telle intensité qu’elle ne peut engager que des solutions extrêmes. L’existence est mensongère ou elle est éternelle. Si Dostoïevski se contentait de cet examen, il serait philosophe. Mais il illustre les conséquences que ces jeux de l’esprit peuvent avoir dans une vie d’homme et c’est en cela qu’il est artiste[34].
Ce que Camus dit ici admirer chez Dostoïevski, c’est la façon dont il déplace la question du mal hors du champ de la morale, et plus encore la manière qu’il a d’incarner des réflexions métaphysiques dans des personnages qui poussent leur raisonnement au plus loin. C’est selon lui ce qui fait la valeur de son art.
Or cette capacité qu’a Dostoïevski de rendre caduque l’opposition entre la philosophie et le roman lui semble particulièrement exemplaire. En transposant son roman à la scène, Camus veut de la même manière mêler philosophie et théâtre, car cela lui semble être le moyen de rénover le tragique. Montrer le caractère passionnel que peuvent avoir les idées, donner à voir le spectacle de déchirements métaphysiques sous une forme non pas abstraite, mais personnifiée : tel est l’idéal qu’il veut atteindre. L’enjeu de l’adaptation de Camus est donc de transposer les débats existentiels des personnages sur scène et d’en faire la matière même de la pièce – comme il a déjà tenté de le faire dans Caligula ou Les Justes.
Du roman de Dostoïevski, il retient ainsi en particulier les postures des personnages et leurs affrontements, telles que le nihilisme de Piotr Verkhovensky, le sentiment de l’absurde de Kirilov ou le discours slavophile de Chatov. Mais plus encore que ceux-là, le véritable héros tragique moderne est pour Camus Stavroguine, hanté par l’absurde et la conviction que « tout est permis », mais incapable d’assumer cette posture, avide qu’il est d’amour et de foi. Il offre selon lui un exemple d’« homme contradictoire, déchiré, désormais conscient de l’ambiguïté de l’homme et de son histoire », celui que Camus désigne comme « l’homme tragique par excellence[35] ». Dès lors, afin de faire de « l’énigme de Stavroguine, le secret de Stavroguine » — qui constitue selon lui « le thème unique des Possédés[36] » — le cœur de son adaptation, le centre de gravité de sa pièce il rétablit la confession du personnage, écartée par la censure au moment de la publication du roman.
Dans cette entreprise de résurrection du tragique dans le théâtre moderne, il est intéressant de constater que Camus dissocie le tragique de la tragédie[37]. S’il se montre sensible aux qualités dramatiques du roman[38], il n’a pas recours au modèle classique pour le transposer à la scène, comme l’a fait Copeau. Il opte plutôt pour une dramaturgie hybride capable de prendre en charge la dimension épique de l’œuvre-source — avant tout soucieux comme il l’est de rendre compte des débats des personnages. A la succession de scènes organisées en acte, il préfère donc une répartition de la matière romanesque en parties et tableaux, dont l’enchaînement est assuré par les interventions régulières d’un narrateur qui comblent les ellipses temporelles qui les séparent et fluidifient le passage d’un lieu à un autre. Mettant en jeu jusqu’à l’unité de ton, Camus affirme qu’il a tenté de suivre « le mouvement profond du livre et d’aller comme lui de la comédie satirique au drame puis à la tragédie[39] », mouvement qu’il redouble à la scène par une scénographie de plus en plus abstraite, de moins en moins « enracinée dans la matière »[40].
Les Possédés gagnent finalement la faveur du public, plus encore que n’importe quel autre spectacle de Camus, alors même que certaines de ses pièces soulevaient des problématiques proches. Certains critiques vont jusqu’à généraliser le phénomène et affirment que ses contemporains appréciaient plus ses adaptations que ses pièces, comme si en adaptant — et tout particulièrement Dostoïevski — Camus s’octroyait une liberté plus grande, dans la réécriture comme dans la mise en scène ; une liberté plus apte à servir son projet théâtral.

Macaigne et L’Idiot : éprouver le théâtre dans toutes ses dimensions avec Dostoïevski
Le spectateur venu voir la dernière création de Vincent Macaigne, Idiot ![41], est à son arrivée au théâtre pris d’assaut par le spectacle. Dès le hall d’entrée, il est en effet accueilli par une diffusion à haut volume de la chanson populaire Sarà Perché ti amo, à laquelle se superposent les cris d’un comédien au mégaphone qui invite le public à former une farandole pour fêter l’anniversaire de sa fille chérie. L’apparent désordre ne prend pas fin une fois entré en salle, où une ambiance de discothèque est créée par une musique composite encore plus forte, des lumières déjà tamisées, des nuages de fumées, et les sollicitations du même comédien qui, jouant les chauffeurs de salle, encourage le public à venir se servir un verre de bière sur la scène, et à danser et crier avec lui.
Cette entrée en matière peut paraître de prime abord en décalage complet avec le projet annoncé d’un spectacle « d’après L’Idiot de Fiodor Dostoïevski ». Néanmoins, l’impression ne dure qu’un moment, et cette approche se montre finalement capable de transporter au cœur des questions soulevées par le roman. Elle est le fruit d’un dialogue profond de V. Macaigne avec Dostoïevski, d’une proximité que le metteur en scène commente lui-même, se disant autant sensible au discours élaboré dans l’œuvre, notamment sur la figure de l’idiot, qu’à sa forme épique, ou à ce qu’il nomme sa « rage ». Autant de pistes à suivre pour comprendre ce que V. Macaigne envisage de théâtralisable dans le roman, de façon apparemment plurielle.
Contrairement à Copeau et Camus, V. Macaigne ne pose à aucun moment la question du caractère adaptable du roman qu’il choisit. Héritier de toute une tradition postmoderne, son théâtre ne s’embarrasse pas de distinctions génériques. Qu’il s’empare d’un roman ou d’une pièce, V. Macaigne procède de la même façon[42] : il s’agit pour lui de réécrire le texte afin de construire à partir de lui un discours sur le monde contemporain. L’adaptation, dans ce cas, est prise au sens large de mise au diapason de l’œuvre avec les préoccupations de son temps.
Macaigne dit ainsi s’intéresser à L’Idiot car Dostoïevski y aurait prédit la dérive contemporaine. Selon lui, l’auteur décrit dans cette œuvre « l’avènement de la société moderne, avec l’arrivée du crédit, du capitalisme, de la machine à vapeur » et il ajoute que « cette nouveauté suscite une sorte d’effroi » chez Dostoïevski[43]. Un effroi que l’histoire a justifié pour V. Macaigne, près d’un siècle et demi plus tard, à l’heure où les modèles économiques érigés au début du xxe siècle paraissent épuisés, l’idéologie du progrès éprouvée, et l’espoir condamné au point d’avoir laissé place à un cynisme destructeur. Le parallèle entre la Russie de la fin du xixe et la France du xxe siècle l’invite à faire sien le chant du cygne de Dostoïevski, et à affirmer que dans le roman comme dans le monde contemporain, « il y a l’idée que ce que l’on a construit est en train de couler, la sensation que ce pour quoi on s’est battu est en train d’être détruit », prenant alors les exemples de la sécurité sociale ou du théâtre public pour appuyer son rapprochement[44]. Parce que V. Macaigne considère le théâtre comme un moyen de saisir le monde contemporain, de tenir un discours sur lui, et que Dostoïevski parlerait de ce monde, son œuvre lui paraît donc théâtralisable.
La réécriture du roman à laquelle il procède est soutenue par cette intuition et vise ainsi à montrer « comment cela résonne […] par rapport au monde dans lequel nous vivons[45] ». Son intérêt pour l’œuvre se porte alors moins sur l’enchaînement des événements dans une intrigue resserrée — qui ont paru adaptables à plus d’un metteur en scène avant lui —, que sur les discours auxquelles les situations créées donnent lieu. Une partie de son travail a donc consisté à mettre en valeur certaines voix qui débattent sur la marche du monde, en particulier sur ses évolutions politiques et économiques, ainsi que leurs implications sociales. Il prend ainsi largement appui sur l’échange d’Evgueni Pavlovitch et du prince Mychkine en présence de toute leur société au début du livre 3, et en distille les éléments dans les prises de parole de plusieurs personnages.
Plus encore, dans le cours de la réécriture du roman, Macaigne insère des références directes au monde contemporain. Cependant, il est nécessaire de préciser que même quand il prend ses distances avec L’Idiot, Macaigne ne vise pas à « actualiser » le texte de Dostoïevski. Il ne s’agit pas de transplanter ses personnages dans le xxie siècle. Sa démarche vise plutôt à mettre en écoute le roman depuis notre réalité, et donc à jouer de la superposition entre les époques. Cette pratique le place dans la lignée de Brecht, qui encourage à un nouvel usage des classiques, dont il faut selon lui « mettre en lumière [le] contenu idéologique formel[46] » pour les mettre au service de la société.
Cet effet palimpseste est particulièrement sensible dans le brassage de références hétéroclites sur scène. Après la mise en condition du spectateur que l’on a évoquée, la perspective de Macaigne sur le roman est mise en évidence par la présence d’éléments contemporains sur le plateau, tels un ballon Mickey gonflé à l’hélium ou des distributeurs de boissons ornés de publicités lumineuses. La citation la plus explicite empruntée à notre époque prend la forme d’un extrait d’un discours de Nicolas Sarkozy — remplacé en 2014 par un extrait du débat qui l’opposait à François Hollande lors de la campagne présidentielle.
Néanmoins, V. Macaigne ne choisit pas simplement L’Idiot pour les discours qu’il contient et qui peuvent aider à penser notre monde. Son spectacle manifeste une attirance véritable pour cette œuvre, qu’il cherche à traduire dans un langage qui lui est propre. Or, l’originalité de son geste réside dans le fait que c’est précisément à partir de cette œuvre qu’il repense le théâtre dans son ensemble, que c’est en s’appuyant constamment sur elle qu’il remet en jeu cet art dans toutes ses dimensions — de l’écriture à la perception du spectateur, de l’esthétique scénique au jeu — pour mieux rendre compte de sa lecture de l’œuvre.
Cette mise à l’épreuve du théâtre dans ses conventions les plus primaires a pu transparaître dans la description que l’on a faite du début d’Idiot ! D’emblée, le rapport entre les comédiens et les spectateurs est en effet ébranlé par le débordement du spectacle jusque dans le hall du théâtre — voire dans la rue —, et ce dérangement se poursuit bien au-delà de cette entrée en matière dans le cours du spectacle.
Mais avant cela, dès la réécriture du roman, Macaigne entreprend de se débarrasser de toute convention, alors romanesque. En effet, les suppressions qu’il pratique mettent de côté de façon symptomatique les épisodes en apparence les plus adaptables du roman. Ainsi il se passe non seulement de la rencontre du prince Mychkine et de Rogojine dans un train, qui remplit la fonction de situation initiale en liant le destin des deux personnages, mais plus encore du dénouement paroxystique qui les rassemble autour du corps assassiné de Nastassia — scène en fonction de laquelle Dostoïevski dit avoir écrit tout le roman, et dont la suppression a pour effet de modifier la trajectoire des trois personnages et de placer encore davantage l’accent sur la figure de l’idiot. De la même façon, Macaigne dilue dans sa réécriture la concentration temporelle du roman, notamment du livre 1, comme s’il voulait là aussi se passer de ce qui pourrait paraître trop ficelé et cherchait au contraire à introduire du désordre dans l’œuvre de Dostoïevski déjà dense. Dans sa note d’intention, il annonce : « L’enjeu n’est pas de “résumer” L’Idiot, mais de rendre [sur scène] sa force épique et littéraire, son mouvement, sa profusion[47] ». Et de fait, ce qui reste finalement du roman, c’est le déploiement d’une matière complexe, digressive, longue, qui semble capable de reproduire chez le spectateur une impression de lecture « dostoïevskienne ».
Au-delà des idées portées par les personnage et la prise en charge de la part épique de l’œuvre sur scène — dimensions qui rapprocheraient sa démarche de celle de Camus —, V. Macaigne cherche ainsi à théâtraliser jusqu’au plus impalpable de l’œuvre : son ton, son énergie, sa « pulsation vitale » comme le formule Michel Corvin[48]. Il dit vouloir « créer une œuvre scénique qui parte de la rage de Dostoïevski[49] », « faire du plateau le lieu de [leur] lecture de L’Idiot, de la puissance et de la violence de sa fable[50] ». Rage, folie, démesure… autant de termes par lesquels il tente d’approcher ce à quoi il est sensible dans le roman, et qu’il tente de réinvestir sur scène.
L’importance qu’il accorde au motif de la souillure dans son spectacle, tant dans la réécriture du texte que par certains gestes des comédiens, paraît dès lors significative. Elle est à l’origine de tout un lexique scénique, composé des matières dont les corps sont enduits tout au long du spectacle : l’huile, la mousse, l’eau, la peinture, les paillettes, le faux sang, la terre… Ce lexique est chargé de rendre compte de la violence des rapports des personnages, en particulier à l’encontre du prince Mychkine et de Nastassia Philippovna. Le caractère presque littéral et primitif de cette représentation de la souillure semble en outre pouvoir révéler le ferment mythique que V. Macaigne dit trouver dans l’œuvre de Dostoïevski.
Aux lynchages s’ajoutent encore les gifles, les coups et les chutes, ainsi qu’un mode de profération exacerbé. Tout au long du spectacle, les comédiens chargent en effet chaque mot d’une force physique et d’une puissance sonore qui cherche encore à rendre compte de la rage et de la violence que perçoit V. Macaigne dans l’œuvre, en rendant palpable la détresse des personnages, et en donnant l’impression qu’ils jouent leur vie à chaque instant. Mais le cri n’interdit pas la nuance, et d’abord car il se déploie au cours de longues tirades. De fait, Macaigne a transformé les dialogues du roman — dominants dans la poétique de Dostoïevski, au point d’avoir pu être à l’origine d’un désir de théâtre chez plusieurs adaptateurs — en longues répliques, mettant ainsi en valeur le caractère dialogique des postures de chaque personnage, leurs contradictions insolubles, plus fécondes encore d’un point de vue dramatique ainsi exacerbées. Du hurlement débridé au cri maîtrisé, les comédiens donnent à voir un rapport mouvant à leur personnage et font ainsi percevoir les scissions qui les constituent. Ce choix esthétique radical qui ouvre encore leur appréhension tend à faire atteindre la « grande densité émotionnelle[51] » que V. Macaigne recherche aussi avec L’Idiot.

Déplacer le théâtre avec Dostoïevski
Dans le discours dont ils entourent leur spectacle, Copeau comme Camus mettent en avant le fait que la poétique de Dostoïevski rapproche ses œuvres du théâtre. Ils suggèrent ainsi qu’ils adaptent ses romans car ils sont adaptables. Néanmoins, ils font finalement peu cas de ces caractéristiques dramatiques dans la réécriture qu’ils proposent, et ces remarques paraissent ne servir qu’à légitimer leur entreprise a posteriori. L’étude de ces trois spectacles révèle qu’en réalité plusieurs aspects des romans de Dostoïevski — l’intrigue, les personnages, le contenu idéologique ou philosophique, la forme épique, ou de façon encore moins tangible, la rage — ont pu paraître théâtralisables aux metteurs en scène, ont pu susciter chez eux le désir de s’en emparer.
Mais chacune de leur démarche démontre plus encore que ce qui selon eux attire Dostoïevski au théâtre, ce qu’ils considèrent comme théâtralisable dans ses romans, est indissociable du déplacement qu’ils recherchent avec lui, de la stimulation de la scène qu’ils en attendent. Dans les trois cas, il apparaît en effet qu’ils invoquent Dostoïevski afin de donner une nouvelle inflexion au théâtre, afin de renouveler ses conditions — que leurs recherches portent sur le jeu du comédien, les formes du tragique ou l’art théâtral lui-même.
Un tel parcours diachronique, de Copeau à Camus, puis de Camus à V. Macaigne, met en outre en valeur le fait qu’un tel déplacement recherché avec Dostoïevski n’est pas lié à un théâtre, celui d’une certaine époque, ou de l’une ou l’autre tendance esthétique. Aujourd’hui encore, alors que le théâtre semble échapper à toute entreprise de définition, que même le qualificatif de « postdramatique » semble peu apte à en cerner les contours mouvants car il est régulièrement remis en jeu dans toutes ses composantes, Dostoïevski continue d’être adapté par les metteurs en scènes contemporains afin de nourrir leurs recherches artistiques.
Au terme de cette réflexion, il semble finalement que le théâtralisable soit particulièrement pertinent pour saisir le caractère double du mouvement qui relie les romans de Dostoïevski au théâtre. Alors que l’adaptable se limite à penser les formes de compatibilités de certains objets avec la scène, le théâtralisable a pour qualité de prendre également en compte l’écart fécond, la résistance créatrice qui fondent l’attirance de certains objets pour le théâtre.
___
Bibliographie :
Bakhtine Mikhaïl Mikhaïlovitch, La Poétique de Dostoïevski, trad. Isabelle Kolitcheff, Paris, Le Seuil, 1998.
Bartfled Fernande, L’Effet tragique : essai sur le tragique dans l’œuvre de Camus, préface de Jacqueline Lévi-Valensi Paris, Champion, 1988.
Brecht Bertolt, Écrits sur le théâtre, trad. et éd. Gérald Eudeline, Serge Lamare et Jean Tailleur, Paris, L’Arche, 1963.
Camus Albert, Carnets. I, Mai 1935-février 1942, éd. Raymond Gay-Crosier, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 2013.
—, Le Mythe de Sisyphe : essai sur l’absurde (1942), Paris, Gallimard, 1979.
—, Les Possédés (1959), éd. Pierre-Louis Rey, Paris, Gallimard, 2010.
—, Théâtre, récits, nouvelles, éd. Roger Quilliot, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1962.
Catteau Jacques, La Création littéraire chez Dostoïevski, Paris, Institut d’études slaves, 1978.
Consolini Marco, « L’oubli et le monument », dans Marco Consolini et Raphaëlle Doyon [dir.], Jacques Copeau, Paris, L’Avant-Scène théâtre, coll. « Nouveaux Cahiers de la Comédie-Française », 2014.
Copeau Jacques, Registres I : Appels (1974), éd. Marie-Hélène Dasté et Suzanne Maistre Saint-Denis, Paris, Gallimard, coll. « Pratique du théâtre », 1985.
—, Registres III : Les Registres du Vieux Colombier I, éd. Marie-Hélène Dasté, Suzanne Maistre Saint-Denis et Norman Henry Paul, Paris, Gallimard, coll. « Pratique du théâtre », 1979.
— et Croué Jean, Les Frères Karamazov, Paris, L’Avant-scène, 1971.
Corvin Michel, « L’adaptation théâtrale : une typologie de l’indécidable », dans Pratiques n° 119-120, Les écritures théâtrales, dir. André Petitjean et Jean-Pierre Ryngaert, 2003, p. 149-172.
Diderot Denis, Paradoxe sur le comédien (1820), préface de Jacques Copeau, Paris, Plon, 1929.
Dunwoodie Peter, Une histoire ambivalente : le dialogue Camus-Dostoïevski, préface de Ernest Sturm, Paris, Nizet, 1996.
Gide André, Dostoïevski : articles et causeries, Paris, Gallimard, coll. « Idées », 1970.
— et Copeau Jacques, Correspondance André Gide-Jacques Copeau. I, Décembre 1902-mars 1913, éd. Jean Claude, Paris, Gallimard, 1987.
Lehmann Hans-Thies, Le Théâtre postdramatique (1999), trad. Philippe-Henri Ledru, Paris, L’Arche, 2002.
Macaigne Vincent, « Présentation du spectacle », « Note d’intention », « Notes de travail », « Entretien avec Eve Beauvallet », reproduits dans le Dossier de presse du Théâtre Vidy-Lausanne. Disponible en ligne : http://vidy.ch/sites/default/files/field_spectacle_file/dprodidiot_0.pdf (consulté le 1er juillet 2016).
Markowicz André et Bernard Florence [entretien], « Annexe I », dans Fl. Bernard, Bernard-Marie Koltès, Une poétique des contraires, thèse dirigée par Marie-Claude Hubert, soutenue en 2008 à l’Université de Provence.
Merejkowski Dmitri, Tolstoï et Dostoïewsky, la personne et l’œuvre (1902), trad. Maurice Prozor et Serge Persky, Paris, Perrin, 1903.
[1] André Markowicz et Florence Bernard [entretien], « Annexe I », dans Fl. Bernard, Bernard-Marie Koltès, Une poétique des contraires, thèse dirigée par Marie-Claude Hubert, soutenue en 2008 à l’Université de Provence.
[2] Depuis Paul Ginisty et Hugues Le Roux en 1888 en France et Nemirovitch-Dantchenko en 1910 en Russie, jusqu’à Frank Castorf en Allemagne et Jean Bellorini au Festival d’Avignon ces derniers mois, la relation que la scène entretient avec les quatre grands romans de Dostoïevski sur plus d’un siècle est presque continue.
[3] A. Markowicz, entretien cité.
[4] Dmitri Merejkowski, Tolstoï et Dostoïevski (1902), trad. Maurice Prozor et Serge Persky, Paris, Perrin & Cie, 1903, p. 243.
[5] Mikhaïl Bakhtine, La Poétique de Dostoïevski (1929), trad. Isabelle Kolitcheff, Paris, Seuil, 1998, p. 64.
[6] Jacques Catteau, La Création littéraire chez Dostoïevski, Paris, Institut d’études slaves, 1978.
[7] Crime et châtiment a par exemple paru particulièrement adaptable à Paul Ginisty et Hugues Le Roux, en 1888. L’abondance des dialogues, la construction d’une intrigue resserrée dans le temps autour du crime de Raskolnikov, le nombre restreint de personnage, ou encore la relative unité de lieu du roman correspondaient en effet aux caractéristiques du drame de cette époque. Partant de ces qualités dramatiques du roman, l’adaptation consistait en une manipulation de la matière romanesque et une transposition en sept tableaux, dont la seule aspiration était de fournir une « bonne » pièce de théâtre à partir de l’œuvre de Dostoïevski.
[8] Voir Hans-Thies Lehmann, Le Théâtre postdramatique (1999), trad. Philippe-Henri Ledru, Paris, L’Arche, 2002.
[9] Première représentation au Théâtre des Arts le 6 avril 1911, dans une mise en scène d’Arsène Durec.
[10] La double influence de ses amis de la Nouvelle revue Française et de Jacques Rouché qui l’amène au théâtre, d’abord en tant que critique puis en tant qu’auteur, semble pouvoir expliquer ce paradoxe. Marco Consolini écrit à ce sujet : « La pensée et la pratique de Jacques Copeau regorgent de fertiles contradictions, et les études théâtrales sont loin d’avoir fini de les interroger, à commencer par celle qui en fait à la fois le plus farouche défenseur de poésie dramatique et l’ennemi acharné de la littérature au théâtre » (M. Consolini, « L’oubli et le monument », dans Marco Consolini et Raphaëlle Doyon [dir.], Jacques Copeau, Paris, L’Avant-Scène théâtre, coll. « Nouveaux Cahiers de la Comédie-Française », 2014, p. 12.)
[11] Copeau, « Les Frères Karamazov », programme du spectacle pour la reprise au Théâtre du Vieux-Colombier, 1913.
[12] Merejkowski, Tolstoï et Dostoïewsky, op. cit., p. 242-243.
[13] Copeau, « Les Frères Karamazov », Programme du spectacle.
[14] Au moment où Copeau entreprend son travail d’adaptation, existent deux traductions des Frères Karamazov, qu’il a consultées : celle d’Halpérine-Kaminsky et de Charles Morice (Plon, 1888) et celle de J.-Wladimir Bienstock et Charles Torquet (Fasquelle, 1906).
[15] Par exemple, la traduction d’Halpérine-Kaminsky et Morice mettait de côté toute l’intrigue d’Aliocha avec les enfants, faisant d’elle une œuvre à part, publiée sous le titre Les Précoces. En outre, les traducteurs ont entièrement réécrit le dénouement du roman, proposant un happy ending digne d’un feuilleton mélodramatique.
[16] André Gide, « Les Frères Karamazov », dans Le Figaro, 4 avril 1911 ; repris dans André Gide, Dostoïevski, Paris, Gallimard, coll. « Idées », 1923, p. 63.
[17] Ces articles et conférences (qui se sont tenues au Théâtre du Vieux-Colombier à l’occasion du bicentenaire de la naissance de Dostoïevski) ont été réunis dans le volume Dostoïevski, op. cit.
[18] Gide écrit des romans de Dostoïevski qu’ils sont « les livres les plus pantelants de vie qu[’il] connaisse », op. cit., p. 71.
[19] Jacques Copeau, Registres III : Les Registres du Vieux-Colombier I, éd. Marie-Hélène Dasté, Suzanne Maistre Saint-Denis et Norman Henry Paul, Paris, Gallimard, coll. « Pratique du théâtre », 1979, p. 389-390.
[20] Copeau, « Un essai de rénovation dramatique » (1913) dans Registres I, « Appels », textes recueillis et établis par Marie-Hélène Dasté et Suzanne Maistre Saint-Denis, 1999, p. 20. Article initialement paru dans la NRF (septembre 1913).
[21] Programme du spectacle lors de sa reprise au Théâtre du Vieux-Colombier. Par cette formule, Copeau renvoie à la démarche de Vladimir Nemirovitch-Dantchenko, qui, quelques mois auparavant, a présenté au Théâtre d’Art de Moscou une adaptation des Frères Karamazov en vingt tableaux, sous-titrée « Fragments du roman de Dostoïevski ».
[22] Idem.
[23] Celle de temps, par l’accentuation de la concentration temporelle du roman, et celle de lieu, au sein de chaque acte — beaucoup plus remarquable en ce qu’elle n’est cette fois pas induite par le roman : le premier acte se déroule au monastère, le deuxième chez Katherina Ivanovna, le troisième et le cinquième chez Féodor, et le quatrième dans une salle de l’auberge de Mokroïé, où se retrouvent Dmitri et Grouchenka.
[24] Dès juin 1910, alors que la pièce n’est pas encore terminée, Copeau commence à se préoccuper de la distribution. Il écrit en effet à ce moment-là à Jacques Rouché au sujet du comédien Edouard Max et dit de lui de façon significative : « C’est Dmitri en personne ». (Copeau, lettre de juin 1910 à Jacques Rouché, reproduite dans Correspondance André Gide-Jacques Copeau. I, Décembre 1902-mars 1913, éd. Jean Claude, Paris, Gallimard, coll. « Cahiers André Gide », 1987, p. 383.)
[25] Copeau, « Réflexion d’un comédien sur le Paradoxe de Diderot » in Denis Diderot, Paradoxe sur le comédien,Paris, Plon, 1929, p. 13-14.
[26] Cité par Peter Dunwoodie, Une histoire ambivalente : le dialogue Camus-Dostoïevski, Paris, Nizet, 1996, p. 192.
[27] Les Possédés sont créés au Théâtre Antoine le 30 janvier 1959. Alors que la traduction du titre par « Les Démons » s’imposait déjà, Camus a conservé celui par lequel il avait découvert l’œuvre et que connaissait mieux le public.
[28] Albert Camus, « Dostoïevski, prophète du xxe siècle » dans Spectacles, n° 1, 1958, p. 3.
[29] Il est intéressant de signaler que dans cette œuvre, les personnages de Dostoïevski se mêlent aux personnalités historiques, mis exactement sur le même plan : Camus donne pour titre à son analyse des révoltes de Pissarev, Bakounine et Netchaïev « Trois possédés », puis il achève de traiter la question du terrorisme individuel avec un paragraphe intitulé « Le chigalevisme », du nom de Chigalev, personnage des Démons.
[30] P. Dunwoodie, Une histoire ambivalente, op. cit.
[31] Camus, « Dostoïevski, prophète du xxe siècle », art. cit., p. 3.
[32] Camus, Théâtre, récit, nouvelles, éd. Roger Quilliot, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1962, p. 1876.
[33] Émission « Gros Plan » de Pierre Cardinal, 12 mai 1959. Texte reproduit dans Camus, Théâtre, récit, nouvelles, op. cit., p. 1725.
[34] Camus, Le Mythe de Sisyphe, Paris, Gallimard, coll. « Idées », 1979, p. 140.
[35] Camus, « Sur l’avenir de la tragédie », conférence reproduite dans Théâtre, récit, nouvelles, op. cit., p. 1707.
[36] Camus, Carnets I. Mai 1935-février 1942, éd. Raymond Gay-Crosier, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1962, p. 1876.
[37] Voir Fernande Bartfeld, L’Effet tragique. Essai sur le tragique dans l’œuvre de Camus, Paris, Champion-Slathkine, 1988.
[38] Camus dit en effet que les personnages de Dostoïevski ont « la stature des personnages dramatiques », et que sa technique est théâtrale car il « procède par dialogues, avec quelques indications de lieux ou de mouvements », dans « Prière d’insérer », Théâtre, récit, nouvelles, op. cit., p. 1877.
[39] Camus, « Prière d’insérer », art. cit.
[40] Camus, « Pourquoi je fais du théâtre », dans Théâtre, Récits, Nouvelles, op. cit., p. 1723
[41] Spectacle créé le 4 mars 2009 à la MC2 de Grenoble et repris le 11 septembre 2014 au Théâtre Vidy-Lausanne, (75 représentations en France).
[42] Deux ans après Idiot !, V. Macaigne crée Au moins j’aurai laissé un beau cadavre, d’après Hamlet de Shakespeare, au Cloître des Carmes d’Avignon.
[43] Vincent Macaigne et Ève Beauvallet, entretien reproduit dans le Dossier de presse du Théâtre Vidy-Lausanne. Disponible en ligne : http://vidy.ch/sites/default/files/field_spectacle_file/dprodidiot_0.pdf
[44] Idem.
[45] Vincent Macaigne, « Note d’intention », dans Dossier pédagogique de la MC2 de Grenoble.
[46] Bertolt Brecht, « Intimidation par les classiques », dans Écrits sur le théâtre, Paris, L’Arche, 1963, p. 315.
[47] Vincent Macaigne, « Présentation du spectacle » dans le Dossier de presse du Théâtre de Vidy-Lausanne.
[48] Michel Corvin, « L’adaptation théâtrale : une typologie de l’indécidable », dans Pratiques, n° 119-120, Les écritures théâtrales, dir. André Petitjean et Jean-Pierre Ryngaert, 2003, p. 154.
[49] Vincent Macaigne, « Présentation du spectacle », art. cit.
[50] Vincent Macaigne, « Note d’intention », art. cit.
[51] Vincent Macaigne, « Notes de travail » dans le Dossier de presse du Théâtre Vidy-Lausanne.
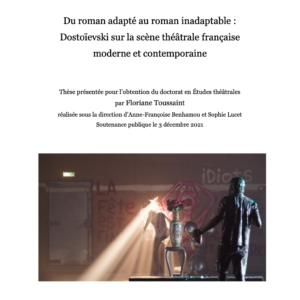



Connaissez-vous la thèse de doctorat de la faculté des lettres et sciences humaines de l’université de Paris, de Silvia VOGIER,intitulée » les adaptations théatrales des romans de Dostoievski en France et en Allemagne »
(mai 1970)?
oui, bien entendu !