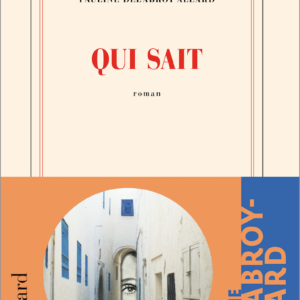Paru en août 2020 aux Éditions Actes Sud, le dernier roman de Lola Lafon, Chavirer, a depuis été plusieurs fois nominé pour des prix littéraires et récompensé par celui de France Culture-Télérama, décerné par des étudiants. Des étudiants qui ont très certainement perçu la nécessité de faire connaître cette œuvre à leur génération, ainsi qu’à celles à venir. Par fragments et éclats, ce roman tourne autour d’adolescences brisées par des silences enfouis et des hontes persistantes. Quoiqu’indissociable du mouvement #MeToo, Chavirer est une œuvre de fiction avant d’être une œuvre militante, une œuvre composée de personnages attachants, dont la lecture est animée par un désir d’en tourner les pages au plus vite, et caractérisée par une écriture qui décrit avec beaucoup de délicatesse des mécanismes d’emprise sournois et des émotions puissantes jamais explicitement exprimées.
 Cléo a douze ans en 1984, elle vit à portée de RER de Paris, à Fontenay. Grâce à des listes de propositions relatives qui produisent l’effet de clichés polaroïds, Lola Lafon saisit la vitalité débordante de cette adolescente. Une adolescente passionnée par le modern jazz, qui rêve d’un avenir de danse pailleté qu’elle prépare en suivant avec application ses cours à la MJC. Sa vie est bouleversée par la rencontre avec une femme qui lui promet la réalisation de son rêve grâce à une bourse, décernée par une fondation. Cléo met alors le doigt dans un engrenage extrêmement sophistiqué qui la rend complice de sa propre chute. La femme, Cathy, l’initie au grand monde grâce à des cadeaux et de l’argent, des sorties culturelles et des virées dans Paris qui donnent à Cléo l’impression « d’en être ». Puis Cathy organise sa rencontre avec les jurés, lors de déjeuners dans les beaux quartiers parisiens. Ceux-ci se montrent moins soucieux de la voire danser que d’évaluer sa « maturité », critère-clé pour l’obtention de la bourse, affirment-ils. Ce mot est employé pour un autre, il est un euphémisme ou une métonymie pour faire comprendre sans la nommer la capacité des candidates à accepter de se laisser toucher par les jurés. Voire plus.
Cléo a douze ans en 1984, elle vit à portée de RER de Paris, à Fontenay. Grâce à des listes de propositions relatives qui produisent l’effet de clichés polaroïds, Lola Lafon saisit la vitalité débordante de cette adolescente. Une adolescente passionnée par le modern jazz, qui rêve d’un avenir de danse pailleté qu’elle prépare en suivant avec application ses cours à la MJC. Sa vie est bouleversée par la rencontre avec une femme qui lui promet la réalisation de son rêve grâce à une bourse, décernée par une fondation. Cléo met alors le doigt dans un engrenage extrêmement sophistiqué qui la rend complice de sa propre chute. La femme, Cathy, l’initie au grand monde grâce à des cadeaux et de l’argent, des sorties culturelles et des virées dans Paris qui donnent à Cléo l’impression « d’en être ». Puis Cathy organise sa rencontre avec les jurés, lors de déjeuners dans les beaux quartiers parisiens. Ceux-ci se montrent moins soucieux de la voire danser que d’évaluer sa « maturité », critère-clé pour l’obtention de la bourse, affirment-ils. Ce mot est employé pour un autre, il est un euphémisme ou une métonymie pour faire comprendre sans la nommer la capacité des candidates à accepter de se laisser toucher par les jurés. Voire plus.
Lola Lafon livre le récit minutieux de ce rêve qui paraît se réaliser mais qui tourne au cauchemar. La scission se creuse à chaque page un peu plus, entre les espoirs nourris de Cléo et le piège qui se referme sur elle. Le lecteur prend de l’avance sur le personnage grâce aux nombreux italiques qui s’immiscent dans l’écriture. Les mots mis en valeur agissent comme des indices, des signaux qui mettent en garde et révèlent un langage trouble, manipulé pour mieux convaincre, pour soumettre sans jamais rien demander explicitement. Des définitions sont parfois insérées, qui remettent d’équerre le langage en rappelant le sens premier des mots. Mais ce sens premier est noyé par des formulations mielleuses, dont la narration rend encore compte par l’entrechoc de voix dans un même phrase. Toutes les formes de discours rapportés – direct, indirect, indirect libre – sont mobilisées, parfois même sans les indices qui permettent de les distinguer, grâce à une parataxe qui oblige à mouler la lecture au rythme des intonations de chacun : celles de Cléo, de Cathy, des membres des jurés. Mais aussi celles des parents de Cléo, de son frère, des amies qui la questionnent sur la bourse dans la cour de récré. Ce récit d’une affaire de pédophilie en bande organisée est en effet sous-tendu par le portrait d’une adolescence – ses joies, ses peines, ses rêves, ses secrets, et… ses hontes. Une adolescence issue d’un milieu social modeste et qui aspire à s’intégrer dans un plus aisé, milieux distingués par quelques indices emblématiques, et adolescence ancrée dans une époque, perçue par un prisme intime plutôt qu’historique, esquissée comme de loin en loin par l’évocation ponctuelle de ministres ou des bribres de discours.
L’histoire est haletante. L’emprise, décortiquée avec la finesse qu’exige une telle mécanique, attire autant qu’elle révulse, et le lecteur, comme le personnage, s’approche avec fascination du gouffre dans lequel la chute paraît inévitable. Cléo, pourtant, ne tombera pas – pas jusqu’au fond du moins. Elle sera arrêtée dans sa chute mais contribuera, de manière plus perverse encore, à faire chuter d’autres adolescentes en s’inscrivant dans la chaîne qui les mène jusqu’aux prédateurs. Sa double casquette de victime et coupable la condamne encore plus fermement au silence que si elle n’avait été que victime. Après le récit de ses espoirs qui se communiquent à toute sa famille, pourrait se poursuivre longuement celui de ses secrets, que seul trahit son corps malade, qui lui hurle autant qu’il peut.
 L’immersion dans l’adolescence de Cléo est telle qu’après quatre-vingts pages il semble en effet envisageable de rester au même endroit, pour deux-cent-cinquante de plus. Une page blanche et l’annonce d’une nouvelle partie annoncent cependant à un revirement total. Après une longue première partie, en viennent de plus courtes, dix autres, qui relatent les suites cahotantes de cette adolescence. Les reconfigurations totales du récit sont chaque fois soulignées par une paragraphe introductif qui transplante de manière abrupte dans le présent inconnu d’un nouveau personnage. Les pages qui suivent livrent ensuite les clés de ce présent indéchiffrable par flashbacks successifs. Ces fragments – fragments de paillettes – déploient une constellation autour de Cléo, mais aussi autour de Betty, l’une de celle qui a « candidaté » à la bourse Galatée à sa suite. Ces chapitres rendent compte des points de vue de certains personnages qui les ont croisées : le meilleur ami du lycée et son père qui lui enseigne les vertus de l’oubli, un kiné qui s’est spécialisé pour accompagner des danseuses, un technicien de plateau, le seul et unique amour, une habilleuse dans un club de danse, un neveu… Tous ces détours ramènent finalement à Cléo, qui, 35 ans plus tard, envisage de sortir du silence pour dire enfin ce qui s’est passé et demander pardon.
L’immersion dans l’adolescence de Cléo est telle qu’après quatre-vingts pages il semble en effet envisageable de rester au même endroit, pour deux-cent-cinquante de plus. Une page blanche et l’annonce d’une nouvelle partie annoncent cependant à un revirement total. Après une longue première partie, en viennent de plus courtes, dix autres, qui relatent les suites cahotantes de cette adolescence. Les reconfigurations totales du récit sont chaque fois soulignées par une paragraphe introductif qui transplante de manière abrupte dans le présent inconnu d’un nouveau personnage. Les pages qui suivent livrent ensuite les clés de ce présent indéchiffrable par flashbacks successifs. Ces fragments – fragments de paillettes – déploient une constellation autour de Cléo, mais aussi autour de Betty, l’une de celle qui a « candidaté » à la bourse Galatée à sa suite. Ces chapitres rendent compte des points de vue de certains personnages qui les ont croisées : le meilleur ami du lycée et son père qui lui enseigne les vertus de l’oubli, un kiné qui s’est spécialisé pour accompagner des danseuses, un technicien de plateau, le seul et unique amour, une habilleuse dans un club de danse, un neveu… Tous ces détours ramènent finalement à Cléo, qui, 35 ans plus tard, envisage de sortir du silence pour dire enfin ce qui s’est passé et demander pardon.
Ce kaléidoscope qui pourrait donner l’illusion de l’exhaustivité révèle au contraire la persistance d’un manque, d’une énigme. Chaque rencontre constitue le soubresaut d’un traumatisme que le temps ne rend que plus profond. Les mêmes schémas reviennent et manifestent le secret refoulé : le corps qui souffre, une docilité excessive, des non-dits qui interrogent et deviennent progressivement partagés, la tentation de faire entendre le monologue intérieur qui habite, le risque parfois pris d’une rupture définitive. Une fois la situation proposée en début de chapitre reliée à l’histoire de Cléo ou à celle de Betty, le lecteur déchiffre tous les indices – contrairement à Ossip, ou Anton, qui enquêtent sur un corps ou un passé, devinent quelque chose sans pourtant y faire pleinement face, complices si ce n’est acteurs d’une omerta généralisée, sociétale, structurelle.
Cette omerta, Lola Lafon s’en empare depuis un endroit bien précis : celui de la danse. Des cours à la MJC aux show pailletés de Drucker à la télévision, du ballet national à Pigalle, des cabarets aux peep-shows… l’autrice révèle un milieu tissé de contradictions, qui révèle de nombreux paradoxes de notre société car il repose entièrement sur la mise en avant du corps des femmes. Elle explore l’impossible partage entre danses tolérées, car considérées comme artistiques, et les danses dévaluées, car trop liées à la sexualité. Elle sonde la violence extraordinaire exercée à l’encontre de corps entraînés, étirés, maquillés, dont les douleurs sont masquées, silenciées. La danse ne sert ainsi pas seulement de cadre aux biographies de Cléo et Betty. Elle se constitue en métaphore filée pour dire tous les rapports de domination engagés dans leur histoire, ainsi que la souffrance de leurs corps soumis à des violences physiques et morales, corps qui doivent continuer à vivre, comme ceux des danseuses doivent continuer à danser, quoi qu’il en coûte et aux prix de multiples dissociations.
Lola Lafon raconte une histoire sans fin ni héros, une histoire comme elle l’écrit, faite de silences, d’oubli et de honte plutôt que de mots. Le rythme de la narration imite la persistance des souvenirs, leur force d’impression autant que les flous qui les entourent. L’écriture, puissante, reste constamment élégante, elle ne verse jamais dans l’obscène et se tient à distance du pathos. Il ne s’agit pas de faire chavirer, comme on dit qu’un cœur chavire. Lola Lafon fait plutôt vaciller, avancer sur des crêtes pointues qui bordent des précipices, en disant l’essentiel et en laissant imaginer le reste. Les bouleversements profonds dont elle s’approche avec délicatesse sont contenus dans des images discrètes, des expressions immédiatement compréhensibles qui tendent vers la poésie et qui se constituent en image d’une partie à l’autre. Ces images rendent progressivement ses personnages familiers, au point de rendre impossible toute forme de jugement à leur endroit. Cléo, Betty, Yonasz, Claude et les autres ne sont pas coupables. Ils sont en revanche tous victimes d’une même société qui les oblige – par l’argent, la violence symbolique, l’injonction à la séduction, la peur savamment entretenue de bouleverser un système global.
F.