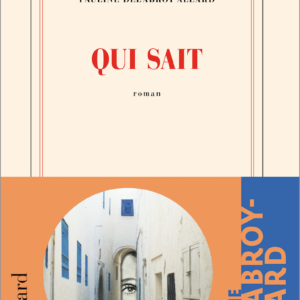La dernière œuvre de Lola Lafon, Quand tu écouteras cette chanson, parue en septembre 2022, a été écrite à l’invitation d’Alina Gurdiel, qui a créé chez Stock une collection intitulée « Ma nuit au musée ». Une collection qui encourage les croisements entre les arts, entre la littérature et la peinture, ou la sculpture. Sauf quand, comme Lola Lafon, c’est d’un musée d’histoire dont il est question. En l’occurrence, l’autrice a demandé à passer la nuit dans la Maison Anne Frank à Amsterdam, choix qui leste aussitôt le projet d’écriture d’un poids singulier, d’une gravité certaine. Pour Lola Lafon, l’expérience se révèle l’occasion de s’interroger sur son geste d’écriture tout en interrogeant fantômes du passé et de son passé.
 Les premières phrases décrivent l’enthousiasme d’une jeune fille postée à une fenêtre, qui voit les invités d’une noce passer au bas de chez elle. Lola Lafon retarde les informations qui permettent de comprendre ces premiers paragraphes, comme elle le fait au début de chaque partie de Chavirer, et révèle qu’il s’agit de la description de la seule image animée qu’il nous reste d’Anne Frank. C’est là l’une des nombreuses archives que l’autrice a consultées pour l’écriture de ce livre. Avant d’aller passer la nuit dans la Maison Anne Frank, et sans doute aussi un peu après, elle a lu quantité de témoignages, essais ou dossiers polémiques pouvant lui permettre d’approcher le « phénomène » Anne Frank. Après avoir posé que ce phénomène est universellement connu, Lola Lafon demande : qui a lu son journal, ou l’a relu, depuis le collège ou le lycée ? Qui a vraiment prêté attention à ses mots, à leur portée ?
Les premières phrases décrivent l’enthousiasme d’une jeune fille postée à une fenêtre, qui voit les invités d’une noce passer au bas de chez elle. Lola Lafon retarde les informations qui permettent de comprendre ces premiers paragraphes, comme elle le fait au début de chaque partie de Chavirer, et révèle qu’il s’agit de la description de la seule image animée qu’il nous reste d’Anne Frank. C’est là l’une des nombreuses archives que l’autrice a consultées pour l’écriture de ce livre. Avant d’aller passer la nuit dans la Maison Anne Frank, et sans doute aussi un peu après, elle a lu quantité de témoignages, essais ou dossiers polémiques pouvant lui permettre d’approcher le « phénomène » Anne Frank. Après avoir posé que ce phénomène est universellement connu, Lola Lafon demande : qui a lu son journal, ou l’a relu, depuis le collège ou le lycée ? Qui a vraiment prêté attention à ses mots, à leur portée ?
L’enjeu du livre est, entre autres, de déconstruire l’image épurée qui s’est forgée autour d’Anne Frank, de débusquer les éléments de langage qui ont contribué à atténuer sa judéité ou la conscience aiguë qu’elle avait de ce qui l’attendait si elle était arrêtée, qui dément l’argument « on ne savait pas ». Lola Lafon montre aussi comment la valorisation de sa jeunesse a contribué à faire d’elle un prodige d’écriture, mais aussi à mettre l’accent sur sa pureté et son innocence au détriment du soin qu’elle mettait à retravailler ses pages et de son ambition d’être journaliste. Avec les survivants qui l’ont connue de près ou de loin, avec les personnes qui ont consacré leur vie à sa vie, à ses textes, à son histoire, Lola Lafon essaie d’approcher Anne Frank, qu’elle hésite à ne nommer qu’Anne, de reconstituer les traces de son histoire au-delà de la fin du journal, qui s’arrête brutalement un matin d’août 1944.
 Le choix d’aller passer une nuit dans ce musée, ou plus précisément dans l’appartement de quelques mètres carrés seulement dans lequel ont été confinés Anne Frank, sa sœur Margot, ses parents ainsi que quatre autres personnes pendant 25 mois avant d’être arrêtés et déportés, l’autrice ne se l’explique pas d’emblée. Il s’agit d’un musée sans œuvre, d’un musée vide, qui invite à faire l’expérience de l’absence. Tout autour de l’appartement, nommé l’Annexe, sont exposés des documents, des objets, des images. Mais la chambre d’Anne Frank, autour de laquelle l’autrice rôde sans pouvoir se décider à y entrer, est vide. Lola Lafon cite Marguerite Duras : « Si on savait quelque chose de ce qu’on va écrire, avant de le faire, avant d’écrire, on n’écrirait jamais. Ce ne serait pas la peine. » C’est là l’une des nombreuses citations qui émaillent son récit, présenté comme une enquête sur le passé d’Anne Frank et sur sa postérité. Une enquête qui a nécessité des recherches abondantes, d’une ampleur universitaire, mais restituées sous une forme narrative qui dissipe toute pesanteur scientifique, qui donne lieu à un récit érudit et éclairé. Cette enquête se double en outre d’une autre, sur le passé de l’autrice elle-même, ainsi que d’une troisième, sur l’écriture, sur sa fonction, sa place, ses moyens et son rôle dans la vie. La mise en scène de la démarche d’écriture devient alors au moins aussi importante que l’objet qui l’occupe.
Le choix d’aller passer une nuit dans ce musée, ou plus précisément dans l’appartement de quelques mètres carrés seulement dans lequel ont été confinés Anne Frank, sa sœur Margot, ses parents ainsi que quatre autres personnes pendant 25 mois avant d’être arrêtés et déportés, l’autrice ne se l’explique pas d’emblée. Il s’agit d’un musée sans œuvre, d’un musée vide, qui invite à faire l’expérience de l’absence. Tout autour de l’appartement, nommé l’Annexe, sont exposés des documents, des objets, des images. Mais la chambre d’Anne Frank, autour de laquelle l’autrice rôde sans pouvoir se décider à y entrer, est vide. Lola Lafon cite Marguerite Duras : « Si on savait quelque chose de ce qu’on va écrire, avant de le faire, avant d’écrire, on n’écrirait jamais. Ce ne serait pas la peine. » C’est là l’une des nombreuses citations qui émaillent son récit, présenté comme une enquête sur le passé d’Anne Frank et sur sa postérité. Une enquête qui a nécessité des recherches abondantes, d’une ampleur universitaire, mais restituées sous une forme narrative qui dissipe toute pesanteur scientifique, qui donne lieu à un récit érudit et éclairé. Cette enquête se double en outre d’une autre, sur le passé de l’autrice elle-même, ainsi que d’une troisième, sur l’écriture, sur sa fonction, sa place, ses moyens et son rôle dans la vie. La mise en scène de la démarche d’écriture devient alors au moins aussi importante que l’objet qui l’occupe.
Le récit de son arrivée au musée, de sa préparation à la nuit, du déroulement de la nuit elle-même, solitaire, dans un musée vide, se trouve ainsi délayé par des interrogations, des réflexions, des souvenirs. Lola Lafon comprend et donne à comprendre progressivement que si elle a choisi ce musée, c’est sans doute, de manière plus ou moins consciente, pour aborder enfin la question de son identité juive, qu’elle a scrupuleusement refoulée tout au long de sa vie. Cette expérience est l’occasion de rassembler des lambeaux autobiographiques et de revenir sur l’histoire de ses grands-parents, d’oncles et de tantes, de sa mère. Et, autant que ces bouts d’histoire, de revenir sur le silence dont elles sont faites. Outre la Shoah, Lola Lafon aborde la question de l’exil, qu’elle a elle-même vécu, de la Roumanie à la France, vécu qu’elle rapproche de celui des Frank, qui ont fui l’Allemagne pour les Pays-Bas et ont cru pouvoir tenir la guerre là malgré les restrictions successives imposées aux juifs, puis l’étoile jaune, puis les arrestations et déportations qui ont donné l’idée au père de la famille Frank, avec la complicité de quelques employés, de se cacher au dernier étage de l’entreprise qu’il dirigeait, calfeutrés, silencieux pendant les heures travaillées.

Tout s’entremêle, dans de courts chapitres. Le présent de l’écriture, le passé d’Anne Frank, et quelque part entre les deux, le passé de Lola Lafon, celui de sa famille et son enfance. Dans la plongée au cœur des ténèbres qu’elle a entrepris de faire avec ce voyage à Amsterdam, les temporalités se télescopent et d’innombrables points de vue sont mis en perspective. Ceux des témoins, des garants, mais aussi ceux des négationnistes ou des producteurs américains qui ont voulu créer un spectacle humaniste à partir du Journal d’Anne Frank, en laissant de côté tout ce qui pourrait déranger le public avide de belles histoires. Alors qu’elle passe sous silence les noms de ceux qui bafouent la mémoire de la jeune fille, Lola Lafon qui se sert des pages écrites par Anne Frank pour reconstituer le cours de l’histoire, un cours chronologique mais tortueux, a au contraire soin d’en reprendre les extraits les moins connus et les plus frappants. L’écriture de cette œuvre s’articule de cette façon à une autre œuvre, dans un dialogue extrêmement étroit, soigneusement tissé, qui se situe à un endroit d’intimité et de commentaire singulier – endroit qu’explore de manière comparable Pauline Delabroy-Allard, dans la troisième partie de son dernier roman, Qui sait.
Cette intrication entre le récit d’Anne Frank, la démarche de Lola Lafon et l’histoire qu’elle exhume à cette occasion décuplent l’émotion. Le choix qu’elle a fait d’aller dans ce musée plutôt qu’un autre s’éclaire en dernière instance, tout comme le titre de l’œuvre. Le livre prend in extremis la forme d’un monument, d’une autre espèce de musée consacré à la mémoire d’une autre victime d’un autre génocide, dont le souvenir est lui aussi condensé en deux syllabes. L’épisode autobiographique vient de cette façon servir de point de fuite à l’histoire d’Anne Frank, et ainsi lui donner une perspective plus profonde encore. Il y a beaucoup de virtuosité dans la reconstitution de cette quête multiple, qui va bien au-delà du récit que l’autrice a passée dans un musée. Dans ce texte, Lola Lafon tisse en outre le motif des jeunes filles qui parcourt ses précédentes œuvres, et écrit des pages magnifiques sur leur irrévérence, ou sur l’instinct paradoxal de vie dont est fait l’anorexie. Le style enlevé et précis qui est le sien, tout à la fois limpide et puissant, happe, au point que la lecture nécessite bien moins de temps qu’une nuit, qu’elle apparaît comme une fulgurance qui invite à la réflexion, ainsi qu’à la redécouverte du Journal d’Anne Frank.
F.
Notre échange est un premier pas dans la nuit.
Un pas dans le vide, aussi, qui me révèle l’étendue de mon ignorance. Ce texte vendu à plus de trente millions d’exemplaires dans le monde n’est pas un simple journal intime ou un testament. C’est nier la démarche de l’autrice Anne Frank que la réduire à un témoignage, m’a dit Laureen. Anne voulait devenir écrivaine ou journaliste, elle l’a écrit.
Dans mon carnet, une ronde de points d’interrogation encercle une date soulignée, celle du 29 mars 1944.
Ce jour-là, alors qu’elle vit enfermée dans l’Annexe depuis l’été 1942, Anne Frank entend, sur Radio Oranje, une annonce du ministre de l’Éducation des Pays-Bas en exil à Londres. Il demande aux Hollandais de conserver leurs lettres, leurs journaux intimes : après guerre, ces écrits seront autant de témoignages précieux. Cette déclaration la galvanise, elle s’enthousiasme, en parle à son père : son journal pourrait être publiée, un jour.
Elle se met aussitôt à le retravailler : elle quitte le ton spontané des premières pages, en parfait le style. Elle rédige un prologue, supprime des passages qu’elle juge peut-être trop personnels, en étoffe d’autres. Elle décide d’utiliser des pseudonymes, faisant des occupants de l’Annexe, qu’elle croque parfois vertement, des personnages. Elle choisit une forme narrative particulière, s’adressant à une amie imaginaire, Kitty, héroïne de romans pour la jeunesse dont elle raffole. Elle décrit minutieusement l’Annexe, pièce après pièce et précise le contexte historique.
Elle revient sur une phrase, questionne la pertinence d’un chapitre, écoute le rythme d’un paragraphe, passe d’un ton introspectif à des réflexions plus politiques : à compter de ce jour, Anne Frank n’est plus seulement une jeune fille qui tient un journal, toutes ses décisions sont celles d’une autrice qui pense à de futurs lecteurs. Si elle a commencé à écrire sans intention de se faire lire le 12 juin 1942, à compter du mois de mars 1944, elle dit « je », mais elle commence à penser à nous. Elle en est persuadée, son texte saura trouver le futur, il viendra nous chercher ; aujourd’hui, il est venu me chercher.
Comment l’appeler, ce récit que je ne me décide pas à relire avant ma nuit dans l’Annexe ? Ce livre est un décompte, auquel nous assistons. Nous en redoutons l’issue, nous savons qu’après le 4 août, date de l’arrestation des Frank, il n’y aura plus de mots. Ce livre, nous en connaissons la fin ; l’autrice, elle, l’ignore.