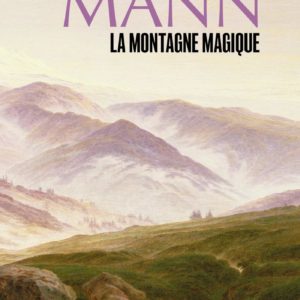Une certaine nostalgie des années 2010 semble s’exprimer au travers de la programmation du Festival d’Avignon : Ostermeier, Anne Teresa de Keersmaeker, Christoph Marthaler… Après dix ans d’absence, ce dernier est réinvité à la FabricA avec Le Sommet, créé il y a quelques semaines au Piccolo Teatro de Milan. Ce spectacle est né de la collaboration de trois pays coproducteurs – la Suisse, l’Italie et la France – et réunit des acteurs et actrices de différentes nationalités qui parlent le français, l’italien, l’allemand, l’autrichien et l’anglais. Le groupe constitué offre l’image d’une vieille Europe réfugiée au sommet d’une montage, et semble désigner sur un mode tendre et comique la désuétude de cette union dont les idéaux sont chaque jour mis à l’épreuve par l’actualité.

L’effet de révélation émerveille quand le rideau s’ouvre et découvre un refuge, au sommet d’un montage. L’habitation a littéralement été construite au sommet : celui-ci transperce le plancher de la maison, suggérant qu’elle est perchée sur cette pointe comme un nid d’aigle. Un nid majoritairement constitué de bois, avec espaces de rangements, couchettes, table pliable, boîtier de secours et armoire à pharmacie. Un homme est embusqué sous un banc, mais notre regard converge vers le point de fuite de cette construction qui ne respecte pas les lois de la géométrie : une boîte centrale équipée de boutons clignotants, sorte de passe-plat ou d’ascenseur capable de faire surgir La Joconde ou des randonneurs qui convoquent le folklore autrichien par leur accoutrement. L’appareil se révèle un ressort comique plusieurs fois mobilisé dans le cours du spectacle, car nul ne semble pouvoir anticiper ce qu’il va révéler.
Après plusieurs livraisons – dont une désopilante où trois paires de jambes se tressent et se disputent la sortie de cette boîte avant de découvrir des visages – l’assemblée est au complet. Elle est constituée de trois hommes et trois femmes de trois générations différentes. Après une ronde, les corps se répartissent aussitôt dans l’espace avec une précision chorégraphique. La synchronicité de leurs gestes et de leurs déplacements atténue leur singularité et dispense de savoir qui ils sont et quelles sont leurs relations. L’évacuation de ces questions est également encouragée par le fait qu’aucune parole n’est échangée – ce qui ne les empêche pas de réagir de manière très expressive et comique les uns aux autres.

La voix survient quand les individus se saisissent de gros classeurs gris et prononcent de manière imprévisible des mots monosyllabiques, en français, en anglais, en italien ou en allemand. Un chœur se forme à base de « Yes », « Non », « Da » ou « Si », envoyés suivant de multiples intonations et sans ordre déchiffrable, et ce chant congédie toute forme de narration. Ensuite, ils mangeront de manière tout aussi chorale la petite biscotte qui leur parvient – de la plaine sans doute. Qui les approvisionne ? C’est une question qui nous effleure mais qu’on chasse de la main : adeptes de Philippe Quesne ou de Kurō Tanino, on adhère si pleinement à l’absurdité posée par cette mise en matière qu’il semble vain de s’interroger et bien plus pertinent de s’adonner à l’observation de ces énergumènes, de leurs manies, de leurs interactions, et des situations comiques créées avec beaucoup de finesse dans lesquelles ils se retrouvent.
Se déploie ainsi une série de numéros dans cet espace riche de surprises, dont la révélation des possibles constitue le véritable moteur dramaturgique du spectacle. Des discours surviennent parfois mais n’ancrent pas davantage les personnages et le monde auquel ils appartiennent : une déclaration en autrichien que personne ne comprend, une prière exaltée en italien, un chant de désespoir sur la vieillesse en français… des pistes sont de cette manière ouvertes mais le mouvement d’ensemble l’emporte sur les échappées individuelles. C’est en effet quand ils agissent de concert que ces êtres se réalisent pleinement – dans un sauna, lors d’une soirée mondaine en tenue d’apparat ponctuée de prises de paroles en onomatopées, pour un cours de gym avec bâtons de ski ou quand il s’agit de gonfler des extincteurs en plastique.

L’extérieur, qui s’imposait si massivement au moment de la découverte de la scénographie, n’est jamais pris en compte dans cet univers apparemment hermétique. Il n’est suggéré que lorsqu’il s’agit de se débarrasser de ce qui encombre par un vide-ordure – sans égards pour les déchets que pourraient constituer des paires de chaussures par exemple. Pour le reste, on ne saura jamais comment leurs parviennent les choses livrées par le passe-plat, les toilettes situées à l’étage inférieure s’effondrent sur elles-mêmes, un portique de sécurité situé à jardin suggère un accès limité à cet endroit, et des hélicoptères attirent parfois leur attention pour un instant. Mais l’annonce d’un confinement de 15 à 18 ans dans ce lieu à cause de travaux n’ébranle pas plus que cela les six individus : la livraison d’une nouvelle tenue juste après cette annonce les distrait de la potentielle angoisse qui pourrait les saisir à l’idée de rester ensemble tant de temps, alors que leurs rapports expriment plus de léger agacement que d’affinités profondes. L’espace qu’ils habitent est visiblement assez riche de ressources pour qu’ils se détournent du dehors, malgré leur équipement premier, il n’est jamais question d’une expédition. Le sauna que l’un alimente avec allégresse, le cahier qui garde trace du passage de prédécesseurs, les cérémonies qu’ils se jouent entre eux ou l’impression d’une interminable feuille qui déclenche leurs rires suffisent à les occuper.
Si certaines transitions paraissent un peu lâche, cet humour contenu dans les détails et cette façon de relancer le mouvement du spectacle grâce à la scénographie pleine d’inventivité de Duri Bischoff ou grâce la musique et au chant démontrent que l’art de Marthaler est toujours opérant et intact dans sa singularité. On s’en délecte, sans toutefois bien saisir la portée de son geste, généralement sous-tendu par un discours sur le réel ou l’histoire, ou sur notre sensibilité à la marche du monde. S’agit-il d’une montagne magique – ou d’un refuge magique – où des êtres s’éloignent des préoccupations du monde pour se consacrer à l’observation d’eux-mêmes ?

Le programme de salle révèle que le spectacle contient quantité de citations de quantité d’auteurs, insoupçonnable tant le langage articulé semble réduit au minimum. Plutôt que ces sources, ce que l’on devine de la genèse du spectacle, c’est une série d’essais dans cet espace ludique, qui ont progressivement constitué la matière du spectacle. L’entretien mené avec le metteur en scène et son dramaturge met quant à lui l’accent sur l’idée que le rassemblement de ces individus pourrait suggérer une réunion au sommet. Cette dimension n’est cependant pas tout à fait perceptible, ou du moins elle ne paraît pas assez centrale pour servir de prisme de lecture à l’étrangeté déployée au plateau. Plutôt que comme des responsables politiques, ces six-là, ces six-là, moins soucieux du réchauffement climatique que du refroidissement de leur sommet, nous apparaissent comme des individus d’une autre époque dont la dernière des préoccupations est de savoir ce qui se passe dans le monde d’en bas.
F.
Pour en savoir plus sur Le Sommet, rendez-vous sur le site du Festival d’Avignon.