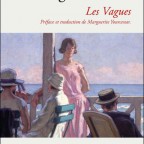Après Marie-Christine Soma il y a une douzaine d’années, ou, plus récemment, Pauline Bayle, de biais avec Écrire sa vie, c’est au tour d’Élise Vigneron de proposer une adaptation des Vagues, livre « le plus complexe et le plus difficile » de Virginia Woolf de l’aveu de l’autrice anglaise elle-même. L’approche s’annonce d’emblée singulière cette fois, car l’artiste a été formée aux arts plastiques, au cirque puis aux arts de la marionnette, dans lesquels elle se distingue ces dernières années. Elle promet avec ce spectacle une courte adaptation du roman, d’une heure seulement, pour cinq interprètes et cinq marionnettes de glace. Le travail extrêmement plastique qu’elle propose, mais aussi fondé, dramaturgiquement parlant, invite à une réflexion grave sur le temps qui passe – thème central des Vagues.
 Une lumière crépusculaire laisse deviner un lustre en forme de globe, qui se balance, relancé à plusieurs reprises dans son mouvement par une présence humaine indistincte. Son mouvement est de plus en plus violent, jusqu’à ce que le globe explose en morceau : ce qui paraissait du verre était déjà de la glace. Cette entrée en matière donne sa coloration au récit des vies sur le point d’être retracées, de l’éveil à la mort. Des voix bruissantes d’enfants retentissent en off ensuite et reprennent les premières phrases du roman, qui permettent de découvrir les voix des personnages – six chez Woolf, plus que cinq ici, car Neville a été laissé de côté. Le chœur s’interrompt et une actrice reprend la première des peintures marines qui rythme le passage d’une partie à l’autre du roman, qui chaque fois décrivent un paysage. Le récit d’un lever de soleil accompagne progressivement l’éclairage de la scène et des silhouettes qui l’occupent, qui bientôt se tournent vers une image indéchiffrable qui se révèle une armoire, dans laquelle se trouvent cinq marionnettes.
Une lumière crépusculaire laisse deviner un lustre en forme de globe, qui se balance, relancé à plusieurs reprises dans son mouvement par une présence humaine indistincte. Son mouvement est de plus en plus violent, jusqu’à ce que le globe explose en morceau : ce qui paraissait du verre était déjà de la glace. Cette entrée en matière donne sa coloration au récit des vies sur le point d’être retracées, de l’éveil à la mort. Des voix bruissantes d’enfants retentissent en off ensuite et reprennent les premières phrases du roman, qui permettent de découvrir les voix des personnages – six chez Woolf, plus que cinq ici, car Neville a été laissé de côté. Le chœur s’interrompt et une actrice reprend la première des peintures marines qui rythme le passage d’une partie à l’autre du roman, qui chaque fois décrivent un paysage. Le récit d’un lever de soleil accompagne progressivement l’éclairage de la scène et des silhouettes qui l’occupent, qui bientôt se tournent vers une image indéchiffrable qui se révèle une armoire, dans laquelle se trouvent cinq marionnettes.
Cinq marionnettes grandeur nature, revêtues de quelques habits mais au teint livide à cause de la glace. L’une après l’autre, elles sont très délicatement extraites de leur berceau tombal, reliées à quantités de fils qui passent par les cintres et prennent fin à l’arrière de la scène avec un système de poids qui permet de les mettre debout. Une fois placées au milieu du plateau, avec quantité de soins, l’adaptation reprend les premières pages du roman, qui racontent les perspectives croisées de Louis, Jinny, Susan, Bernard et Rhoda sur leur petite enfance, alors qu’ils jouent dans un jardin, s’embrassent, souffrent, se racontent et racontent leur rapport au monde. Les monologues intérieurs dont est exclusivement constituée l’œuvre ne sont pas transformés en dialogue, ni adressés au public ; ils sont ici énoncés en prenant appui sur les marionnettes, celles du personnage qui parle, ou celles vers qui le récit tend. Le dédoublement de la présence des interprètes par les poupées de glace résout ainsi la question aiguë de ces paroles au statut profondément troubles – qui plus est portées à la scène –, et des effets de communication qu’elles produisent parfois de manière indirecte.
 Élise Vigneron et Marion Stoufflet, sa dramaturge, prennent le temps de déployer ce premier chapitre, particulièrement fascinant dans sa façon de mettre en place les modalités de narration de l’œuvre et les personnages, ou ce qui en reste par ces voix. Ce premier temps qui laisse la part belle au texte nous laisse croire que le dispositif, quoiqu’esthétique, limite les mouvements et manipulations des marionnettes, fragiles, et donc statiques. Mais elles sont rapidement déshabillées, et bientôt Rhoda s’envole dans les airs, manipulée par plusieurs des interprètes qui agissent de concert ses nombreux fils pour permettre sa nage aérienne. De cette façon, est raconté son rapport fuyant au monde, son malaise à l’occuper, à la différence des autres. Ces mouvements s’intensifient et déjà la marionnette commence à se briser, faisant peser dès ce chapitre consacré à l’enfance la menace de la mort à venir.
Élise Vigneron et Marion Stoufflet, sa dramaturge, prennent le temps de déployer ce premier chapitre, particulièrement fascinant dans sa façon de mettre en place les modalités de narration de l’œuvre et les personnages, ou ce qui en reste par ces voix. Ce premier temps qui laisse la part belle au texte nous laisse croire que le dispositif, quoiqu’esthétique, limite les mouvements et manipulations des marionnettes, fragiles, et donc statiques. Mais elles sont rapidement déshabillées, et bientôt Rhoda s’envole dans les airs, manipulée par plusieurs des interprètes qui agissent de concert ses nombreux fils pour permettre sa nage aérienne. De cette façon, est raconté son rapport fuyant au monde, son malaise à l’occuper, à la différence des autres. Ces mouvements s’intensifient et déjà la marionnette commence à se briser, faisant peser dès ce chapitre consacré à l’enfance la menace de la mort à venir.
Ces marionnettes sont donc capables de mouvements, mais des interactions sont-elles possibles avec celles et ceux qui les manipulent ? Les interprètes restent au fond du plateau, pour équilibrer leur pesanteur avec des bouteilles de verre transparent, remplies d’eau. Ils les touchent parfois, par fils interposés, ou du bout des doigts. Ces gestes mettent en valeur la rigidité presque archaïques de ces pantins, plus durs encore que le bois de Pinocchio. Il faut attendre la troisième partie du roman, l’entrée des personnages dans le monde après l’école et le lycée, pour que les rapports entre les êtres de glace et les êtres de chair s’approfondissent : Susan retrouve le contact de la terre sous le poids de sa marionnette, étendue sur elle, et Jinny, à travers le corps d’Azusa Takeuchi ou Yumi Osanai en alternance, danse follement avec la sienne – quitte à ce qu’elle s’abîme, qu’elle se casse pour partie elle aussi, et dise la décrépitude du corps bien avant l’heure du déclin, alors que le personnage n’est pas même encore au zénith de sa vie.
 Le texte extrêmement poétique de Virginia Woolf, qui l’envisageait comme un « poème dramatique », qui disait : « J’écris les Vagues selon un rythme, non une intrigue », est ramené à quelques bribes, de plus en plus réduites de partie en partie. L’ambition du spectacle n’est pas de reprendre le récit de ces vies entremêlées, faites d’affects, de sensations. Ne restent que quelques moments saillants : après l’enfance, la rencontre avec Perceval – septième des personnages du roman, que l’on n’entend jamais, uniquement perçu par le prisme des autres –, l’entrée dans le monde, le dîner d’adieu à Perceval qui part aux Indes, l’annonce de sa mort et la mort de Rhoda, qui dans le spectacle suit immédiatement celle de Perceval, un dîner de retrouvailles, puis le déclin de ceux qui restent, qui vieillissent et tirent le bilan de leur existence.
Le texte extrêmement poétique de Virginia Woolf, qui l’envisageait comme un « poème dramatique », qui disait : « J’écris les Vagues selon un rythme, non une intrigue », est ramené à quelques bribes, de plus en plus réduites de partie en partie. L’ambition du spectacle n’est pas de reprendre le récit de ces vies entremêlées, faites d’affects, de sensations. Ne restent que quelques moments saillants : après l’enfance, la rencontre avec Perceval – septième des personnages du roman, que l’on n’entend jamais, uniquement perçu par le prisme des autres –, l’entrée dans le monde, le dîner d’adieu à Perceval qui part aux Indes, l’annonce de sa mort et la mort de Rhoda, qui dans le spectacle suit immédiatement celle de Perceval, un dîner de retrouvailles, puis le déclin de ceux qui restent, qui vieillissent et tirent le bilan de leur existence.
Le texte ne devient pas pour autant pur prétexte à la technique virtuose des marionnettes de glace. Celle-ci lui donne un accès oblique, sensible, et permet par exemple de donner à voir Rhoda aquatique, qui nage au milieu de ses pétales blancs, ou le mouvement constant de la mer, lentement constituée par les marionnettes qui gouttent progressivement – beaucoup plus rapidement qu’on ne l’aurait cru, car elles sont en réalité bien plus fines que ce que l’on aurait pu croire au départ. Une fois encore, la manipulation d’un élément sur scène – l’eau, ici explorée dans deux de ses états, ailleurs le vent, ailleurs la terre, ailleurs encore, mais plus rarement, le feu – se révèle d’une puissance expressive extraordinaire. On regrette le caractère presque trop architecturé de la création sonore, qui nous introduit à l’univers de Woolf avec un son plus citadin que maritime, et recouvre parfois la musique de l’eau qui s’écoule des pantins ou le bruit déchirant de la glace qui craque et s’effondre au sol. Les lumières de César Godefroy subliment en revanche les mouvements des marionnettes et leur transparence changeante, et ceux des corps humains, bientôt en prise avec l’eau à mesure que la glace fond.
 Les interprètes, plus manipulateurs qu’acteurs dans ce spectacle qui les contraint, malmènent de plus en plus franchement leurs doubles glacés, qui deviennent squelettiques et annoncent bien avant la fin du roman la mort des êtres, mort non compensée par l’impassibilité de l’univers, qui suit son cours, indifférent aux grandes et petites tragédies. Le procédé adopté, dramaturgiquement fécond, tend à assombrir l’œuvre, en tout en en exhaussant la dimension poétique. Cette accentuation du caractère presque abstrait de l’œuvre scinde sans doute la réception du spectacle, entre les personnes qui la connaissent et celles qui la découvrent. Mais la fascination visuelle qu’il exerce rend dans tous les cas l’expérience extrêmement singulière et accompagne une méditation sensible sur l’écoulement – littéral et parfois fracassant – du temps.
Les interprètes, plus manipulateurs qu’acteurs dans ce spectacle qui les contraint, malmènent de plus en plus franchement leurs doubles glacés, qui deviennent squelettiques et annoncent bien avant la fin du roman la mort des êtres, mort non compensée par l’impassibilité de l’univers, qui suit son cours, indifférent aux grandes et petites tragédies. Le procédé adopté, dramaturgiquement fécond, tend à assombrir l’œuvre, en tout en en exhaussant la dimension poétique. Cette accentuation du caractère presque abstrait de l’œuvre scinde sans doute la réception du spectacle, entre les personnes qui la connaissent et celles qui la découvrent. Mais la fascination visuelle qu’il exerce rend dans tous les cas l’expérience extrêmement singulière et accompagne une méditation sensible sur l’écoulement – littéral et parfois fracassant – du temps.
F.
Pour en savoir plus sur « Les Vagues », rendez-vous sur le site du Théâtre de Châtillon.