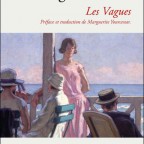La trajectoire fulgurante de Pauline Bayle, directrice du Théâtre Public de Montreuil depuis janvier 2022, se poursuit : elle est cette année programmée au Festival d’Avignon, au Cloître des Carmes. Après s’être fait connaître avec son adaptation de l’Iliade – notamment grâce au Off d’Avignon –, puis celle de l’Odyssée, après une incursion du côté de la littérature contemporaine avec Chanson douce de Leïla Slimani puis après être revenue à un grand classique, Illusions perdues de Balzac, la metteuse en scène associe une nouvelle fois son nom à celui d’une grande figure de la littérature : Virginia Woolf. Le projet est aussi séduisant que flou : Pauline Bayle ne choisit pas une œuvre de l’autrice en particulier, mais puise indifféremment dans ses romans, ses essais, son journal et sa correspondance. Par rapport à ses précédents spectacles, elle n’exhibe cependant pas son geste d’adaptation et fait croire que Virginia Woolf a écrit du théâtre – et du mauvais théâtre.

Le public est invité à passer sur la scène pour atteindre les gradins. Alors qu’une partie s’échappe vite de cet espace qu’il est venu voir et non occuper, une autre s’installe en face des gradins, sur de grandes marches blanches placées devant les arcades en ogive du Cloître des Carmes. L’ambiance est à la fête, nourrie par des acteurs et actrices qui servent des verres de limonade, plaisantent, disent leur joie de nous voir là et d’autres choses qui se perdent dans le brouhaha. Des phrases se font mieux entendre que d’autre : l’un demande si le maire est arrivé ; l’autre aide une spectatrice à retrouver son amie en criant son nom ; deux ou trois délibèrent sur la ponctualité. Le seuil qui mène au spectacle dure un peu, puis enfin, ça commence.
Le début est aveugle. On ne comprend pas de quoi il est question, ni où est Woolf. On voit de jeunes gens qui discutent, c’est gai mais leurs paroles tardent à installer une situation. On se demande d’où viennent ces phrases, tout en constatant qu’ils sont six au plateau, et très vite, dans un coin de la tête, se loge le souvenir des Vagues. Mais on le refoule, et on essaie de comprendre si les acteurs et actrices sont des personnages ou eux-mêmes, et si ce sont des personnages, à quelle œuvre renvoient leurs prénoms. On comprend qu’une fête se prépare pour le retour d’un ami attendu, Jacob, tandis que dehors la guerre menace, qu’il est question d’un couvre-feu et de champagne introuvable – mais là, ce sont les personnages qui refoulent. Ils se chamaillent, se coupent la parole, sont saisis d’élans lyriques. Ils installent un grand buffet au centre du plateau recouvert de gravillons blancs, apportent des verres, des fruits, du fromage, de grosses miches de pain et des fleurs. Puis ils entraînent le public à chanter une chanson pour Jacob, sur l’air de Hey Jude.

L’installation s’éternise, l’attente de Jacob est partagée. Puis ils se mettent à parler de Jacob, et de la fascination qu’il exerce – ou pas – sur eux. Et là, le souvenir de Perceval, dans Les Vagues, ne peut plus être congédié. On reconnaît dès lors Suzanne en Céleste, et Jinny aussi, et Bernard, et Rhoda, et Neville. On se demande s’il s’agit d’un préquelle des Vagues qui se trouverait quelque part dans les Journaux de Woolf, car les personnages sont plus jeunes que ceux du roman au-delà de la première partie. Ils jouent à chat, se racontent des histoires extraordinaires, et parfois dansent. Les moments dansés mettent en évidence le flottement dramaturgique de l’ensemble. Alors que dans Illusions perdues, la danse arrivait comme une magnifique acmé qui révélait les potentialités de la scénographie après un long temps de maturation, ici, une chorégraphie qui reprend les mêmes gestes, sur les mêmes sons toujours aussi puissants de Julien Lemonnier, arrivent tôt, à la faveur d’un appel à « plonger ».
On finit par accepter, par dépit, de se contenter de suivre ces six jeunes qui préparent une fête en résistant à la menace de la guerre qui gronde (réminiscence de Mrs Dalloway), en cherchant à reconnaître Woolf dans quelques phrases. Mais la plupart paraissent kitsch, ainsi extraites de leur contexte, elles ont l’air de caricatures du style si délicat de l’autrice. Les acteurs et actrices, devenus pour la plupart familiers grâce aux précédents spectacles, mettent pourtant toute l’énergie nécessaire à les faire entendre et à leur donner sens. Cette écriture ne sollicite cependant pas le jeu – du moins telle qu’elle est restituée ici. Elle le rend au contraire factice, superficiel. Comme cette scénographe ornée d’un buffet et de gros ballons rouges : c’est esthétique, ça ménage parfois de belles images picturales composée par la lumière et les costumes, mais c’est faux, superficiel.

Le fantôme embarrassant des Vagues – dont les monologues magnifiques sont ramenés à de plats dialogues – s’impose encore lorsque l’arrivée espérée de Jacob est remplacée par des sirènes hurlantes qui disent la guerre et la mort de l’ami, puis qu’une ellipse de plusieurs années marquée par le déplacement des spectateurs assis sur le plateau sépare la deuxième scène-fleuve de la première. Désormais, les personnages tirent le bilan de leurs trajectoires, personnelles ou professionnelles, racontent leur survivance à la perte de Jacob, l’importance de leur amitié dans leurs vies, leur rapport à l’enfance et à la guerre. Le tout est volontairement désancré pour que des parallèles se tissent, d’une guerre à l’autre, de l’époque de Woolf à la nôtre. Pour que des phrases telles que : « Comment se produit le retour de la lumière après une éclipse ? » retentisse, et que la description du retour de la lumière par touches infinitésimales prenne la forme d’un appel à la vie et à la joie dans l’époque sombre qui est la nôtre. C’est parfois beau, mais souvent naïf. Et c’est aussi long : les deux heures de spectacle en paraissent trois.
Avec cette création, semble s’appliquer une règle plusieurs fois démontrée, à quelques exceptions près : l’artiste propulsé par les institutions et nommé à la tête d’un théâtre après une phase de reconnaissance fructueuse voit son inspiration fauchée. D’un coup, il se trouve avec trop de reconnaissance, trop d’argent, et surtout trop peu de temps pour mûrir un projet avec la même intensité qu’ont été mûris les précédents. Il y a finalement beaucoup de prétention à vouloir adapter tout Woolf, sous un titre qui semble faire référence à son Journal, indéchiffrable dans le spectacle, plutôt que de se contenter d’une adaptation des Vagues – entreprise qui a déjà donné lieu à de beaux spectacles, parmi lesquels celui mémorable de Marie-Christine Soma (et on attend celui d’Élise Vigneron la saison prochaine). La déception est en outre causée par le fait que Pauline Bayle ne laisse pas deviner l’ampleur du matériau dont elle s’empare, comme dans ses précédents spectacles, ni ici sa variété. Auparavant, elle nous faisait deviner la base de l’iceberg, sous sa pointe, et conférait ainsi à ses spectacles une épaisseur épique, romanesque. Ici, ni épaisseur, ni profondeur, ni mise en valeur des sources hétérogènes qui l’inspirent. Ne reste que la surface pure d’une mauvaise pièce de théâtre qui emprunterait de belles citations à Woolf. L’adaptation, dans sa forme la plus pauvre…
F.
Pour en savoir plus sur « Écrire sa vie », rendez-vous sur le site du Festival d’Avignon.