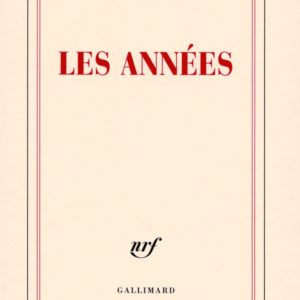Le premier roman d’Annie Ernaux, Les Armoires vides, contient en puissance plusieurs de ses œuvres à venir. Dans ce texte d’inspiration autobiographique, l’autrice relate son enfance et son parcours de transfuge, du café-épicerie de ses parents à l’université, au travers du personnage de Denise Lesur. Quoiqu’elle révèle en creux la genèse d’une autrice, l’œuvre ne livre pas le récit victorieux d’une ascension sociale permise par l’école. La trajectoire de la jeune femme est retracée dans un moment de crise, qui la condamne selon elle à la fatalité de son milieu d’origine.
 Le livre est composé d’un seul bloc, simplement dessiné par des paragraphes qui s’enchaînent. Aucun chapitre, aucune partie, aucun saut de ligne ne vient structurer l’ensemble. Seules les sept premières pages sont distinguées du reste, afin de poser nettement les circonstances du déversement à venir – circonstances qu’Annie Ernaux développera dans L’Événement : une jeune femme repart de chez une avorteuse avec une sonde dans le ventre, et attend, en boule sur son lit d’étudiante, que l’opération fasse son œuvre. Prisonnière de cette attente, de son issue incertaine, elle essaie de réaliser ce qui lui arrive, de chercher dans la littérature des références qui auraient pu la préparer à ce qu’elle vit – en vain –, et craint pour l’avenir qu’elle avait rêvé. Puis elle reconstitue les circonstances qui l’ont amenée jusqu’à cette situation, qu’elle croit inévitable compte tenu de son histoire, qu’elle interprète comme un châtiment qu’elle aurait mérité.
Le livre est composé d’un seul bloc, simplement dessiné par des paragraphes qui s’enchaînent. Aucun chapitre, aucune partie, aucun saut de ligne ne vient structurer l’ensemble. Seules les sept premières pages sont distinguées du reste, afin de poser nettement les circonstances du déversement à venir – circonstances qu’Annie Ernaux développera dans L’Événement : une jeune femme repart de chez une avorteuse avec une sonde dans le ventre, et attend, en boule sur son lit d’étudiante, que l’opération fasse son œuvre. Prisonnière de cette attente, de son issue incertaine, elle essaie de réaliser ce qui lui arrive, de chercher dans la littérature des références qui auraient pu la préparer à ce qu’elle vit – en vain –, et craint pour l’avenir qu’elle avait rêvé. Puis elle reconstitue les circonstances qui l’ont amenée jusqu’à cette situation, qu’elle croit inévitable compte tenu de son histoire, qu’elle interprète comme un châtiment qu’elle aurait mérité.
Les souvenirs affluent donc et la ramènent dans le café-épicerie de ses parents, où elle essaie de faire le tri, de retrouver ce qu’il y avait, avant la haine. Elle se remémore la joie de la petite enfance à trois, au premier étage, le dégoût et la fascination pour les clients omniprésents – côté café –, le plaisir des mains plongées dans les bocaux de bonbons et les récits de femmes collectés sous le comptoir – côté épicerie. Par le prisme de la petite fille unique, de ses jeux dans la courette et la cuisine, de son règne sur le café-épicerie et les gamins du quartier, de sa relation à ses parents à l’origine profondément aimés et admirés – sentiments que sondera Annie Ernaux dans Une femme, consacré à sa mère, et La Place, à son père –, de ses rapports ambivalents avec leurs clients respectifs, le lecteur est immergé dans un monde aux teintes fanées, dont restent des traces sur les murs encore bariolés de vieilles enseignes dans de petites villes de France.
 Aux descriptions précises de l’espace se mêlent les joies et les peines, la répulsion et les satisfactions, avant même le choc de l’école, l’ouverture extraordinaire qu’elle impose à ce monde refermé sur lui-même. La petite fille prend alors conscience du fait qu’existent plusieurs mondes, aux frontières infranchissables, et la faille qui les sépare devient le lit de l’humiliation, de la honte, puis de la haine et de l’horreur. Le rejet est double, il s’exerce aussi bien à l’endroit des parents, progressivement jugés, accusés de tous les gestes et les mots qui trahissent ses origines, qu’à celui de ses camarades détestées, qui se moquent et méprisent, et pour qui tout est si simple, si évident. L’enfant solitaire reste seule jusqu’à l’âge adulte, ses amitiés sont fausses, éphémères. Aucune solidarité ou sororité ne vient la soutenir dans le combat qu’elle a engagé contre le monde entier, plutôt que contre les inégalités qu’elle vit dans sa chair. Tout ce qui a été tu pendant des années rejaillit ainsi à la faveur de l’avortement – élément déclencheur de cet afflux dont le présent est régulièrement rappelé. La violence de l’événement déchaîne la violence des sentiments ressentis à l’égard des autres, quel que soit le monde auquel ces autres appartiennent, et à l’égard d’elle-même. L’écriture assume pleinement cette violence, aussi impudiques soit-elle, et restitue de cette façon celle ressentie dans la confrontation des deux mondes, dans l’occupation hésitante du non-lieu qui les sépare.
Aux descriptions précises de l’espace se mêlent les joies et les peines, la répulsion et les satisfactions, avant même le choc de l’école, l’ouverture extraordinaire qu’elle impose à ce monde refermé sur lui-même. La petite fille prend alors conscience du fait qu’existent plusieurs mondes, aux frontières infranchissables, et la faille qui les sépare devient le lit de l’humiliation, de la honte, puis de la haine et de l’horreur. Le rejet est double, il s’exerce aussi bien à l’endroit des parents, progressivement jugés, accusés de tous les gestes et les mots qui trahissent ses origines, qu’à celui de ses camarades détestées, qui se moquent et méprisent, et pour qui tout est si simple, si évident. L’enfant solitaire reste seule jusqu’à l’âge adulte, ses amitiés sont fausses, éphémères. Aucune solidarité ou sororité ne vient la soutenir dans le combat qu’elle a engagé contre le monde entier, plutôt que contre les inégalités qu’elle vit dans sa chair. Tout ce qui a été tu pendant des années rejaillit ainsi à la faveur de l’avortement – élément déclencheur de cet afflux dont le présent est régulièrement rappelé. La violence de l’événement déchaîne la violence des sentiments ressentis à l’égard des autres, quel que soit le monde auquel ces autres appartiennent, et à l’égard d’elle-même. L’écriture assume pleinement cette violence, aussi impudiques soit-elle, et restitue de cette façon celle ressentie dans la confrontation des deux mondes, dans l’occupation hésitante du non-lieu qui les sépare.
L’école apparaît bien vite comme un moyen de s’en sortir – mais de quoi, demande la narratrice. Grâce aux bonnes notes, au catéchisme bien appris, Denise Lesur se dérobe aux criques et remarques méprisantes des professeures et des élèves. Plutôt que de le combler, elle creuse donc l’écart, confirmée dans ce choix par sa première communion, tentative désastreuse de rapprochement. La contradiction qu’elle ressent très vivement est alors que ses parents l’encouragent à travailler, à progresser dans la scolarité qui l’éloigne d’eux, qui rend progressivement le dialogue impossible avec eux. Alors que son mépris pour eux grandit, eux sont fiers de la voir réussir et se montrent prêts à se sacrifier pour qu’elle aille le plus loin possible – et, en plus de la haine qu’elle ressent pour elle-même face à son mépris pour eux, sa culpabilité, il faut encore à l’enfant prendre en charge ce sacrifice pesant. Denise Lesur apprend donc à passer d’un monde à l’autre, de manière plus ou moins douloureuse selon les périodes. L’écriture rend compte de l’endroit de porosité qu’elle cherche à créer par le discours indirect libre, qui souligne la langue brute des clients et des parents, ou la langue lissée de l’école – et plus tard, l’argot joueur de la jeunesse. Dans une même phrase, se bousculent encore des références apparemment incompatibles, des cours et de la littérature aux conversations de café, des leçons de Pasteur sur l’hygiène à la saleté de la boutique, que même Balzac ne pourrait pas raconter. La scission interne est parfois plus aigüe que d’autres, et il faut alors compartimenter pour survivre dans un monde comme dans l’autre, cultiver la distance grâce à laquelle le récit est désormais possible. Le récit sans architecture apparente prend alors la forme d’une escalade, où « le pire » un moment nommé n’est encore rien par rapport au pire qui reste encore à réaliser.
 Dans cet écartèlement progressif, un penchant particulier s’affirme pour la littérature, qui apparaît comme un refuge, le seul endroit où Denise Lesur se sent à sa place, loin de ses parents et au-dessus de ses camarades. Très paradoxalement, quand on connaît l’écriture d’Annie Ernaux, qu’on devine derrière le masque de Denise Lesure qui épouse parfaitement son visage, on découvre un penchant profondément romanesque chez la petite fille : elle est une lectrice avide qui manifeste une grande puissance de fiction, qui modèle la réalité à ses rêves et ses lectures, qui façonne le monde qui l’entoure à son goût, qui s’imagine des vies dans ses compositions pour corriger le réel qui lui fait honte. L’écrivaine adulte refoulera ce penchant à l’affabulation, et dira au contraire dans La Place chercher à se tenir au plus près de ce qui a été, pour être fidèle au souvenir de son père.
Dans cet écartèlement progressif, un penchant particulier s’affirme pour la littérature, qui apparaît comme un refuge, le seul endroit où Denise Lesur se sent à sa place, loin de ses parents et au-dessus de ses camarades. Très paradoxalement, quand on connaît l’écriture d’Annie Ernaux, qu’on devine derrière le masque de Denise Lesure qui épouse parfaitement son visage, on découvre un penchant profondément romanesque chez la petite fille : elle est une lectrice avide qui manifeste une grande puissance de fiction, qui modèle la réalité à ses rêves et ses lectures, qui façonne le monde qui l’entoure à son goût, qui s’imagine des vies dans ses compositions pour corriger le réel qui lui fait honte. L’écrivaine adulte refoulera ce penchant à l’affabulation, et dira au contraire dans La Place chercher à se tenir au plus près de ce qui a été, pour être fidèle au souvenir de son père.
À mesure que l’élève progresse vers le bac et les études supérieures, les leçons apprises ne suffisent plus à faire illusion, le manque de culture devient criant. Un autre apprentissage s’impose, plus subtil, qui dresse en creux le portrait d’une époque, qu’Annie Ernaux développera dans Les Années. La jeune femme choisit alors le désir comme moyen d’émancipation, pour dominer les bourgeois à qui elle ne veut désormais plus ressembler, ceci malgré la condamnation de la religion, qui a contribué à son élévation sociale, et les menaces de ses parents, qui craignent de la voir devenir « bistrote » comme eux si elle déchoit. Mais Denise Lesur brûle de désir, dès l’enfance. Elle découvre les corps obscènes des clients de son père avant le sien, devine son plaisir, attend ses premières règles comme un baptême, puis guette les garçons et les séduit. L’autrice consacre des pages puissantes aux premières sensations de plaisir partagé, au pouvoir transclasse qu’il confère sur les garçons qui la méprisent. Pouvoir auquel elle croit, jusqu’à ce que les menaces de sa mère deviennent réalité, que la fatalité la rattrape et qu’elle tombe enceinte, et qu’elle se retrouve chez la faiseuse d’anges, avec la crainte que son désir soit définitivement anéanti par l’opération.
Dans ces heures décisives avant l’expulsion du corps étranger, l’écriture se précipite pour tenter de tout dire. Le bouillonnement reste sans résolution, la seule conclusion possible est la condamnation à son milieu d’origine. Cette trajectoire remarquable, du café-épicerie aux bancs de la fac – et, plus tard, au Prix Nobel de littérature –, qui pourrait de loin paraître source de fierté, même d’orgueil, est ramené à la fatalité par cette grossesse non désirée : qui d’autre que Denise Lesur pour finir avec une sonde dans le ventre. Celle qui a essayé de faire oublier les manies de ses parents a été rattrapée par son identité profonde, qu’aucune année d’étude ni aucun concours ne pourra pour de bon abolir. Les contradictions que révèle un tel parcours sont innombrables dans ce récit condensé, dont les phrases sont parfois incomplètes. Après lui, reste beaucoup à déplier, pour faire le tri, déconstruire, combattre l’idée que tout est inné, approcher plus encore l’ambivalence devenue fondement de l’identité, et de l’écriture. Les œuvres à venir déplieront donc, et poursuivront le récit désordonné de la vie de la fille unique du café-épicerie, avec La Femme gelée, puis Mémoire de fille.
F.