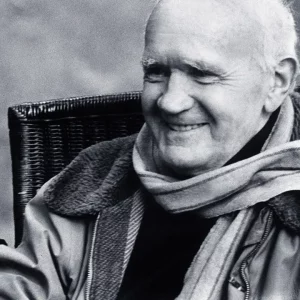À l’invitation du directeur du Théâtre de l’Odéon et de son programmateur, Arthur Nauzyciel a choisi de mettre en scène Les Paravents de Jean Genet – auteur dont il avait monté Splendid’s en 2015. Le spectacle a été créé en septembre dernier au Théâtre National de Bretagne que Nauzyciel dirige, et le voilà qui clôt la saison du Théâtre de l’Odéon. Entre temps, ces Paravents n’ont pas tourné, ce qui s’explique sans doute par l’ampleur de ce spectacle, sa scénographie monumentale, sa vaste distribution de seize personnes et sa durée de quatre heures. Il n’en faut pourtant pas moins pour représenter cette pièce-monstre de Genet, pièce qui paraît parfois si abstraite et injouable à la lecture. Après Roger Blin en 1966 et Patrice Chéreau en 1983, il était temps qu’un grand metteur en scène de notre époque s’attaque à cette œuvre et y donne accès aux nouvelles générations afin d’en faire percevoir tout à la fois la folie, l’exubérance provoquante et la puissance théâtrale extraordinaire. Nauzyciel pose ainsi un nouveau jalon dans l’histoire des mises en scène de cette pièce et relance avec elle la réflexion sur sons sens et les partis pris auxquels elle oblige.
 La scénographie saisit d’emblée : elle est constituée d’un immense escalier blanc immaculé, qui monte très haut sur le plateau et l’occupe presque complètement. L’architecture, cernée de part et d’autres de hauts-parleurs carcéraux, prolongée par de discrets escaliers noirs à mi-hauteur qui ménagent des sorties, et placée de telle sorte que des passages permettent l’accès à l’étroite avant-scène qu’il dessert, congédie d’emblée les paravents éponymes que Genet décrit avec soin dans la didascalie qui ouvre chaque tableau. Alors que l’accessoire, érigé au rang de personnage par le titre, semble faciliter la représentation, la rendre possible, il la met en réalité plusieurs fois au défi et tend paradoxalement à complexifier une projection scénique du texte. Nauzyciel préfère donc à ces paravents de hautes marches, que justifient quantités d’indications d’échelles, grâce auxquelles Genet surligne des rapports de force entre les personnages dans ses didascalies et dans les commentaires dont il fait suivre ses tableaux – textes qui expriment une tentation narrative au sein de la pièce, qui assortissent après coup les répliques de remarques et d’indications, mais textes qui procèdent également à un travail de sape dramaturgique, spectaculairement assumé à l’issue du Dixième tableau, lorsque Genet conclut : « Dans cette pièce – mais je ne la renie pas, oh non ! – j’aurai beaucoup déconné ».
La scénographie saisit d’emblée : elle est constituée d’un immense escalier blanc immaculé, qui monte très haut sur le plateau et l’occupe presque complètement. L’architecture, cernée de part et d’autres de hauts-parleurs carcéraux, prolongée par de discrets escaliers noirs à mi-hauteur qui ménagent des sorties, et placée de telle sorte que des passages permettent l’accès à l’étroite avant-scène qu’il dessert, congédie d’emblée les paravents éponymes que Genet décrit avec soin dans la didascalie qui ouvre chaque tableau. Alors que l’accessoire, érigé au rang de personnage par le titre, semble faciliter la représentation, la rendre possible, il la met en réalité plusieurs fois au défi et tend paradoxalement à complexifier une projection scénique du texte. Nauzyciel préfère donc à ces paravents de hautes marches, que justifient quantités d’indications d’échelles, grâce auxquelles Genet surligne des rapports de force entre les personnages dans ses didascalies et dans les commentaires dont il fait suivre ses tableaux – textes qui expriment une tentation narrative au sein de la pièce, qui assortissent après coup les répliques de remarques et d’indications, mais textes qui procèdent également à un travail de sape dramaturgique, spectaculairement assumé à l’issue du Dixième tableau, lorsque Genet conclut : « Dans cette pièce – mais je ne la renie pas, oh non ! – j’aurai beaucoup déconné ».
Exit, donc, les paravents. Mais Nauzyciel rassure aussitôt les afficionados de Genet par l’entrée en scène d’une grâce mémorable d’Aymen Bouchou, qui interprète le rôle principal de Saïd. Après un passage au noir, l’acteur émerge lentement du haut des escaliers comme un fantôme, aérien. Puis il descend les premières marches avec une légèreté qui le libère de toute gravité et l’assimile à Abdallah Bentaga, funambule et amant de Genet qui a inspiré un magnifique texte à ce dernier, sur cet art si singulier qui flirte avec la mort. Avec cette vision saisissante, suspendue, qui d’emblée impose une temporalité qui se soustrait à tout impératif, le metteur en scène signale qu’il prend certaines distances avec le texte, mais pour mieux embrasser l’art de Genet.
 Ainsi, Saïd ne porte pas les vêtements colorés que décrit minutieusement l’auteur, et ni lui, ni les autres, ne sont attifés de postiches grâce auxquels Genet voulait que les visages se soustraient à « cette beauté conventionnelle des traits dont on joue trop au théâtre comme au cinéma ». La mère de Saïd, Marie-Sophie Ferdane, méconnaissable avec ses longs cheveux et son maquillage noirs, animale avec ses jambes constamment arquées et ses pieds et chevilles peinturés de noir eux aussi, arrive en revanche bien avec une valise de carton bouilli et des chaussures à talons dépareillées. La scénographie n’illustre pas la route ponctuée d’une borne sur laquelle se retrouvent la mère et le fils, mais le dialogue suffit à mettre en place la situation initiale, le mariage sur le point de se conclure entre le plus pauvre et la plus laide de deux villages distants de plusieurs kilomètres. C’est par ceux-là, les plus misérables qui soient, dont on comprend de scène en scène qu’ils vivent dans une décharge, que Genet va aborder les conflits coloniaux de son époque, et plus particulièrement la guerre d’Algérie, en cours au moment où il écrit la pièce, en 1961. Mais comme les bonnes, ces misérables sont dotés d’un langage d’une intense poésie et d’un sens du théâtre inouï. La mère et le fils se convainquent ainsi que la valise de cadeaux qu’ils vont apporter à la famille de la mariée est pleine, et qu’ils vivent entourés de quantité de poules, de coqs et d’autres animaux que la mère imite avec un plaisir communicatif.
Ainsi, Saïd ne porte pas les vêtements colorés que décrit minutieusement l’auteur, et ni lui, ni les autres, ne sont attifés de postiches grâce auxquels Genet voulait que les visages se soustraient à « cette beauté conventionnelle des traits dont on joue trop au théâtre comme au cinéma ». La mère de Saïd, Marie-Sophie Ferdane, méconnaissable avec ses longs cheveux et son maquillage noirs, animale avec ses jambes constamment arquées et ses pieds et chevilles peinturés de noir eux aussi, arrive en revanche bien avec une valise de carton bouilli et des chaussures à talons dépareillées. La scénographie n’illustre pas la route ponctuée d’une borne sur laquelle se retrouvent la mère et le fils, mais le dialogue suffit à mettre en place la situation initiale, le mariage sur le point de se conclure entre le plus pauvre et la plus laide de deux villages distants de plusieurs kilomètres. C’est par ceux-là, les plus misérables qui soient, dont on comprend de scène en scène qu’ils vivent dans une décharge, que Genet va aborder les conflits coloniaux de son époque, et plus particulièrement la guerre d’Algérie, en cours au moment où il écrit la pièce, en 1961. Mais comme les bonnes, ces misérables sont dotés d’un langage d’une intense poésie et d’un sens du théâtre inouï. La mère et le fils se convainquent ainsi que la valise de cadeaux qu’ils vont apporter à la famille de la mariée est pleine, et qu’ils vivent entourés de quantité de poules, de coqs et d’autres animaux que la mère imite avec un plaisir communicatif.
Grâce à cet unique espace, cet escalier parfois agrémenté d’un cadre, on passera de la route au bordel, du bordel à la cabane de Saïd et son épouse Leïla, de la cabane au champ de Sir Harold où travaille Saïd, du champ à la prison où il sera par la suite enfermé, de la prison au cimetière, du cimetière à l’orangeraie, de l’orangeraie à la colline – et ainsi de suite jusqu’au seizième tableau. Il y a quelque chose de wilsonien dans cet espace scénique pur, dimension que soulignent les lumières de Scott Zielinski qui font surgir des couleurs surprenantes sur les marches et leur donnent plus ou moins de volume, ainsi que les déplacements chorégraphiques orchestrés par Damien Jalet, grâce auxquels les corps des acteurs et actrices habitent l’espace de manière hiératique – notamment ceux des putains, picturales – ou dégoulinent et se désarticulent. Irrémédiablement immobile, cet espace qui menace les corps de chutes invite à un jeu dynamique, impulse quantité de mouvements de haut en bas et de bas en haut, inspire d’innombrables diagonales sur cette page blanche et dessine de cette façon des relations toujours changeantes entre les personnages.
 Dans ce cadre plastique, à la beauté fascinante, les costumes des acteurs et actrices sont moins exubérants que ceux décrits par Genet, et les accessoires plus rares, mais d’autant plus saillants – comme ces talons dépareillés, ou ces chaussures et armes aux couleurs pastels inspirées par une didascalie de Genet, qui tendent à déréaliser la violence des balles tirées. Nauzyciel, en revanche joue pleinement avec le texte, ses nuances et ses débordements, par sa direction d’acteur, et c’est précisément grâce aux corps éructants qu’il fait entrevoir la violence de la mitraille. Il en a réuni seize au plateau, qui appartiennent à différentes générations. Il y a parmi eux des fidèles, comme Marie-Sophie Ferdane, Mounir Margoum, Xavier Gallais ou Catherine Vuillez ; des élèves du TNB qu’il a formés et qu’on a découverts avec la magnifique reprise de son Malade imaginaire – Aymen Bouchou et Hinda Abdelaoui au premier chef, en Saïd et Leïla ; et d’autres qu’on découvre, comme Benicia Makengele, qui donne une portée extraordinaire à la mort de Kadidja. Soigneusement costumés, plus ou moins grimés, leurs voix parfois travesties par des accents, leur présence est démultipliée et permet de s’y retrouver dans la liste de personnage démesurément grande, qui semble à la lecture condamner toute forme de narration à l’orée de la pièce.
Dans ce cadre plastique, à la beauté fascinante, les costumes des acteurs et actrices sont moins exubérants que ceux décrits par Genet, et les accessoires plus rares, mais d’autant plus saillants – comme ces talons dépareillés, ou ces chaussures et armes aux couleurs pastels inspirées par une didascalie de Genet, qui tendent à déréaliser la violence des balles tirées. Nauzyciel, en revanche joue pleinement avec le texte, ses nuances et ses débordements, par sa direction d’acteur, et c’est précisément grâce aux corps éructants qu’il fait entrevoir la violence de la mitraille. Il en a réuni seize au plateau, qui appartiennent à différentes générations. Il y a parmi eux des fidèles, comme Marie-Sophie Ferdane, Mounir Margoum, Xavier Gallais ou Catherine Vuillez ; des élèves du TNB qu’il a formés et qu’on a découverts avec la magnifique reprise de son Malade imaginaire – Aymen Bouchou et Hinda Abdelaoui au premier chef, en Saïd et Leïla ; et d’autres qu’on découvre, comme Benicia Makengele, qui donne une portée extraordinaire à la mort de Kadidja. Soigneusement costumés, plus ou moins grimés, leurs voix parfois travesties par des accents, leur présence est démultipliée et permet de s’y retrouver dans la liste de personnage démesurément grande, qui semble à la lecture condamner toute forme de narration à l’orée de la pièce.
S’il les fait chaque fois arriver à reculons sur le plateau, Nauzyciel les entraîne toutes et tous dans ce texte qu’il embrasse, qu’il prend à bras-le-corps malgré ses mystères et ses étrangetés, en les faisant passer d’un jeu tantôt éthéré, onirique, à un jeu profondément physique, et parfois grossier – prisme qui épouse la diversité des registres que parcourt l’écriture de Genet, qui adopte « la langue de l’ennemi », celle de Ronsard, pour mieux la distordre et la subvertir. Quantité de styles de jeu sont ainsi convoqués pour suivre les mouvements de cette langue impure, qui retentit la plupart du temps dans un silence religieux à peine troublé par le vol de quelques mouches, et exceptionnellement soutenue par quelques notes de musique. Une langue impure qui redouble la trajectoire de Saïd, qui part sur les routes pour rejoindre le « pays-monstre », où il espère s’acheter une nouvelle femme, mais qui se trouve contraint de voler et choisit de s’enfoncer dans le crime, de « [se] pourrir pour pourrir le monde ». Le misérable finit vagabond sur les routes, engagé dans une folle cavale à travers le pays, recherché par les étrangers comme par les siens qui le constituent progressivement légende, tandis que Leïla se fait prisonnière elle aussi pour le suivre – et le caractère profondément ambigu de leur relation nous parvient à chaque confrontation, tout particulièrement lors de la scène de chant d’amour dans la prison. De cette façon, Saïd devient l’emblème de la colonisation qui condamne au mal, constitue le mal en refuge comme le dit Kadidja au moment de mourir : « Mal, merveilleux mal, toi qui nous restes quand tout a foutu le camp, mal miraculeux tu vas nous aider ».
 Cependant, la pièce de Genet n’est pas une pièce sur la guerre d’Algérie – elle est tout au plus, dit l’auteur, une « méditation » sur elle. Le cadre spatio-temporel est flou, on sait simplement qu’il y a des locaux et des colons qui les regardent de haut, qui sont physiquement bien plus grands qu’eux – et l’escalier de Nauzyciel exhibe cette domination que Genet veut rendre visible. Ce rapport suffit à lui seul à dire l’essentiel, et à soulever à partir de lui la question du mal et celle de la mort. Il rend ainsi dispensable l’insert d’archives pendant l’entracte et au début de la première partie, la projection de cartes de l’Algérie française puis le témoignage du cousin du metteur en scène, qui était médecin à Tlemcen au moment du conflit. Filmé en gros plan chez lui, Nauzyciel le montre lisant les lettres qu’il écrivait à ses parents en 1957. Cette référence directe à l’histoire amenuise la poésie du texte de Genet, la rabat vulgairement sur la réalité historique, et rend le redémarrage du spectacle encore plus difficile après la pause, alors que le texte s’envole plus que jamais, que l’espace du bordel et de la mort se confondent – ces deux espaces où les camps ennemis se retrouvent, liés par le symbole de la fente. Si les morts sont distingués des vivants par quelques traces blanches sur le visage, les repères sont alors encore plus flous, les strates de réalité qui se superposent encore plus nombreuses au moment où se réunissent tous les personnages autour de l’absence de Leïla et Saïd, puis de leur retour tant attendu.
Cependant, la pièce de Genet n’est pas une pièce sur la guerre d’Algérie – elle est tout au plus, dit l’auteur, une « méditation » sur elle. Le cadre spatio-temporel est flou, on sait simplement qu’il y a des locaux et des colons qui les regardent de haut, qui sont physiquement bien plus grands qu’eux – et l’escalier de Nauzyciel exhibe cette domination que Genet veut rendre visible. Ce rapport suffit à lui seul à dire l’essentiel, et à soulever à partir de lui la question du mal et celle de la mort. Il rend ainsi dispensable l’insert d’archives pendant l’entracte et au début de la première partie, la projection de cartes de l’Algérie française puis le témoignage du cousin du metteur en scène, qui était médecin à Tlemcen au moment du conflit. Filmé en gros plan chez lui, Nauzyciel le montre lisant les lettres qu’il écrivait à ses parents en 1957. Cette référence directe à l’histoire amenuise la poésie du texte de Genet, la rabat vulgairement sur la réalité historique, et rend le redémarrage du spectacle encore plus difficile après la pause, alors que le texte s’envole plus que jamais, que l’espace du bordel et de la mort se confondent – ces deux espaces où les camps ennemis se retrouvent, liés par le symbole de la fente. Si les morts sont distingués des vivants par quelques traces blanches sur le visage, les repères sont alors encore plus flous, les strates de réalité qui se superposent encore plus nombreuses au moment où se réunissent tous les personnages autour de l’absence de Leïla et Saïd, puis de leur retour tant attendu.
La troupe réunie parvient malgré tout à redonner du souffle au spectacle, à le décoller de la réalité trop littérale qu’a introduite Nauzyciel, alors que le texte de Genet retentit sans référence explicite, que les phrases du général à ses légionnaires font signe vers le réel sans qu’il soit nécessaire de renvoyer à l’histoire ou à l’actualité politique la plus immédiate. Les acteurs et actrices se libèrent de tout réalisme pour répondre jusqu’au bout à la poésie du texte, avant de s’évanouir comme des spectres, de tomber comme des marionnettes au terme d’une ultime ascension, de disparaître un à un d’un saut dans le vide, silencieux – sortie aussi poignante que l’entrée initiale de Saïd. Grâce à ce finale, ils retrouvent leur nature fantomatique de pantins qui se sont prêtés à une cérémonie funèbre, qui ont fait du théâtre un cimetière où se côtoient indistinctement les vivants et les morts pour nous adresser des questions existentielles.
F.
Pour en savoir plus sur « Les Paravents », rendez-vous sur le site du Théâtre de l’Odéon.