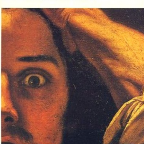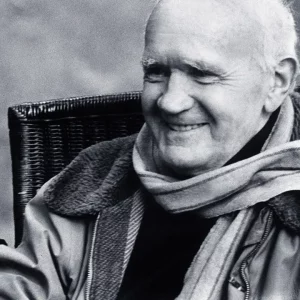Dostoïevski se représente le destin du monde dans le médium que lui offre le destin de son peuple. C’est l’approche typique des grands nationalistes, pour qui l’humanité ne peut se développer qu’à travers le médium de la communauté populaire. La grandeur du roman se manifeste dans le rapport de dépendance réciproque et absolue selon lequel sont décrites les lois métaphysiques qui régissent le développement de l’humanité et celui de la nation. Il n’est par conséquent aucun mouvement de la vie humaine profonde qui ne trouve son lieu décisif dans l’aura de l’esprit russe. Représenter ce mouvement humain au sein de son aura, flottant libre et dégagé dans l’élément national, et pourtant inséparable de lui comme de son lieu propre, telle est peut-être la quintessence de la liberté dans le grand art de cet écrivain. Il suffit, pour s’en convaincre, de prendre conscience de l’effroyable rapiéçage dont se compose tant bien que mal le personnage romanesque de genre inférieur. Celui-ci résulte d’un collage puéril où se mêlent la Personne nationale, la figure locale, la personne individuelle et la personne sociale, sur quoi l’on plaque, pour compléter le mannequin, la répugnante croûte des données psychologiquement palpables. La psychologie des personnages de Dostoïevski, au contraire, ne constitue nullement le point de départ réel de l’écrivain. Elle n’est en quelque sorte que la sphère délicate où s’enflamme le gaz primitif de l’élément national, produisant au passage la pure humanité. La psychologie est seulement l’expression les états limites de l’existence humaine. Ce qui dans le cerveau de nos critiques apparaît comme un problème psychologique est en réalité tout autre chose, car il ne s’agit pas plus de la «psyché » russe, que de celle de l’épileptique. La critique ne justifie son droit d’aborder l’œuvre d’art que pour autant qu’elle respecte le territoire propre à cette œuvre et se garde d’y pénétrer. Or c’est impudemment transgresser cette frontière que de louer un auteur pour la psychologie de ses personnages, et critiques et auteurs ne sont le plus souvent dignes les uns des autres qu’en ce que le romancier moyen use de ces clichés éculés auxquels ensuite la critique peut donner un nom et que, justement parce qu’elle peut leur donner un nom, elle couvre aussi d’éloges. Telle est précisément la sphère dont la critique doit s’écarter ; il serait honteux et faux de mesurer l’œuvre de Dostoïevski à l’aune de pareilles notions. Il s’agit au contraire de saisir l’identité métaphysique que l’élément national ainsi que l’élément humain acquièrent dans l’idée de la création dostoïevskienne.
Car ce roman, comme toute œuvre d’art, repose sur une idée : selon le mot de Novalis, il contient « un idéal a priori, une nécessité d’exister ! ». Mettre en lumière cette nécessité, voilà l’unique tâche de la critique. Ce qui confère à toute l’intrigue du roman son caractère fondamental, c’est d’être un épisode. Un épisode dans la vie du personnage principal prince Mychkine. Sa vie avant et après cet épisode reste pour l’essentiel plongée dans l’ombre, en ce sens aussi qu’il séjourne à l’étranger pendant années qui précèdent et qui suivent immédiatement l’action. Quelle nécessité conduit cet homme en Russie ? De la période obscure passée à l’étranger, sa vie en Russie se détache comme la bande visible du spectre surgit du noir. Mais quelle est la lumière qui se décompose durant cette époque russe? En dehors des multiples erreurs et des diverses vertus qui caractérisent la conduite du prince, on ne saurait dire ce qu’il entreprend au juste pendant cette période. Sa vie s’écoule vainement et, jusque dans ses meilleurs moments, ressemble à celle d’un malade impotent. Elle n’est pas seulement un échec au regard des normes sociales, même l’ami le plus proche – si toute l’histoire ne tendait fondamentalement à démontrer qu’il n’a pas d’ami – ne pourrait y trouver une idée ou un but directeur. Sans qu’on y prenne vraiment garde, il est plongé dans la plus totale solitude : toutes les relations dans lesquelles il est impliqué semblent bientôt tomber dans le champ d’une force qui interdit l’approche. Cet être, malgré sa parfaite modestie, son humilité même, reste absolument inabordable, et de sa vie rayonne un ordre qui a justement pour centre sa propre solitude, mûrie au point de se dissoudre sous le regard. Ce qui entraîne effectivement quelque chose de tout à fait singulier : tous les événements, à quelque distance qu’ils se déroulent, sont attirés vers lui par gravitation, et cette gravitation de toutes les choses et de tous les êtres vers un seul, voilà ce qui fait le contenu de ce livre. Ils sont cependant aussi peu enclins à l’atteindre que lui à leur échapper. La tension est pour ainsi dire simple et inextinguible, c’est la tension de la vie qui toujours plus tumultueusement se déploie à l’infini et pourtant ne tombe pas en déliquescence. Pourquoi les événements qui se déroulent à Pavlovsk ont-ils pour théâtre central la maison du prince, et non celle des Epantchine ?
Si la vie du prince Mychkine se présente sous forme d’épisode, c’est seulement pour manifester symboliquement l’immortalité de cette vie. Sa vie ne peut en effet s’éteindre, tout aussi peu – non : encore moins que la vie naturelle elle-même, avec laquelle elle entretient néanmoins un profond rapport. Il se peut que la nature soit éternelle, mais il est tout à fait sûr que la vie du prince est – en un sens intérieur et spirituel – immortelle. Sa vie, comme celle de tous ceux qui gravitent vers lui. La vie immortelle n’est pas la vie éternelle de la nature, en dépit de leur apparente proximité, car l’idée d’éternité abolit l’infinité qui, dans l’immortalité, acquiert au contraire son éclat suprême. La vie immortelle dont témoigne ce roman n’est rien moins que l’immortalité au sens courant du terme. Car en celle-ci, la vie justement est mortelle, mais immortels sont la chair, la force, la personne, l’esprit sous leurs formes diverses. Goethe évoquait ainsi une immortalité de l’homme actif, quand il disait à Eckermann que la nature a le devoir de nous procurer un nouveau champ d’action lorsque celui-ci nous sera enlevé. Tout cela est très éloigné de l’immortalité de la vie, très éloigné de cette vie qui répercute à l’infini son immortalité dans le sens, et à laquelle l’immortalité donne forme. Car il n’est pas question ici de durée. Mais quelle vie alors est immortelle, si ce n’est celle de la nature, ni celle de la personne? Du prince Mychkine on peut dire au contraire que sa personne s’efface derrière sa vie comme la fleur derrière son parfum ou l’étoile derrière son scintillement. La vie immortelle est inoubliable, tel est le signe auquel nous la reconnaissons. C’est la vie qui, sans mémorial, sans souvenir, peut-être même sans témoignage, échapperait nécessairement à l’oubli. Elle est impossible à oublier. Pour ainsi dire sans forme ni contenant, cette vie est ce qui ne passe point. Et la dire « inoubliable», ce n’est pas dire seulement que nous ne pouvons l’oublier ; c’est renvoyer à quelque chose dans l’essence de l’inoubliable, par quoi il est inoubliable. Même la perte de mémoire du prince au cours de sa maladie ultérieure est le symbole du caractère inoubliable de sa vie ; car cela, semble-t-il, a désormais sombré dans l’abîme de son auto-commémoration, et n’en remontera plus. Les autres viennent lui rendre visite. La brève conclusion du roman marque tous les personnages, pour toujours, du sceau de cette vie à laquelle ils ont été mêlés, sans savoir comment.
Mais le pur mot pour exprimer la vie en son immortalité, c’est : « jeunesse ». Telle est la grande plainte de Dostoïevski dans ce livre : l’échec du mouvement de la jeunesse. Sa vie demeure immortelle, mais elle se perd dans sa propre lumière : « l’idiot». Dostoïevski déplore que la Russie ne soit pas capable de retenir sa propre vie immortelle – car ces êtres portent en eux le cœur juvénile de la Russie – ne sache pas s’en imprégner. Elle tombe sur un soi étranger, elle déborde et s’ensable en Europe, « dans cette Europe écervelée ». De même que Dostoïevski, comme penseur politique, place toujours son ultime espoir dans une régénération au sein de la pure communauté populaire, le romancier de L’Idiot voit dans l’enfant le seul salut pour ces jeunes et leur pays. C’est ce que ce livre, dont les figures les plus pures sont les natures enfantines de Kolia et du prince, suffirait à établir, même si Dostoïevski n’avait développé dans Les Frères Karamazov l’infinie puissance salvatrice de la vie enfantine. Cette jeunesse souffre d’une enfance blessée, parce que c’est précisément l’enfance blessée de l’homme russe et du pays russe qui a paralysé sa force. On retrouve toujours chez Dostoïevski l’idée que l’esprit de l’enfant est le seul endroit où la vie humaine, sortie de la vie du peuple, parvient à s’épanouir noblement. Sur le langage qui fait défaut à l’enfant se décompose pour ainsi dire la parole de l’homme dostoïevskien, et c’est d’abord dans une nostalgie exacerbée de l’enfance – qu’on appellerait aujourd’hui hystérie – que se consument les personnages féminins de ce roman : Lisaviéta Prokofievna, Aglaia et Nastassia Philippovna. Tout le mouvement du livre s’apparente à l’effondrement formidable d’un cratère. À défaut de nature et d’enfance, l’humanité ne peut être réalisée que dans une catastrophe où elle s’anéantit elle-même. La relation qui unit la vie humaine à l’être vivant jusque dans sa disparition, l’insondable abîme du cratère d’où pourraient un jour se décharger de puissantes forces empreintes de grandeur humaine, telle est l’espérance du peuple russe.
Texte écrit dans l’été 1917, publié dans la revue Die Argonauten en 1921 (Première série, n°10-12).
Traduit de l’allemand par Maurice de Gandillac, Rainer Rochlitz et Pierre Rusch.