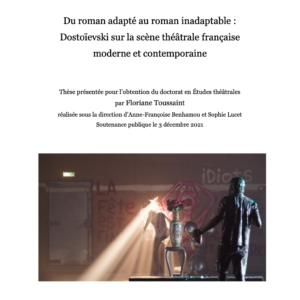En 2016, Lionel González créait Demain tout sera fini, adaptation du Joueur de Dostoïevski. Ce printemps, il présente La Nuit sera blanche au TGP. Une adaptation non pas des Nuits blanches, mais de La Douce, troisième nouvelle du même auteur. Ce changement de titre crée un effet de juxtaposition pour les connaisseurs de Dostoïevski, un léger déplacement qui provoque en amont du spectacle la rencontre de deux textes, aussi denses et énigmatiques l’un que l’autre malgré la simplicité des situations qu’ils décrivent. Ce titre est cependant avant tout une donnée temporelle sous forme de déclaration, comme pour le précédent spectacle : l’une annonce un geste ultime, l’autre un temps de veille étiré. Le public est en effet invité à veiller avec un homme qui monologue face au corps de sa femme suicidée, et qui tente de répondre à la question : « Pourquoi ? ».

Les spectateurs du TGP sont emmenés jusqu’au « Terrier », une salle au plafond bas située sous la grande scène du théâtre, transformée en lieu de représentation par la simple présence de gradins noirs. Pour le reste, elle n’a pas été apprêtée, elle a l’allure d’un sous-sol ponctué de poteaux et de colonnes, au sol et aux murs un peu décrépis. Cet espace, qui sert parfois de lieu de rencontre, constitue d’emblée un décor, il inscrit directement dans un lieu habité. Cette impression est nourrie par la scénographie de Lisa Navarro, qui a dispersé dans ses recoins un lit en métal, quelques chaises, et au fond, à l’arrière-plan, quelques ustensiles de cuisine pendus au mur, des bassines, des seaux, des casseroles et des linges. Après une appréhension d’ensemble, l’œil est capté par quelques icônes russes ici est là, qui apparaissent comme des objets précieux au milieu de ce quotidien sommaire. À cour, se trouve un mélange composite d’instruments et objets (frigidaire, téléphone, saladiers en métal), qui apparaît d’emblée comme un terrain de jeu pour un musicien percussionniste, encore absent.
Un homme seul – Lionel González lui-même – nous accueille, et accompagne de son regard notre installation dans la salle. D’un geste, il nous invite à occuper l’ensemble des gradins, s’assurant que tout le monde est bien installé. Il se tient là en tant qu’acteur, soucieux du public venu le voir. La porte du terrier se referme et c’est comme si on tombait dans celui du lapin blanc d’Alice au pays des merveilles. D’un coup, l’acteur n’est plus acteur mais personnage, un personnage soudainement abattu, à la voix tremblante, à peine capable d’aller au bout de ses phrases. Il indique se trouver face à un corps qu’il voudrait garder près de lui pour ne plus être seul – alors que cela ne fait que quelques heures que sa femme est morte. Les bribes de son discours sont complétées par une indication écrite à même le mur à côté duquel il se trouve : « Figurez-vous un mari dont la femme, une suicidée qui s’est jetée par la fenêtre il y a quelques heures, gît devant lui sur une table ». La phrase est extraite de la « Note d’auteur » qui accompagne la nouvelle, dans laquelle Dostoïevski explique qu’un homme cherche à comprendre le geste de sa femme au travers d’un discours désordonné, confus, dans lequel on trouve « dans le même moment, la grossièreté des pensées et du cœur et une émotion très profonde ». Ce discours reproduit sur un mode sténographique s’adresse à « un auditeur invisible, une espèce de juge », conditions de narration que Dostoïevski qualifie de fantastiques.

Le théâtre atténue cette dimension fantastique : l’écriture sténographique devient parole vive, la versatilité des affects qui traversent le narrateur retrouvent un mode présent, immédiat. Mais le fantastique se déplace car l’adresse devient directe, l’auditeur, l’espèce de juge que désigne Dostoïevski est incarné par le public, que l’homme regarde, à qui il parle. Au gré d’une parole tortueuse, dense, contradictoire, le personnage nous constitue en témoins, en confidents, en jurés, en assemblée invitée dans sa maison quelques heures après le drame. La situation est invraisemblable, fantastique, mais elle rend le dialogue possible – ou plutôt le monologue.
Ce monologue commence avec une émotion profonde, qui paraît arriver trop vite, trop fort, qui met un peu mal à l’aise et paraît une fausse piste un peu dangereuse. Les premières phrases, en forçant l’empathie, en convoquant le pathos à gros sabots, créent un léger mouvement de recul, alors que la découverte du lieu et l’accueil de l’acteur engageaient vers la scène. L’émotion est étirée un instant, puis le discours bascule. L’homme entreprend de répondre à la question pourquoi, de mettre en récit l’expérience traumatique, et la préoccupation du récit l’emporte sur le traumatisme. Il nous met en garde : « comment ça va sortir », de sa bouche, ça ne va pas forcément être très beau ni très clair, mais peu importe. Si l’on veut bien, il va revenir au « début » – mais aussitôt, il rit, car il n’est pas simple de déterminer le début de cette histoire. Le désespoir s’éloigne, l’émotion est mise en déroute par sa maladresse de narrateur, alors que quelques secondes auparavant il était un mari abattu. Quand il entreprend de se présenter, qu’il annonce qu’il est prêteur sur gages, et qu’il précise qu’à son époque, « il y a cent cinquante ans », ce métier était le pire des métiers, qu’il était réservé à la lie de l’humanité, alors qu’aujourd’hui, ceux qui prêtent de l’argent en échange d’intérêts sont plutôt bien vus, le fantastique s’accroît. Le personnage se montre conscient du temps qui nous sépare de lui. Cette précision révèle plus encore le travail d’appropriation du texte que Lionel González a mené. Non pas un travail d’oralisation – l’écriture de Dostoïevski, surtout dans la traduction d’André Markowicz, est déjà porteuse d’une voix. Un travail d’approche du texte, par des précisions, de discrètes transpositions, et plus encore un travail de prolongation, pour suivre au plus près les mouvements impétueux des pensées et des sentiments condensés dans les phrases.

Ce travail de virtuose donne lieu à un jeu extrêmement intense. L’écriture sténographique de Dostoïevski prend vie grâce à un jeu sismographique. L’acteur, loin de lisser les phrases, en suit les oscillations permanentes et passe de l’émotion au rire, de la colère au détachement, de la sincérité à la feinte. Ces variations parfois extrêmes font percevoir la mauvaise foi de ce personnage, celle que révèle de manière éclatante plusieurs des épisodes qu’il raconte, mais de manière plus insidieuse et continue sa façon de raconter. Lionel González nous montre comment ce personnage ment, à nous mais surtout à lui-même, le caractère pervers de ses aveux lorsqu’il admet grossir les faits ou les modifier, emporté par son récit. Sa confession n’est pas un mea culpa repentant. Comme le narrateur du sous-sol et d’autres personnages de Dostoïevski, celui-là trouve un plaisir croissant à se montrer sous son jour le plus repoussant. Cette mise à nu complaisante fait à plusieurs reprises rire. Quand il nous demande de lui jeter des pierres s’il ne nous est jamais arrivé de tirer profit d’une situation, de la tourner à notre avantage, le rire reste cependant en suspens, le reflet qu’il nous renvoie nous arrête – mais un moment seulement, car sa parole intarissable nous embarque ailleurs.
La mauvaise foi de ce personnage est plus flagrante encore dans son entreprise elle-même. Pour comprendre pourquoi sa femme s’est suicidée, il retrace leur histoire, depuis le moment où elle est entrée dans sa boutique pour déposer un objet en gage. Cette grande rétrospective n’a pas pour but de sonder sa femme, mais d’exposer son point de vue, de retracer tout ce qu’il a fait et pensé, toutes ses manipulations, tous ses coups bas et tous les gestes qu’il a voulu nobles. Après le long silence qu’a été leur mariage – silence pesant magistralement rendu à l’écran par Robert Bresson dans Une femme douce –, un flux de parole le submerge, qui ne laisse aucune place à l’écoute de la suicidée, de ses mouvements, de ses quelques mots, de ses silences. Ce monologue n’offre pas le spectacle d’un homme qui cherche sa part de culpabilité dans le décès de sa femme, mais celui d’un homme qui saisit cette occasion pour justifier à la face du monde sa bassesse et son orgueil, causés par une humiliation qu’il a subie dans sa jeunesse. Ce récit à double révolution donne plusieurs fois l’impression de s’approcher de la vérité, de donner la réponse au pourquoi initial, mais en définitive il tourne autour, multiplie les raisons possibles de cette mort sans en donner une, et finit surtout par dresser le portrait d’un être abject, mais qui se met si sincèrement à nu qu’il en vient à toucher, à paraître parfois même sympathique.

La performance de Lionel González est saisissante. Son jeu est minimal : il se tient debout ou assis, face à nous, il passe d’une chaise à l’autre pour marquer les étapes de son récit, se tourne parfois vers une icône, mange un peu, touche sa barbe, lève les bras, pointe du doigt… trois fois rien. Pourtant, il hypnotise, son visage devient une surface réfléchissante qui révèle tout ce qui traverse son personnage. L’acteur épouse tout entier les fluctuations de cette écriture singulière, particulièrement sinueuse dans cette nouvelle, par les raisonnements à double fond et attitudes fausses qu’elle décrit. Il suffit amplement à lui seul, le poids du seul en scène – qui paraît toujours une facilité quand des récits courts comme celui-là sont adaptés à la scène –, ne pèse pas grâce à l’ample travail d’appropriation mené en amont et poursuivi devant nous.
Lionel González fait pourtant le choix de s’entourer de deux autres artistes : Jeanne Candel, au loin, qui incarne la domestique Loukeria, et Thibault Perriard, à cour, au milieu de son atelier sonore. L’un et l’autre ne se cantonnent pas à la place d’arrière-plan, de paysage, qui leur revient. La scénographie, discrète et minutieuse, offre à l’écoute la possibilité de vagabonder quand il devient trop accaparant de s’attacher au seul acteur. Les présences qui l’occupent produisent en revanche des effets d’interférence. Loukeria a un corps trop jeune et trop dynamique, qui risque de servir de support à celui de la femme morte, même si le narrateur signale d’emblée son identité et la met à distance. Tout au long du récit, elle s’active au fond du sous-sol, elle prépare une soupe dont l’odeur – d’oignon, de chou, de betterave – produit un effet puissant. Mis à part le moment où elle nettoie le sang de la suicidée, ses actions anodines ne devraient pas attirer l’attention, laisser le choix, d’être ou non observées. À plusieurs reprises, quand elle allume une cigarette, quand elle se retire dans ce qui semble un espace de prière plus loin encore, au-delà d’une porte, ou quand elle verse de l’eau dans un seau, nous sommes détournés de l’acteur contre notre gré. Il aurait fallu une domestique qui veut se faire oublier, réduire sa présence à néant, sur laquelle projeter le silence de la femme morte.
 Il en va de même pour la musique de Thibault Perriard. Sa présence ne s’impose pas tant par l’ampleur de son installation que par le caractère expérimental des sons qu’il explore, qui, à nouveau, interpellent et éloignent du récit. Le musicien passe d’un extrême à l’autre, de sons figuratifs un peu bateau à des sons abstraits qui saisissent l’écoute. Entre les deux, le juste degré d’intensité est parfois trouvé, la musique accompagne le récit, en creuse la perception, devient enfin paysage sonore. Ces deux présences sur scène amènent à réfléchir à l’art de l’arrière-plan, font prendre conscience de l’humilité, de la finesse, de l’équilibre qu’il exige. Lionel González voulait que ses compagnons hantent la scène. Ils l’habitent cependant trop pesamment, alors que c’est en effet de spectres dont il aurait fallu s’entourer pour accompagner la veille du corps mort de son personnage.
Il en va de même pour la musique de Thibault Perriard. Sa présence ne s’impose pas tant par l’ampleur de son installation que par le caractère expérimental des sons qu’il explore, qui, à nouveau, interpellent et éloignent du récit. Le musicien passe d’un extrême à l’autre, de sons figuratifs un peu bateau à des sons abstraits qui saisissent l’écoute. Entre les deux, le juste degré d’intensité est parfois trouvé, la musique accompagne le récit, en creuse la perception, devient enfin paysage sonore. Ces deux présences sur scène amènent à réfléchir à l’art de l’arrière-plan, font prendre conscience de l’humilité, de la finesse, de l’équilibre qu’il exige. Lionel González voulait que ses compagnons hantent la scène. Ils l’habitent cependant trop pesamment, alors que c’est en effet de spectres dont il aurait fallu s’entourer pour accompagner la veille du corps mort de son personnage.
Malgré ces réserves, reste une traversée, ou plutôt une plongée fascinante dans un texte très mystérieux de Dostoïevski, où l’énigme principale reste entière, car plutôt que d’écouter la seule qui pourrait répondre à la question pourquoi, le personnage entreprend de décortiquer l’énigme que lui-même a essayé d’être, par jeu ou par orgueil, parce qu’il se sent humilité d’être considéré comme un cafard alors qu’il croit encore à sa grandeur d’âme, ou encore pour revendiquer sa liberté et mettre en échec les schémas dans lesquels il se sent prisonnier. Ce spectacle confirme l’intérêt puissant que constitue l’écriture de Dostoïevski pour le jeu d’acteur, la souplesse extraordinaire qu’elle exige pour en faire comprendre toutes les strates et les nuances, et, pour le spectateur, l’introspection décuplée que l’incarnation permet, les multiples pensées qu’elle convoque au rythme – trop rapide, trop dense, mais pour cette raison bouleversant – de la scène.
F.
Pour en savoir plus sur « La Nuit sera blanche », rendez-vous sur le site du TGP.