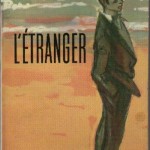L’Enfant brûlé est l’un des quatre romans de l’auteur suédois Stig Dagerman, dont l’œuvre la plus connue est un essai sur le suicide qui précède de deux ans celui de l’auteur à 31 ans : « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier ». L’Enfant brûlé peut se lire comme une illustration de ce titre poignant, en ce qu’il relate le difficile travail de deuil d’un jeune homme après le décès de sa mère, et les relations conflictuelles que cette situation engendre avec son père, avec sa fiancée, et avec la nouvelle amante de son père. Son besoin de consolation incommensurable, Bengt l’assouvit par la haine, la sournoiserie, la passion et la pensée du suicide. Tout au long d’une année, sont ainsi disséquées les étapes du deuil d’un jeune garçon en pleine formation morale et émotionnelle.
 L’œuvre commence avec une radicalité comparable à celle de L’Étranger, paru six ans plus tôt : « On enterre une femme à deux heures, et à onze heures et demie, le mari est dans la cuisine, devant le miroir fendu, accroché au-dessus de l’évier ». Il s’agit peut-être là de la phrase la plus longue de tout le roman, pour le reste composé de phrases courtes, lapidaires, d’une simplicité syntaxique d’autant plus percutante qu’elles s’efforcent de sonder les états d’âme des personnages. Une femme est morte, donc, et la narration immerge dans son appartement, le jour de son enterrement, alors que s’affairent son mari, son fils et deux tantes. L’empressement, la tristesse, la gêne, l’irritation s’expriment dans les silences, les gestes, les paroles lacunaires, l’environnement sonore qui structure l’espace. La scène gagne en ampleur quand les invités arrivent et que tous partent à la cérémonie funéraire en voiture. S’ensuivent le récit de la mise en terre et d’un dîner au restaurant, récit profondément comique qui s’attache à dépeindre la mesquinerie des invités en même temps que le désarroi du fils.
L’œuvre commence avec une radicalité comparable à celle de L’Étranger, paru six ans plus tôt : « On enterre une femme à deux heures, et à onze heures et demie, le mari est dans la cuisine, devant le miroir fendu, accroché au-dessus de l’évier ». Il s’agit peut-être là de la phrase la plus longue de tout le roman, pour le reste composé de phrases courtes, lapidaires, d’une simplicité syntaxique d’autant plus percutante qu’elles s’efforcent de sonder les états d’âme des personnages. Une femme est morte, donc, et la narration immerge dans son appartement, le jour de son enterrement, alors que s’affairent son mari, son fils et deux tantes. L’empressement, la tristesse, la gêne, l’irritation s’expriment dans les silences, les gestes, les paroles lacunaires, l’environnement sonore qui structure l’espace. La scène gagne en ampleur quand les invités arrivent et que tous partent à la cérémonie funéraire en voiture. S’ensuivent le récit de la mise en terre et d’un dîner au restaurant, récit profondément comique qui s’attache à dépeindre la mesquinerie des invités en même temps que le désarroi du fils.
Le premier chapitre du roman constitue une œuvre à lui seul. Les personnages et le rythme de la narration embarquent, projettent dans un univers esquissé au travers de quelques objets seulement mais nettement délimité, dans lesquelles des relations complexes charrient des sentiments contradictoires. La dimension tout à la fois tragique et satirique de la scène est réjouissante. On ne sait qu’attendre pour la suite, mais le ravissement opère. In extremis, ce chapitre qui pourrait s’apparenter une nouvelle s’ouvre avec un coup de téléphone, à la fin du repas. Une voix de femme qui croit parler à Knut, le père, parle à Bengt, le fils. Ce dernier devine aussitôt une liaison, qui explique après coup pourquoi le père n’a pas pleuré la mère. Une haine terrible saisit le fils, comparable à celle d’Hamlet pour son oncle et sa mère. Cette haine à l’origine d’une brûlure à la bougie allumée sur la table en l’honneur de la morte – brûlure qui donne aussitôt sens au titre de l’œuvre –, cette haine grandit la mère, l’élève dans un mouvement œdipien à un rang intouchable et inspire à Bengt un idéal de pureté qui le rend intraitable.
 Après ce maëlstrom de personnages, d’actions et de sentiments, le deuxième chapitre prend la forme d’une lettre. Une lettre de Bengt, adressée à lui-même, suivant le conseil de feu sa mère : quand tu es triste, adresse-toi une lettre pour atténuer ta tristesse. Bengt s’écrit donc, se relate l’enterrement un mois plus tard, la relation de son père avec la femme avec qui il a parlé au téléphone, Gun, se pose des questions sur elle et sur sa mère, et interroge la haine insurmontable pour son père dont il n’arrive pas à se défaire. Bengt exprime dans cette lettre une fidélité post mortem à sa mère qui le rend intransigeant et le fait adopter une vision binaire du monde, où le bien et le mal sont très nettement délimités. Par la suite, il se débattra avec cette morale absolutiste qui lui fera renoncer à ses études pour consacrer ses journées à l’espionnage de son père et son amante, avant de soumettre les autres à son exigence par des coups.
Après ce maëlstrom de personnages, d’actions et de sentiments, le deuxième chapitre prend la forme d’une lettre. Une lettre de Bengt, adressée à lui-même, suivant le conseil de feu sa mère : quand tu es triste, adresse-toi une lettre pour atténuer ta tristesse. Bengt s’écrit donc, se relate l’enterrement un mois plus tard, la relation de son père avec la femme avec qui il a parlé au téléphone, Gun, se pose des questions sur elle et sur sa mère, et interroge la haine insurmontable pour son père dont il n’arrive pas à se défaire. Bengt exprime dans cette lettre une fidélité post mortem à sa mère qui le rend intransigeant et le fait adopter une vision binaire du monde, où le bien et le mal sont très nettement délimités. Par la suite, il se débattra avec cette morale absolutiste qui lui fera renoncer à ses études pour consacrer ses journées à l’espionnage de son père et son amante, avant de soumettre les autres à son exigence par des coups.
La lettre de Bengt à lui-même sert de transition à un changement d’échelle radicale : de la fresque sociale cocasse que la situation de l’enterrement entraîne, aux traits délicieusement sarcastiques – qui annoncent les œuvres à venir de Thomas Bernhard, et notamment la scène d’enterrement de Joana dans Des arbres à abattre – au huis clos de l’appartement du père et du fils. Disparaissent les invités rapaces, mais aussi les tantes, binôme complémentaire puissamment comique, une fois que le père a vidé l’armoire d’habits de la défunte. Se substitue à cette présence féminine Bérit, la fiancée de Bengt, et progressivement Gun, que le père impose à son fils. Le roman se réduit alors radicalement à ce quatuor – et son excroissance, le chien de Gun –, quatuor qui se forme et se déforme au gré des mois et des lettres qui s’intercalent entre chaque chapitre, qui parfois laissent entrevoir des creux dans le récit, des événements manquants rapportés de manière incidente. Deux séjours sur des îles, dans des maisons retirées de la ville où les personnages se baignent et font de la barque, dans un cadre typiquement nordique qui évoque les pièces d’Ibsen, se révèlent particulièrement déterminants dans la peinture des sentiments contradictoires qui les poussent les uns vers les autres ou les repoussent loin les uns des autres.
 Ces quatre-là se torturent et s’aiment. La précision première, posée d’entrée de jeu, est constamment tenue. Les courtes phrases décortiquent les moindres mouvements du cœur de Bengt, dans la lignée de ses lettres qui s’efforcent à une autoanalyse aussi précise que pragmatique, qu’elles soient adressées à lui-même, ou, progressivement, à l’un des autres membres du quatuor. Ce style fascinant, qui réduit le monde alentour à quelques détails seulement, qu’il s’agisse du monde quotidien des personnages ou de la Seconde guerre mondiale et du nazisme, évoqués au détour d’une unique phrase, se révèle capable de rendre compte des moindres pensées.
Ces quatre-là se torturent et s’aiment. La précision première, posée d’entrée de jeu, est constamment tenue. Les courtes phrases décortiquent les moindres mouvements du cœur de Bengt, dans la lignée de ses lettres qui s’efforcent à une autoanalyse aussi précise que pragmatique, qu’elles soient adressées à lui-même, ou, progressivement, à l’un des autres membres du quatuor. Ce style fascinant, qui réduit le monde alentour à quelques détails seulement, qu’il s’agisse du monde quotidien des personnages ou de la Seconde guerre mondiale et du nazisme, évoqués au détour d’une unique phrase, se révèle capable de rendre compte des moindres pensées.
L’analyse apparaît pour Bengt une arme pour la conscience et pour la morale. Cependant, il s’y adonne avec tant d’énergie qu’il découvre des pensées qui trahissent des sentiments inacceptables et l’obligent à une honnêteté qui va à l’encontre de sa morale. Tandis qu’opère le lent travail de décristallisation de la mère nécessaire à son deuil, par à-coups de souvenirs qui révèlent ses défauts, Bengt se retrouve à admettre des sentiments incompatibles alors que le submergent des bouffées d’amour et de haine, et à négocier avec lui-même des accommodements successifs avec sa propre morale qui le rapprochent du père haï. Ce style incisif s’enrichit en outre d’images puissantes : celle du feu et de la flamme qui brûle, filée d’un bout à l’autre de l’œuvre ; celle de l’heure qui rejoue chaque jour celle de la mort de la mère ; celle du chien, littérale ou métaphorique, ou les deux à la fois ; celle d’une robe rouge, symbole de trahison ou de désir ; celles de parties du corps disloquées par le sommeil et le rêve, qui permet un transfert de la mère à la belle-mère ; celle du tigre, quand le jeune homme est terrassé par le démon de la jalousie.
Il y a cependant quelque chose d’insupportable dans cette œuvre, qui ne paraît pas seulement imputable à son époque : sa misogynie qui paraît caricaturale, et qui repose sur une conception dramatiquement patriarcale des relations entre hommes et femmes. Bengt n’est pas seulement odieux à l’égard de son père, auquel il ne cesse de rappeler le souvenir de la mère. Il l’est plus encore à l’égard de sa fiancée, qu’il maltraite, méprise et trompe, et à l’égard de Gun, qu’il aime passionnément le temps d’une courte saison, avant de la blesser, littéralement. Les libertés que prend son père avec sa fiancée, dans ses gestes, ses phrases, ne valent pas mieux. Les violences verbales et physiques qui ponctuent le récit paraissent insupportables et entament considérablement l’empathie que pouvait au départ susciter Bengt, aussi radical paraissait-il d’emblée dans sa quête de pureté. Le travail de deuil prend la forme d’une surenchère de violence, que Bengt finit par exercer contre lui-même à défaut de parvenir à meurtrir les autres, qui encaissent silencieusement les coups. Cette escalade crée un hiatus profond dans l’expérience de la lecture, que creuse le temps qui passe. L’irritation que suscite certains passages, certaines attitudes, certains détails, qui ne paraît pas recherchée par l’auteur, entre dès lors en conflit avec des phrases remarquables de force et de beauté, et des scènes puissantes et mémorables.
F.