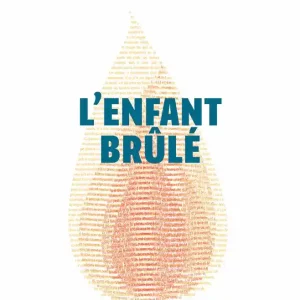Une artiste a fait irruption dans le paysage théâtral : Noëmie Ksicova. En 2020, elle crée Loss au Phénix de Valenciennes, dont elle signe la conception et la mise en scène, et suit une trajectoire fulgurante : avec ce premier spectacle, elle passe à la MAC d’Amiens, au Off d’Avignon, au Festival Impatience, et poursuit une tournée tout au long de l’année 2023. Sur la base de cet unique spectacle, la Comédie de Reims et l’Odéon se sont engagés sur sa prochaine création, L’Enfant brûlé. Les thématiques sont communes – l’adolescence, le suicide, la cellule familiale –, mais Noëmie Ksicova part cette fois d’un matériau existant : un roman de Stig Dagerman mal connu, dont elle annonce une « libre adaptation » – mais qui porte le même titre que l’œuvre. L’artiste embarque avec elle les partenaires de la première aventure, dont deux jeunes qui n’ont joué qu’avec elle, et se lance dans cette ambitieuse entreprise, assumant l’ambition, mais un peu moins le pas de côté qu’elle fait par rapport à l’œuvre qui l’inspire.
 La scène et la salle plongées dans le noir, retentissent deux voix : celle d’une mère et de son enfant, au moment du coucher. L’enfant, facétieux, peine à laisser partir sa mère et la retient par des câlins ou des remarques aussi incongrues que pleines de bon sens. Le dialogue, tendre, plutôt amusant, propose comme seuil à l’œuvre de Stig Dagerman une relation mère-fils qui sublime la relation de Bengt avec sa mère, alors que le roman rendra au contraire compte d’un processus de décristallisation qui permettra au jeune homme orphelin de progresser dans le travail de deuil. La scène est enfin éclairée et une voix off de femme lance la narration : « On enterre une femme à deux heures… ». Mais aussitôt, on passe du père au fils, les premières pages sont ramenées à quelques phrases, tandis qu’on voit l’image muette du fils en question qui lit un éloge funéraire sous la neige, avant de déchiqueter son papier au-dessus de la tombe, précédant le père et une jeune fille qui jettent une poignée de terre – réminiscence de l’Hamlet d’Ostermeier, éloquente. Du premier chapitre de l’œuvre, aussi émouvant que drôle dans le récit effectué de l’enterrement de la mère, ne reste que l’essentiel – nécessité du théâtre oblige. Disparaissent cependant deux chevilles narratives cruciales : la scène qui donne son sens au titre de l’œuvre et du spectacle, durant laquelle Bengt se brûle à la bougie allumée en hommage à la morte, et le coup de téléphone qui fait de cette fin un début : celui de l’amante du père.
La scène et la salle plongées dans le noir, retentissent deux voix : celle d’une mère et de son enfant, au moment du coucher. L’enfant, facétieux, peine à laisser partir sa mère et la retient par des câlins ou des remarques aussi incongrues que pleines de bon sens. Le dialogue, tendre, plutôt amusant, propose comme seuil à l’œuvre de Stig Dagerman une relation mère-fils qui sublime la relation de Bengt avec sa mère, alors que le roman rendra au contraire compte d’un processus de décristallisation qui permettra au jeune homme orphelin de progresser dans le travail de deuil. La scène est enfin éclairée et une voix off de femme lance la narration : « On enterre une femme à deux heures… ». Mais aussitôt, on passe du père au fils, les premières pages sont ramenées à quelques phrases, tandis qu’on voit l’image muette du fils en question qui lit un éloge funéraire sous la neige, avant de déchiqueter son papier au-dessus de la tombe, précédant le père et une jeune fille qui jettent une poignée de terre – réminiscence de l’Hamlet d’Ostermeier, éloquente. Du premier chapitre de l’œuvre, aussi émouvant que drôle dans le récit effectué de l’enterrement de la mère, ne reste que l’essentiel – nécessité du théâtre oblige. Disparaissent cependant deux chevilles narratives cruciales : la scène qui donne son sens au titre de l’œuvre et du spectacle, durant laquelle Bengt se brûle à la bougie allumée en hommage à la morte, et le coup de téléphone qui fait de cette fin un début : celui de l’amante du père.
D’emblée, la metteuse en scène pose le roman par la narration restituée en off, mais prend ses distances avec lui : il s’agira de raconter autrement qu’avec les longues descriptions de Dagerman les différentes étapes du deuil d’un jeune homme et de sa formation morale et émotionnelle. Après la courte scène d’enterrement, la bâche noire qui fermait l’espace, le réduisait à une bande étroite prise entre deux pans de murs percés de fenêtres et soutenus par des châssis, s’abat et découvre un intérieur net. Il s’agit de la pièce à vivre de Bengt et son père Knut, où ils partagent des repas, peinent à se parler et à partager leur tristesse, se croisent. Autour de la table centrale, se trouvent un lit sur le côté, avec une photo de la mère, une commode avec un téléphone, une porte qui mène à une chambre, un rideau à une autre, une entrée et un coin cuisine masqué dans l’angle de la pièce. Des analyses fouillées de Dagerman, restent des dialogues, plutôt laconiques. Sont en revanches restituées en grande parties les lettres que Bengt s’écrit à lui-même pour adoucir sa tristesse, suivant le conseil de sa mère, qui permettent de raconter ce qui se passe de mois en mois. Ceux-ci et les titres des chapitres sont discrètement projetés sur le côté de la scène, et permettent de souligner la progression des évènements.
 Les partis pris adoptés pour cette adaptation reconfigurent considérablement les équilibres du roman. Le chien noir Hector – véritable chien qui joue parfaitement son rôle sur scène – s’impose ainsi bien avant la fiancée de Bengt, Bérit. Gun, l’amante du père qui deviendra sa compagne officielle, tarde également à apparaître. Ce qui vient véritablement du roman, alors que n’en restent que quelques pages, c’est paradoxalement son rythme, une certaine lenteur liée dans le texte à la précision avec laquelle sont décortiqués les moindres sentiments de Bengt et les moindres faits qui les suscitent, qui se retrouve là dans l’accumulation de scènes relativement courtes qui n’ont pas été fusionnées entre elles. Entre deux scènes jouées, le bras de fer du père et du fils est restitué par les lettres de Bengt, dites par Théo Oliveira Marchando – mais avec une distance qui dédramatise considérablement la haine qu’il exprime. Surgissent également des visions, comme celle du père, qui derrière le rideau, astique des chaussures rouges, près d’une robe rouge – celle de la mère, que portera Gun. Ce type de micro-scène tente de traduire plusieurs pages du roman dans un langage théâtral, et fait tendre vers la densité romanesque.
Les partis pris adoptés pour cette adaptation reconfigurent considérablement les équilibres du roman. Le chien noir Hector – véritable chien qui joue parfaitement son rôle sur scène – s’impose ainsi bien avant la fiancée de Bengt, Bérit. Gun, l’amante du père qui deviendra sa compagne officielle, tarde également à apparaître. Ce qui vient véritablement du roman, alors que n’en restent que quelques pages, c’est paradoxalement son rythme, une certaine lenteur liée dans le texte à la précision avec laquelle sont décortiqués les moindres sentiments de Bengt et les moindres faits qui les suscitent, qui se retrouve là dans l’accumulation de scènes relativement courtes qui n’ont pas été fusionnées entre elles. Entre deux scènes jouées, le bras de fer du père et du fils est restitué par les lettres de Bengt, dites par Théo Oliveira Marchando – mais avec une distance qui dédramatise considérablement la haine qu’il exprime. Surgissent également des visions, comme celle du père, qui derrière le rideau, astique des chaussures rouges, près d’une robe rouge – celle de la mère, que portera Gun. Ce type de micro-scène tente de traduire plusieurs pages du roman dans un langage théâtral, et fait tendre vers la densité romanesque.
La progression d’ensemble est donc mesurée, jusqu’au moment où Gun est officiellement présentée à Bengt, à l’occasion d’un thé, en présence de Knut et Bérit qui s’activent. De là, Noëmie Ksicova prend le tournant de la narration et procède à une grande reconfiguration scénique pour relater la Saint-Jean, que les personnages fêtent tous les quatre sur une île. La scène apparemment immuable s’ouvre et découvre un espace aquatique en fond, dans lequel il est possible de plonger, une chambre et une terrasse. La métamorphose, opérée dans la pénombre par plusieurs techniciens, modifie considérablement la dynamique : après le huis clos, l’espace restreint, l’ouverture au dehors ; après les dialogues laconiques, les rapports limités, des interactions plus franches. Quoique le dispositif soit laborieux à manipuler, l’équipe n’hésite pas à faire encore passer de l’île à l’appartement, de l’appartement à l’île, et une fois encore en sens inverse, pour suivre le cours de la narration. Chaque fois, les deux espaces évoluent un peu, allant vers un approfondissement progressif qui fait oublier l’oppression première.
 Du point de vue strict de l’adaptation, ce parcours tend à atténuer la violence profondément dérangeante du roman. Certes, sur scène, Bengt s’en prend au chien, à deux reprises, ainsi qu’à Bérit et à Gun. Mais ses gestes ne sont chaque fois qu’esquissés et étouffés par un noir ou un départ en coulisses. La réaction vive qu’ils suscitent se dissipe donc rapidement, et l’empathie que suscite l’acteur l’emporte sur l’aversion. L’économie faite des réflexions de Bengt, soigneusement décortiquées, tempère également la radicalité de sa pensée et sa cruauté à l’égard de Bérit. Disparaît également le rapport très ambigu que le père entretient avec la fiancée de son fils, qui constitue un pendant à la relation qui se noue entre le fils et l’amante de son père et qui justifie en partie la haine que ce dernier suscite. Les lettres permettent en revanche de conserver le mouvement de conversion de la pureté intransigeante au compromis que confère l’expérience.
Du point de vue strict de l’adaptation, ce parcours tend à atténuer la violence profondément dérangeante du roman. Certes, sur scène, Bengt s’en prend au chien, à deux reprises, ainsi qu’à Bérit et à Gun. Mais ses gestes ne sont chaque fois qu’esquissés et étouffés par un noir ou un départ en coulisses. La réaction vive qu’ils suscitent se dissipe donc rapidement, et l’empathie que suscite l’acteur l’emporte sur l’aversion. L’économie faite des réflexions de Bengt, soigneusement décortiquées, tempère également la radicalité de sa pensée et sa cruauté à l’égard de Bérit. Disparaît également le rapport très ambigu que le père entretient avec la fiancée de son fils, qui constitue un pendant à la relation qui se noue entre le fils et l’amante de son père et qui justifie en partie la haine que ce dernier suscite. Les lettres permettent en revanche de conserver le mouvement de conversion de la pureté intransigeante au compromis que confère l’expérience.
De l’œuvre d’origine, reste donc une narration ample, qui relate une perte douloureuse, une réparation fragile par l’amour, l’ambiguïté insoluble de relations. Ce qui permet de tenir la route dans ce parcours, la profondeur de champ du roman mise de côté, c’est la précision du jeu des acteurs et actrices. La scénographie produit un effet de gros plan sur les quatre : on voit les tremblements de mains de Bengt, les gestes maladroits de Knut, le malaise profond de Bérit, l’assurance de Gun. Aucun ne dévie jamais de sa trajectoire, même quand ils n’ont plus le soutien de sons et de musique, que le silence, parfois pesant, rend chacun de leurs mouvements et chacune de leurs expressions perceptibles. Lumir Brabant et Théo Oliveira Marchando, que l’on découvre, se révèlent particulièrement impressionnants, aux côtés Vincent Dissez et Cécile Péricone. On peut faire l’hypothèse que c’est leur immersion dans le texte de Dagerman, au-delà de l’adaptation de Ksicova, qui leur donne cette puissance. La précision de leur jeu fait cependant regretter que l’examen chirurgical des sentiments contradictoires auquel procède Dagerman ne se retrouve pas autrement que de manière souterraine, ou que la metteuse en scène n’ait pas pris le parti d’une distance plus grande avec le texte, lui permettant d’en réinvestir la densité romanesque autrement. Le spectacle se maintient sur la ligne de crête de l’œuvre pour en restituer l’essentiel, et en fait parfois même deviner les abîmes mais sans jamais vraiment s’y risquer.
F.
Pour en savoir plus sur « L’Enfant brûlé », rendez-vous sur le site de la Comédie de Reims.