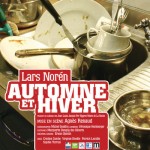Un an et quelques mois après la mort de l’auteur suédois Lars Norén, le Théâtre de l’Odéon présente l’une de ses pièces, Kliniken, dans une mise en scène de Julie Duclos. Il y a dix ans, Stéphane Braunschweig, alors directeur de la Colline, avait programmé Salle d’attente de Krystian Lupa, d’après Catégorie 3.1 du même auteur. Ces deux spectacles dialoguent dans la mémoire du spectateur, car tous deux offrent de longues fresques qui dressent le portrait de marginaux, ceux qui vivent dans la rue et se croisent dans les non lieux d’une ville d’une part, et ceux réunis dans un hôpital psychiatrique d’autre part. L’immersion que propose Julie Duclos dans l’institution médicale est douloureuse. Un condensé de détresses, de désespoirs et de dépressions nous attend, qui finit inévitablement par toucher mais qui amène à interroger la pertinence de monter ce texte aujourd’hui, alors que nos morals sont si fragiles.
 Le soir de la première, l’Odéon bat son plein, frémissant, mondain, vivant. Aussitôt entré dans la salle, le public est renvoyé à un au-dehors : le mur du fond de la scénographie est percé par une baie vitrée derrière laquelle se trouve un arbre. Un grand arbre, un vrai arbre, éclairé par une lumière qui donne véritablement l’impression d’un dehors. Cette vision saisissante et d’emblée réconfortante atténue l’austérité de ce qui entoure la baie vitrée. Sur le plateau, est représenté un milieu hospitalier, grâce à des murs blancs, des tables et des chaises quelconques, un distributeur d’eau, des portes « antipaniques » (c’est comme ça qu’elles se nomment, paraît-il) surmontées de signaux sortie de secours qui ouvrent l’espace de tous les côtés. La pièce à vivre comprend également un piano et un cendrier, maigres réconforts. L’espace rappelle une partie de celui d’Une mort dans la famille d’Alexandre Zeldin, présenté il y a quelques mois aux Ateliers Berthier. La scénographie de Matthieu Sampeur est cependant beaucoup plus épurée ; l’arbre mis à part, elle ne sert que peu de support à la rêverie du spectateur.
Le soir de la première, l’Odéon bat son plein, frémissant, mondain, vivant. Aussitôt entré dans la salle, le public est renvoyé à un au-dehors : le mur du fond de la scénographie est percé par une baie vitrée derrière laquelle se trouve un arbre. Un grand arbre, un vrai arbre, éclairé par une lumière qui donne véritablement l’impression d’un dehors. Cette vision saisissante et d’emblée réconfortante atténue l’austérité de ce qui entoure la baie vitrée. Sur le plateau, est représenté un milieu hospitalier, grâce à des murs blancs, des tables et des chaises quelconques, un distributeur d’eau, des portes « antipaniques » (c’est comme ça qu’elles se nomment, paraît-il) surmontées de signaux sortie de secours qui ouvrent l’espace de tous les côtés. La pièce à vivre comprend également un piano et un cendrier, maigres réconforts. L’espace rappelle une partie de celui d’Une mort dans la famille d’Alexandre Zeldin, présenté il y a quelques mois aux Ateliers Berthier. La scénographie de Matthieu Sampeur est cependant beaucoup plus épurée ; l’arbre mis à part, elle ne sert que peu de support à la rêverie du spectateur.
Dès avant notre entrée, le lieu est occupé par des corps un peu avachis, un peu voûtés, tourmentés. Le coup d’envoi du spectacle est donné par l’arrivée d’un homme jeune débordant de santé et de phrases convenues, qui vient bousculer ces corps malades pour partie prostrés devant la télé. Celui qui se révèle un homme de ménage paraît venir des rues alentour lorsqu’il évoque la chaleur du dehors, alors que nous goûtons aux premières températures estivales. Plus tard, un patient évoquera avec sarcasme la création d’une nouvelle gauche. De rares indices ancrent ainsi le spectacle dans notre géographie et notre présent, rapprochant au plus près la pièce de Norén, écrite il y a près de trente ans, en 1993.
 Ces retouches sont minimes, car les portraits brossés dans ce texte n’ont pas pris une ride. Ce sont par exemple ceux d’un schizophrène, d’une bipolaire ou d’une anorexique. D’autres pathologies sont moins clairement identifiées, causées par le SIDA, l’inceste ou la guerre en Syrie. Quoique malades, ces êtres sont livrés à eux-mêmes. Aucun personnel hospitalier ne les accompagne, aucune blouse blanche ; seuls un homme de ménage et un gardien de nuit règlent vaguement leur quotidien. Les malades parlent donc à d’autre malades, dont l’écoute, qui est souvent non écoute, permet peut-être une parole plus franche et plus libre que celle qui serait adressé à des soignants. Un médicament administré avec violence nous rappelle le suivi dont ces êtres sont supposés faire l’objet. Mais le reste du temps, ils pourraient passer pour les membres d’une grande famille par leurs attentions les uns envers les autres ou leurs altercations furieuses. Tout ce qui pourrait marquer la distance avec l’extérieur, avec des personnes moins malades – nous – est donc estompé. Le miroir tendu en vient à refléter une réalité extrêmement proche de la nôtre, et ce reflet donne à voir un paysage apocalyptique, lentement dessiné à mesure que chacune des histoires des onze patients sont dépliées, d’un coup ou par morceaux. La surenchère paraît sans fin, alors que d’emblée, on comprend qu’aucune intrigue ne va se nouer entre eux, que rien n’est à attendre de leur confrontation, que la dynamique dramatique de la pièce n’est faite que de la révélation de ces personnages – révélation sous-tendue par la menace d’une crise ou d’un suicide.
Ces retouches sont minimes, car les portraits brossés dans ce texte n’ont pas pris une ride. Ce sont par exemple ceux d’un schizophrène, d’une bipolaire ou d’une anorexique. D’autres pathologies sont moins clairement identifiées, causées par le SIDA, l’inceste ou la guerre en Syrie. Quoique malades, ces êtres sont livrés à eux-mêmes. Aucun personnel hospitalier ne les accompagne, aucune blouse blanche ; seuls un homme de ménage et un gardien de nuit règlent vaguement leur quotidien. Les malades parlent donc à d’autre malades, dont l’écoute, qui est souvent non écoute, permet peut-être une parole plus franche et plus libre que celle qui serait adressé à des soignants. Un médicament administré avec violence nous rappelle le suivi dont ces êtres sont supposés faire l’objet. Mais le reste du temps, ils pourraient passer pour les membres d’une grande famille par leurs attentions les uns envers les autres ou leurs altercations furieuses. Tout ce qui pourrait marquer la distance avec l’extérieur, avec des personnes moins malades – nous – est donc estompé. Le miroir tendu en vient à refléter une réalité extrêmement proche de la nôtre, et ce reflet donne à voir un paysage apocalyptique, lentement dessiné à mesure que chacune des histoires des onze patients sont dépliées, d’un coup ou par morceaux. La surenchère paraît sans fin, alors que d’emblée, on comprend qu’aucune intrigue ne va se nouer entre eux, que rien n’est à attendre de leur confrontation, que la dynamique dramatique de la pièce n’est faite que de la révélation de ces personnages – révélation sous-tendue par la menace d’une crise ou d’un suicide.
L’écriture de Norén exige une direction d’acteurs chorale. Les répliques circulent sans logique entre les personnages, au gré des entrées et des sorties des uns ou des autres, de leurs fulgurances ou de leurs retombées en apathie. Ces enchaînements font constamment passer du coq à l’âne, d’une conversation à l’autre ou au sein même d’une conversation qui donne l’impression que des fils de parole sont dévidés de manière parallèle, presque indifférente. Julie Duclos organise tout un ballet pour ménager ces prises de parole. La scénographie permet ainsi de multiplier les allées et venues par ses trois portes et des passages latéraux. Pendant la majeure partie du spectacle, Birgit ne fera que passer de l’une à l’autre, traverser la scène avant, à la fin, de confier au gardien de nuit comment elle a redécouvert que son père l’avait violée à quatre ans grâce à une séance d’hypnose pour arrêter de fumer. D’autres, de manière moins radicale, parlent un peu à chaque passage qu’ils font dans la pièce ; certains enfin restent longtemps assis dans une chaise ou le canapé et se livrent par intermittence. Ces modulations sur la présence des corps auraient gagné à être redoublées par des modulations sur les voix, le déploiement d’un art de la sous-conversation qui aurait atténué les passages brusques et parfois grossiers d’un dialogue à un autre.
 Cette impression d’une certaine brutalité est aussi produite par le rythme du spectacle, dans l’ensemble enlevé. Le personnage de Maud, assise dans le fumoir depuis le début du spectacle, qui enchaîne lentement les cigarettes sans dire un mot, paraît détenir le tempo juste qu’il aurait fallu donner à tous les autres. Par sa présence discrète, elle étire le temps, met au contact d’un temps mort, nettement différent du temps quotidien – proche de celui qu’explorait Lupa dans Salle d’attente, spectacle bien nommé. Les blagues de l’homme de ménage, les irruptions de Roger qui réduit toutes les femmes à des chattes qu’il insulte, les passages d’Anne-Marie toujours pressée, la normalité de Martin qui ne paraît pas malade – marié, deux enfants, travaille dans la pub et organise ses funérailles sur son mac – accélèrent le rythme. Tous détournent de Maud ou encore de Markus, le schizophrène au corps engourdi, qui se déplace insensiblement, mène de lents combats avec les boutons de sa chemise et suit les autres comme une ombre.
Cette impression d’une certaine brutalité est aussi produite par le rythme du spectacle, dans l’ensemble enlevé. Le personnage de Maud, assise dans le fumoir depuis le début du spectacle, qui enchaîne lentement les cigarettes sans dire un mot, paraît détenir le tempo juste qu’il aurait fallu donner à tous les autres. Par sa présence discrète, elle étire le temps, met au contact d’un temps mort, nettement différent du temps quotidien – proche de celui qu’explorait Lupa dans Salle d’attente, spectacle bien nommé. Les blagues de l’homme de ménage, les irruptions de Roger qui réduit toutes les femmes à des chattes qu’il insulte, les passages d’Anne-Marie toujours pressée, la normalité de Martin qui ne paraît pas malade – marié, deux enfants, travaille dans la pub et organise ses funérailles sur son mac – accélèrent le rythme. Tous détournent de Maud ou encore de Markus, le schizophrène au corps engourdi, qui se déplace insensiblement, mène de lents combats avec les boutons de sa chemise et suit les autres comme une ombre.
Ce rythme emballé qui rapproche encore les malades des spectateurs empêche paradoxalement d’entrer dans cet hôpital pendant un long temps. On finit par y être poussé de force par la crudité des souffrances racontées. C’est d’abord la bipolarité presque douce de Maud qui attache, après le long silence qui précède ses premières paroles. Puis c’est Sofia. Le corps solaire d’Alexandra Gentil en vient à être gagné par l’anorexie, à force de phrases aussi violentes que justes qui décrivent son mal. Difficile de rester insensible à sa douleur, comme à celle des femmes incestées, ou à celle de Mohammed, Syrien dont toute la famille a été décimée, et dont le récit est appuyé par des images d’Alep en ruines, profondément désolantes. Au fur et à mesure du spectacle, le corps du spectateur se tasse dans son fauteuil. Son abattement ressemblera étrangement à celui de la mère de Roger, qui vient lui rendre visite. Son désespoir face à son fils qui l’agresse – Etienne Toqué, impressionnant – paraît aussi grande que celle des malades avec qui il vit, et il ne paraît pas surprenant qu’elle ait été en hôpital psychiatrique elle aussi, par le passé.
 Julie Duclos n’a probablement pour ambition de nous affliger. Le rythme rapide avec lequel elle traite la pièce, situé du côté de la vie plutôt que de la maladie, doit probablement y contrevenir. De même que l’humour ponctuellement entretenu, souligné par quelques regards au public – mais les rires de la salle, de plus en plus gênants à mesure que le spectacle progresse, se raréfient. Le personnage de Manon Kneusé, Erika, est lui aussi supposé décanter l’ambiance par ses défilés de mode et sa volubilité inquiète. L’usage de la caméra avait peut-être également pour fonction d’offrir une échappatoire, mais l’effet produit est inverse. Quand l’émotion n’est pas décuplée par un gros plan sur les visages des acteurs, saisis depuis les coulisses, ceux-ci sont transformés en fantômes lorsqu’ils sont filmés en train de s’enfuir dans l’envers du décor. Ces images projetées sur les murs de la salle ne produisent pas un effet de distanciation. Elles contribuent au contraire à souligner le continuum qui existe entre cet espace poreux, duquel les malades peuvent sortir et recevoir de la visite, et notre réalité. La caméra, en nous entraînant jusqu’à une porte qui ouvre sur les rues du quartier de l’Odéon, ne fait que confirmer que nous pourrions tous être à leur place, que la différence entre ces malades et nous et bien mince, que leur détresse est à peine plus grande que celle que provoque le monde en crise dans lequel nous vivons.
Julie Duclos n’a probablement pour ambition de nous affliger. Le rythme rapide avec lequel elle traite la pièce, situé du côté de la vie plutôt que de la maladie, doit probablement y contrevenir. De même que l’humour ponctuellement entretenu, souligné par quelques regards au public – mais les rires de la salle, de plus en plus gênants à mesure que le spectacle progresse, se raréfient. Le personnage de Manon Kneusé, Erika, est lui aussi supposé décanter l’ambiance par ses défilés de mode et sa volubilité inquiète. L’usage de la caméra avait peut-être également pour fonction d’offrir une échappatoire, mais l’effet produit est inverse. Quand l’émotion n’est pas décuplée par un gros plan sur les visages des acteurs, saisis depuis les coulisses, ceux-ci sont transformés en fantômes lorsqu’ils sont filmés en train de s’enfuir dans l’envers du décor. Ces images projetées sur les murs de la salle ne produisent pas un effet de distanciation. Elles contribuent au contraire à souligner le continuum qui existe entre cet espace poreux, duquel les malades peuvent sortir et recevoir de la visite, et notre réalité. La caméra, en nous entraînant jusqu’à une porte qui ouvre sur les rues du quartier de l’Odéon, ne fait que confirmer que nous pourrions tous être à leur place, que la différence entre ces malades et nous et bien mince, que leur détresse est à peine plus grande que celle que provoque le monde en crise dans lequel nous vivons.
Pour tenir le cap, ne pas sombrer dans le naufrage, reste l’arbre. Au gré de la météo, parfois manifestée par des pluies battantes, au gré des saisons suggérées par les lumières de Dominique Bruguières, la petite cour qui l’accueille apparaît comme un refuge. L’importance qu’a cet arbre pour traverser cette fresque qui ne nous épargne rien – pas même le brancard qui transporte un corps qui s’est donné la mort – nous est cruellement rappelée lorsque la baie vitrée qui le laisse voir est un temps masquée par un rideau. Si ce rideau se relève et que l’arbre redevient un point d’attache pour la dernière partie du spectacle, il ne paraît plus suffisant, et on ressort en se demandant si le théâtre ne devrait pas se donner pour mission de nous fortifier, de nous donner de l’élan, voire de l’espoir, plutôt que d’ajouter au poids de notre monde, de nous ramener si littéralement vers nos angoisses et nos dépressions.
F.
Pour en savoir plus sur « Kliniken », rendez-vous sur le site du Théâtre de l’Odéon.