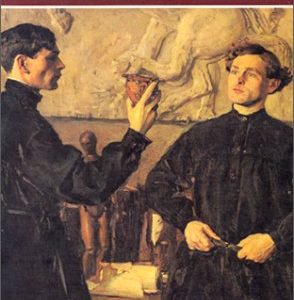Pedro Penim est le successeur de Tiago Rodrigues à la tête du Teatro Nacional D. Maria II de Lisbonne, depuis 2021. Après avoir été invité avec plusieurs spectacles en France, il est accueilli cette année dans le double cadre du Festival d’Automne à Paris et de la saison France-Portugal 2022 avec sa dernière création, Père et fils. Le titre est emprunté à un roman de Tourgueniev, qui à la fin du XIXe siècle dressait le portrait des premiers nihilistes, ceux que Dostoïevski considérera dans Les Démons comme la première génération des révolutionnaires avant celle des socialistes-terroristes, ces deux œuvres étant perçues après coup comme prophétiques des révolutions russes du début du XXe siècle. Le metteur en scène procède à une actualisation de l’œuvre qui l’inspire, plutôt qu’à une adaptation, en nourrissant le motif du conflit générationnel par des débats propres à notre époque. Le spectacle qui résulte de cette opération est intellectuellement dense, tout particulièrement dans sa première partie.
 Un homme est allongé sur un tapis à motifs, immobile. Au-dessus de lui, des images sont projetées sur un écran. Images de corps masculins qui dansent ensemble ou s’embrassent, images de leurs parties intimes moulées dans des pantalons ou des maillots de bain, dont le style évoque les années 1970. Dans le flux rythmé par la musique, s’insèrent également des images de laboratoire : microscopes, souris qui copulent, injections par pipettes. Les années sida semblent ici dépeintes, sans qu’aucun mot ne soit prononcé.
Un homme est allongé sur un tapis à motifs, immobile. Au-dessus de lui, des images sont projetées sur un écran. Images de corps masculins qui dansent ensemble ou s’embrassent, images de leurs parties intimes moulées dans des pantalons ou des maillots de bain, dont le style évoque les années 1970. Dans le flux rythmé par la musique, s’insèrent également des images de laboratoire : microscopes, souris qui copulent, injections par pipettes. Les années sida semblent ici dépeintes, sans qu’aucun mot ne soit prononcé.
Lorsque le film s’achève, l’homme allongé se lève et commente une citation de Sophie Lewis, théoriste féministe qui affirme que tout auteur est co-auteur. L’homme se révèle Pedro Penim lui-même, qui parle ensuite en son nom et raconte qu’il est engagé dans un processus de GPA depuis quatre ans avec son mari – faits que confirme l’entretien du metteur en scène reproduit dans la feuille de salle. Prenant appui sur la chronologie, il rapporte les contraintes qu’impliquent une telle démarche (contraintes spatiales, financières, juridiques) et les rebondissements parfois douloureux auxquels ils ont été confrontés avec son mari – le cœur d’un fœtus qui s’arrête, les mères porteuses ou « surrogate » qui doutent ou renoncent… Progressivement, il rejoint le présent et relate qu’une jeune femme qui vit au Portugal porte pour eux un fœtus, en attendant d’accoucher au Canada.
 Le monologue adressé à la salle est progressivement interrompu, par le mari du metteur en scène qui ne fait que passer, puis par son frère qui vient le retrouver, son chien dans les bras. Les identités basculent entre acteur et personnage, à mesure qu’un décor acidulé est installé et que se prépare une réunion de famille à l’occasion du retour du fils du frère après un an d’études, qui a annoncé venir accompagné d’une amie. À cette occasion, se sont réunis le père du fils qu’on croit prodigue, l’oncle, le mari de l’oncle, ainsi qu’une amie de la mère décédée, Anna. Katya, la mère porteuse de l’oncle et son mari s’invite également in extremis, car elle a besoin de leur dire qu’elle ne se sent plus capable de mener la grossesse à son terme.
Le monologue adressé à la salle est progressivement interrompu, par le mari du metteur en scène qui ne fait que passer, puis par son frère qui vient le retrouver, son chien dans les bras. Les identités basculent entre acteur et personnage, à mesure qu’un décor acidulé est installé et que se prépare une réunion de famille à l’occasion du retour du fils du frère après un an d’études, qui a annoncé venir accompagné d’une amie. À cette occasion, se sont réunis le père du fils qu’on croit prodigue, l’oncle, le mari de l’oncle, ainsi qu’une amie de la mère décédée, Anna. Katya, la mère porteuse de l’oncle et son mari s’invite également in extremis, car elle a besoin de leur dire qu’elle ne se sent plus capable de mener la grossesse à son terme.
À l’arrivée du fils et de son amie, le basculement annoncé par la mise en place du décor se révèle radical. D’une part, le fils, seul nommé, porte un nom russe, Arkasha, qui indique un rapprochement avec le roman qui donne son titre au spectacle, après l’entrée en matière autobiographique. D’autre part, les débats éthiques refoulés par le récit de Pedro Penim sur ses démarches de GPA, qui laissaient peu de place à la réflexion en forçant à l’empathie, jaillissent désormais avec vigueur. Arkasha et son amie, tous deux gender fluide dans leur style, inassignables à un genre jusqu’à la fin du spectacle, écourtent la joie des retrouvailles pour annoncer à leur famille qu’ils sont désormais des nihilistes queer qui se réclament de la pensée d’Alyson Escalante et prônent la destruction de l’ensemble de la société, dans ses institutions, ses structures, son histoire et même ses œuvres d’art – limite que Stépan Trophimovitch, dans Les Démons de Dostoïevski, ne peut se résoudre à franchir. S’ils sont venus trouver leur famille, c’est parce que l’idéologie qu’ils ont embrassée implique une abolition des liens de la famille, qu’ils revendiquent en prenant cette fois appui sur un essai de Sophie Lewis, Full Surrogacy Now: feminism against family.
 La famille confrontée à ces discours ne paraît pas des plus réactionnaires, elle a peu à voir avec les artistocrates terriens que décrit Tourgueniev dans son roman. Arkasha et son amie en attaquent cependant les membres sur leur mode de vie néo-libéral qui les conduit à commander de la nourriture via des app et à envisager d’avoir un enfant bien à eux grâce à l’exploitation du corps d’une femme qu’ils paient. La GPA tout autant que la question du genre viennent ainsi cristalliser les conflits intergénérationnels de notre époque, qui sont aussi des conflits intragénérationnels. L’oncle et son mari se trouvent en effet tout autant attaqués par Arkasha et son amie que par Anna, la plus réactionnaire de la bande, pour leur projet de GPA. Quant à Arkasha, il n’est pas triomphant de tous les débats, à son tour pris en flagrant délit de patriarcat par Katya, la mère porteuse, qui lui démontre qu’il la mansplain.
La famille confrontée à ces discours ne paraît pas des plus réactionnaires, elle a peu à voir avec les artistocrates terriens que décrit Tourgueniev dans son roman. Arkasha et son amie en attaquent cependant les membres sur leur mode de vie néo-libéral qui les conduit à commander de la nourriture via des app et à envisager d’avoir un enfant bien à eux grâce à l’exploitation du corps d’une femme qu’ils paient. La GPA tout autant que la question du genre viennent ainsi cristalliser les conflits intergénérationnels de notre époque, qui sont aussi des conflits intragénérationnels. L’oncle et son mari se trouvent en effet tout autant attaqués par Arkasha et son amie que par Anna, la plus réactionnaire de la bande, pour leur projet de GPA. Quant à Arkasha, il n’est pas triomphant de tous les débats, à son tour pris en flagrant délit de patriarcat par Katya, la mère porteuse, qui lui démontre qu’il la mansplain.
Les répliques fusent, et la radicalité des positions que chacun finit par occuper nous amène à nous questionner sur des sujets délicats, sans pour autant nous forcer à prendre position de manière tranchée. Cette intensité des discussions oblige à suivre de près les panneaux de surtitres, parfois au détriment de la scène. Peu de choses s’y passent cependant, mises à part les allées et venues des uns ou des autres et quelques danses qui viennent faire redescendre la pression ou reconfigurer les échanges. Pris par le rythme de la mise en scène et des dialogues, le spectateur français se trouve empêché d’apprécier le jeu des acteurs et actrices, celui d’Arkasha et son amie mis à part car tous deux captent l’attention, soit par excès de mise en scène de soi, soit par un retrait qui densifie la présence.
 Les cinq minutes d’entracte prévues offrent une respiration après ce tourbillon de débats. Au retour en salle, la scène est à nouveau reconfigurée : une nouvelle actrice se tient devant un fond en dentelle, au-devant duquel se trouvent un miroir psyché, deux fauteuils et un guéridon. La femme se désigne comme une actrice dans un monologue fantasque, interrompu par l’arrivée d’Arkasha et Eugénie/Eudoxie (celle qui pense bien), son amie enfin nommée. Les fils narratifs sont renoués lorsqu’ils annoncent à la mère être venus pour rompre définitivement avec elle, au nom de leur nihilisme queer et de la destruction totale qu’elle implique. Eugénie déclare ainsi : je ne suis plus ta fille, tu n’es plus ma mère. Celle-ci résiste moins que le père de la première partie, et les questionnements précédemment soulevés laissent alors place à une adaptation-actualisation moins convaincante du roman. Le fond de dentelle découvre une forêt stylisée dans lesquels des liens se distendent ou se tendent entre les personnages, qui se croisent au gré de promenades ou de rencontres dans une nuit aux accents shakespeariens. L’intrigue de Tourgueniev souterrainement suivie jusqu’ici vient prendre le dessus sur les controverses contemporaines qu’elle permettait d’amener, et conduit jusqu’à un duel en costumes qui laisse relativement indifférent après tout ce qui précède.
Les cinq minutes d’entracte prévues offrent une respiration après ce tourbillon de débats. Au retour en salle, la scène est à nouveau reconfigurée : une nouvelle actrice se tient devant un fond en dentelle, au-devant duquel se trouvent un miroir psyché, deux fauteuils et un guéridon. La femme se désigne comme une actrice dans un monologue fantasque, interrompu par l’arrivée d’Arkasha et Eugénie/Eudoxie (celle qui pense bien), son amie enfin nommée. Les fils narratifs sont renoués lorsqu’ils annoncent à la mère être venus pour rompre définitivement avec elle, au nom de leur nihilisme queer et de la destruction totale qu’elle implique. Eugénie déclare ainsi : je ne suis plus ta fille, tu n’es plus ma mère. Celle-ci résiste moins que le père de la première partie, et les questionnements précédemment soulevés laissent alors place à une adaptation-actualisation moins convaincante du roman. Le fond de dentelle découvre une forêt stylisée dans lesquels des liens se distendent ou se tendent entre les personnages, qui se croisent au gré de promenades ou de rencontres dans une nuit aux accents shakespeariens. L’intrigue de Tourgueniev souterrainement suivie jusqu’ici vient prendre le dessus sur les controverses contemporaines qu’elle permettait d’amener, et conduit jusqu’à un duel en costumes qui laisse relativement indifférent après tout ce qui précède.
De manière plus problématique, le spectacle s’achève avec un chœur formé autour de l’enfant finalement né, qui supplante toute forme de polyphonie. D’une même voix, l’ensemble des personnages en vient à prôner l’abolition de la famille au nom de la collectivité, et ce discours unanime vient brusquement restreindre l’ouverture de champ dégagée dans de multiples directions par les dialogues antérieurs. Ce point d’arrivée atteint après de multiples détours et basculements laisse un sentiment d’inachevé qui révèle la difficulté qu’il y a se maintenir dans la contradiction, ainsi que dans l’équilibre fragile recherché entre une œuvre du XIXe siècle et son actualisation.
F.
Pour en savoir plus sur « Père et fils », rendez-vous sur le site du Théâtre de la Ville.