L’édition 2022 du Festival d’Avignon est inaugurée dans la Cour d’honneur du Palais des Papes avec Le Moine noir. Après Les Métamorphoses d’Ovide, un scénario de Lars von Trier, Les Idiots, et le roman inachevé de Gogol, Les Âmes mortes, le metteur en scène russe s’empare cette fois d’une nouvelle de Tchekhov. Son adaptation, construite comme un crescendo, mène du réalisme au mysticisme, suivant une montée en puissance d’autant plus impressionnante qu’elle est imprévisible.
 Comme en 2015 dans la Cour du Lycée Saint-Joseph, pour Les Idiots, le vent souffle dans la Cour d’Honneur et deviendra un personnage à part entière du spectacle. Sa puissance est telle qu’une voix annonce que quelques modifications scénographiques ont dû être effectuées. Même sans cette indication, il paraît commencer par diminuer la scénographie, composée de trois serres dont les portent claques et les bâches en plastique s’agitent. Plus tard, la fumée régulièrement lancée par une machine partira dans les hauteurs du Palais quand elle ne disparaîtra pas immédiatement. Les acteurs, les épaules haussées pour dire le froid, sont quant à eux ondulés, voire fouettés par le vent. Il y aura également des moments de grâce, où le vent paraîtra orchestré avec la même précision que les lumières ou les images vidéo, s’apaisant quand le soleil se lève ou se couche ou redoublant d’intensité au moment du saccage des serres.
Comme en 2015 dans la Cour du Lycée Saint-Joseph, pour Les Idiots, le vent souffle dans la Cour d’Honneur et deviendra un personnage à part entière du spectacle. Sa puissance est telle qu’une voix annonce que quelques modifications scénographiques ont dû être effectuées. Même sans cette indication, il paraît commencer par diminuer la scénographie, composée de trois serres dont les portent claques et les bâches en plastique s’agitent. Plus tard, la fumée régulièrement lancée par une machine partira dans les hauteurs du Palais quand elle ne disparaîtra pas immédiatement. Les acteurs, les épaules haussées pour dire le froid, sont quant à eux ondulés, voire fouettés par le vent. Il y aura également des moments de grâce, où le vent paraîtra orchestré avec la même précision que les lumières ou les images vidéo, s’apaisant quand le soleil se lève ou se couche ou redoublant d’intensité au moment du saccage des serres.
La nouvelle de Tchekhov relate l’histoire d’un retour, celui d’un jeune homme, journaliste à la ville, qui revient à la campagne sur la recommandation de son médecin. Il répond à l’invitation fortuite de Tania, une amie d’enfance, qui vit avec son père, jardinier. Le jardin représente leur vie entière, jardin d’Éden luxuriant, aux milles fleurs et arbres fruitiers. Sur la scène de Serebrennikov, ne restent que des serres, non pas pleines de plantes mais d’individus. La nouvelle ne compte que trois personnages mais le metteur en scène donne corps aux voisins du jardinier, aux estivants qui animent la vie de Tania avec leur musique. Les premières répliques convoquent de cette façon Gorki aux côtés de Tchekhov, ainsi que Virgile quand le père décrit minutieusement ses plantes et le travail de culture qu’elles exigent. L’accueil réservé à Andreï est chaleureux, il apparaît comme un génie que le jardinier voudrait voir devenir son gendre. Mais Andreï manque de s’étouffer quand il l’entend dire qu’il ferait de leurs fils un jardinier lui aussi, il rit à s’en rouler par terre, secoué de spasmes joyeux qui lui font faire des galipettes. Cette réaction, excessive, spectaculaire, ouvre une première faille dans la toile réaliste soigneusement tissée dès les premiers instants. Elle et les mouvements choraux des estivants, qui passent d’une serre à l’autre quand ils ne chantent pas et créent de beaux effets visuels de masse, sauvent de l’ennui qui menace.
 Au fur et à mesure des répliques, on se demande en effet quel est l’intérêt de ces dialogues lentement dépliés, on attend la force de dérangement que pouvaient laisser attendre le souvenir des Idiots. Cette attente est tantôt contrée tantôt redoublée par une diffraction de la perception, sollicitée par les corps dispersés aux quatre coins du plateau, les images vidéo projetées sur un grand rond situé en fond de scène, les surtitres projetés sur le mur du Palais qui traduisent le russe, l’allemand et l’anglais. L’effort de coordination de toutes ces données est important, presque démesuré par rapport à la banalité des propos échangés et le caractère conventionnel de l’intrigue qui se tisse. Au fil des journées qui s’enchaînent à toute allure, Andreï et Tania se marient, partent vivre en ville, reviennent, et Andreï sombre dans la folie.
Au fur et à mesure des répliques, on se demande en effet quel est l’intérêt de ces dialogues lentement dépliés, on attend la force de dérangement que pouvaient laisser attendre le souvenir des Idiots. Cette attente est tantôt contrée tantôt redoublée par une diffraction de la perception, sollicitée par les corps dispersés aux quatre coins du plateau, les images vidéo projetées sur un grand rond situé en fond de scène, les surtitres projetés sur le mur du Palais qui traduisent le russe, l’allemand et l’anglais. L’effort de coordination de toutes ces données est important, presque démesuré par rapport à la banalité des propos échangés et le caractère conventionnel de l’intrigue qui se tisse. Au fil des journées qui s’enchaînent à toute allure, Andreï et Tania se marient, partent vivre en ville, reviennent, et Andreï sombre dans la folie.
Une reconfiguration scénique accompagnée d’un grand « 2 » projeté rebat les cartes de la dramaturgie. Les mêmes répliques reviennent, prononcées par un autre Andreï, face à une autre Tania, plus vieille, qui rejouent peu ou prou les mêmes scènes qu’au début. Cette fois, s’impose le point de vue de Tania, suivant un procédé de variation subjective qui évoque Les Vagues de Virginia Woolf. Après la laborieuse première partie, tout s’illumine, avec la clarté qu’une relecture peut apporter à une lecture. Désormais, les éléments narratifs de base sont connus, certaines phrases sont mieux comprises, d’autres se constituent en motif… le spectateur gagne en maîtrise. Il gagne en maîtrise tout en s’enfonçant dans un flux de conscience qui, après coup, vient densifier la première partie. Certains éléments disparaissent, d’autres apparaissent, mais des points de rendez-vous ponctuent cette reprise pour bien faire comprendre qu’il s’agit de la même histoire contée d’un autre point de vue. De son père à Tania, la folie d’Andreï prend de l’ampleur, les lambeaux de bâches en plastique déchirées s’envolent dans le ciel étoilé qui nous englobe. Le spectateur s’immerge dans cette perspective tout en anticipant que viendra ensuite le point de vue d’Andreï.
 De fait, une nouvelle disposition des serres et un « 3 » accompagnent l’arrivée d’un nouvel Andreï. Le compte y est : un père, deux Tania, trois Andreï. Tout prend sens et et forme comme un puzzle à mesure que l’on progresse. Et l’on rerecommence donc, avec la subjectivité d’Andreï pour prisme, subjectivité pour de bon altérée après celle troublée de Tania. Les serres sont bouleversées et la légende du Moine noir au départ à peine évoquée prend de l’ampleur. Elle raconte l’apparition d’un moine noir dans un désert, puis à la surface de l’eau, puis aux quatre coins du mondes, moine dont le retour est attendu comme celui d’un Messie menaçant. Les scènes se répètent avec des accents de sens différents, l’acmé paraît atteinte.
De fait, une nouvelle disposition des serres et un « 3 » accompagnent l’arrivée d’un nouvel Andreï. Le compte y est : un père, deux Tania, trois Andreï. Tout prend sens et et forme comme un puzzle à mesure que l’on progresse. Et l’on rerecommence donc, avec la subjectivité d’Andreï pour prisme, subjectivité pour de bon altérée après celle troublée de Tania. Les serres sont bouleversées et la légende du Moine noir au départ à peine évoquée prend de l’ampleur. Elle raconte l’apparition d’un moine noir dans un désert, puis à la surface de l’eau, puis aux quatre coins du mondes, moine dont le retour est attendu comme celui d’un Messie menaçant. Les scènes se répètent avec des accents de sens différents, l’acmé paraît atteinte.
Un « 4 » apparaît cependant – qu’annonçait en réalité un quatrième rond en fond de scène, dévoilé après les autres, quatrième lune qui projette dans le cosmos. Cette fois, c’est le Moine noir qui s’exprime, cœur de la légende, ou cœur de la folie d’Andreï. Ceux qui formaient un chœur de villageois, au sein duquel on cherchait à identifier le personnage éponyme dans une silhouette plus sombre et plus recroquevillée que les autres, portent désormais tous une aube et un bonnet noirs. Ils dialoguent avec Andreï, interfèrent dans ses relations, s’imposent à lui de plus en plus nettement au fil des scènes. Mais la parole laisse désormais la place aux chants et aux danses d’Ivan Estegneev, Evgeny Kulagin et Jēkabs Nīmanis, maintenant que place nette est faite, que les serres désossées et sens dessus dessous ont été reléguées sur le côté. Le spectacle si rangé au départ prend alors la forme d’une messe noire, d’un rituel médiéval composé de chorégraphies qui démultiplient le corps d’Andreï et de chants aux accents grégoriens qui retentissent avec force dans tout le palais. Le spectaculaire l’emporte sur le narratif, le mysticisme sur le réalisme qui paraissait si inattendu et déceptif de la part de Serebrennikov. Dans le sillage des Idiots, un éloge de la folie comme lieu d’épanouissement, de liberté et de bonheur s’affirme – ceci malgré la destruction qu’elle engendre : à quatre reprises, le père meurt, dépossédé de son jardin d’Éden, Tania sombre dans le désespoir après avoir fait interner Andreï.
 Cette adaptation en quatre temps assume une radicalité qui fait traverser des esthétiques différentes, soulignées par la scénographie et par la part de plus en plus importante accordée au chant et à la danse. Le choix de distinguer trois Andreï met également en valeur l’effet de crescendo recherché. Face au père qui rappelle au départ Hendrik Arnst, grand acteur de la Volksbhüne, face à Tania, Victoria Miroshnichenko qui maintient constante la pression avec Andreï, Filipp Avdeev, Odin Biron et Mirco Kreibich captent par l’intensité de leur jeu, exacerbée à chaque partie. Même quand c’est le Moine noir qui détermine le récit, les trois acteurs saisissent, offrant des nuances inattendues, des variations de puissance spectaculaires modelées grâce à des rapports renouvelés au public. Avec eux, Serebrennikov adopte une tout autre stratégie que celle déployée dans son avant-dernier film La Fièvre de Pétrov, dans lequel la perception malade du personnage s’imposait d’emblée au spectateur. Ici, la démultiplication et l’alternance des points de vue permet d’approcher de plus en plus près le personnage d’Andreï puis le point noir qui le fait vriller, de révéler les différences facettes du diamant noir de sa folie – folie ambivalente qui révèle l’extase du génie mais que les autres anéantissent par peur.
Cette adaptation en quatre temps assume une radicalité qui fait traverser des esthétiques différentes, soulignées par la scénographie et par la part de plus en plus importante accordée au chant et à la danse. Le choix de distinguer trois Andreï met également en valeur l’effet de crescendo recherché. Face au père qui rappelle au départ Hendrik Arnst, grand acteur de la Volksbhüne, face à Tania, Victoria Miroshnichenko qui maintient constante la pression avec Andreï, Filipp Avdeev, Odin Biron et Mirco Kreibich captent par l’intensité de leur jeu, exacerbée à chaque partie. Même quand c’est le Moine noir qui détermine le récit, les trois acteurs saisissent, offrant des nuances inattendues, des variations de puissance spectaculaires modelées grâce à des rapports renouvelés au public. Avec eux, Serebrennikov adopte une tout autre stratégie que celle déployée dans son avant-dernier film La Fièvre de Pétrov, dans lequel la perception malade du personnage s’imposait d’emblée au spectateur. Ici, la démultiplication et l’alternance des points de vue permet d’approcher de plus en plus près le personnage d’Andreï puis le point noir qui le fait vriller, de révéler les différences facettes du diamant noir de sa folie – folie ambivalente qui révèle l’extase du génie mais que les autres anéantissent par peur.
Des premiers dialogues aux danses des moines derviches qui s’enivrent à force de tourner sur eux-mêmes, l’ivresse prend. L’ivresse de comprendre le fonctionnement de l’énigme qui s’imposait d’abord, de s’engouffrer dans ses arcanes, de participer au rituel et se laisser hypnotiser sans perdre pied dans cette légende quatre fois contée, qui devient légendaire et exerce son pouvoir de fascination à force de répétition.
F.
Pour en savoir plus sur « Le Moine noir », rendez-vous sur le site du Festival d’Avignon.

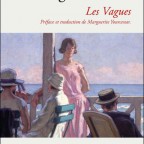



Incroyable ce vent qui joue avec la scénographie !!!