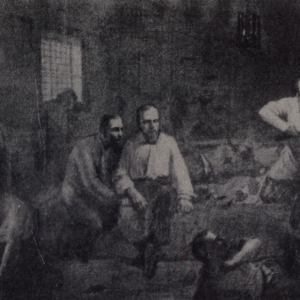À la ville une nouvelle extraordinaire nous attendait : sur un char tiré par un cheval efflanqué venait d’arriver une compagnie d’acteurs. Ils devaient rester quelques jours, ils joueraient, on aurait du théâtre. Le char recouvert par une grande bâche en toile cirée était là sur la place avec les décors et le rideau enroulés. Les acteurs s’affairaient tout autour ou cherchaient à se faire héberger chez les paysans pour n’avoir pas à dépenser dans l’auberge de Prisco. La compagnie était composée d’une seule famille : le père, le chef de troupe, la mère, première actrice, deux filles de moins de vingt ans avec leurs maris et quelques autres parents. C’étaient des Siciliens. Le chef de troupe entra tout de suite chez Prisco pour se faire donner quelque chose de chaud pour sa femme qui avait la fièvre. Ils ne pourraient pas jouer ce soir-là, pas même peut-être le lendemain, mais ils restaient quelques jours. C’était un homme d’âge moyen déjà un peu gras, les joues tombantes et avec une exagération dans les gestes et dans l’expression qui faisait penser au jeu de Zacconi. Quand il sut que j’étais peintre il me demanda de lui peindre quelques décors dont il avait besoin, ça l’aurait bien arrangé, les siens étaient presque inutilisables à force d’être portés sur le char, exposés à la pluie et au soleil. Il me raconta qu’il avait fait partie de bonnes compagnies et qu’ensuite pour vivre il s’était adonné à cette vie errante avec sa femme et ses filles, toutes d’excellentes actrices. Il faisait le tour des villes de Sicile. Ici, en Lucanie, il n’était encore jamais venu. Il s’arrêtait dans les villes plus grandes et plus riches, plus ou moins longtemps, selon la recette. Mais on gagnait peu, la vie était difficile, une de ses filles était enceinte et bientôt elle ne pourrait plus jouer. Je lui dis que je peindrais volontiers les décors mais nous cherchâmes en vain en ville le papier ou la toile et les couleurs nécessaires et, à mon grand regret, je ne pus rien faire. Il m’invita quand même à la représentation qui aurait lieu dans deux jours et il me présenta sa compagnie. Le père était le seul de la famille qui rappelât le vieil acteur traditionnel. Les femmes n’étaient pas des actrices, mais des déesses. La mère et les deux filles se ressemblaient. Elles paraissaient sorties du sein de la terre ou descendues d’un nuage : leurs énormes yeux noirs étaient opaques et vides comme ceux des statues. Leurs visages marmoréens barrés par les sourcils noirs et épais et les bouches rouges et charnues se dressaient impassibles sur leurs blancs cous robustes. La mère était grande et opulente avec la sensualité paresseuse d’une Junon archaïque, les filles étaient minces et onduleuses et ressemblaient à des nymphes des bois qu’un caprice aurait fait s’envelopper de haillons bariolés.
Je me dépêchai d’aller demander aux gendarmes la permission de sortir le soir pour assister au spectacle. Le Dr Zagella, podestat de Grassano, n’aimait pas, à la différence de don Luigino, faire le policier et laissait aux gendarmes le soin de s’occuper des confinati. […]

Le soir de la représentation arriva enfin. La pluie avait cessé. Les étoiles brillaient, pendant que je me dirigeais vers l’extrémité du pays. Il n’y avait pas de salle grande ou petite pour servir de théâtre : on avait choisi une espèce de cave ou de grotte à moitié enfoncée sous terre et on avait posé des bancs de l’école sur le sol en terre battue. Au fond on avait dressé une petite estrade isolée par un vieux rideau. Le local était bondé de paysans qui attendaient le début du spectacle bouche bée. On jouait La Lumière sous le boisseau, de Gabriele d’Annunzio. Naturellement je n’attendais qu’ennui de ce drame plein de rhétorique, joué par des acteurs sans expérience et je n’escomptais de cette soirée que le plaisir du changement de la distraction. Mais il en fut tout autrement. Les femmes divines aux grands yeux vides, aux gestes pleins d’une passion figée et immobile comme ceux des statues jouaient admirablement et sur cette estrade large de quatre pas elles paraissaient gigantesques. Toute la rhétorique, le verbalisme, le vide ronflant de la tragédie s’évanouissaient et il restait ce qui aurait dû être et n’était pas l’œuvre de d’Annunzio : une histoire féroce chargée de passions immobiles s’affrontant dans l’univers intemporel des paysans. Pour la première fois une œuvre du poète des Abruzzes me paraissait belle, débarrassée de tout esthétisme. Je m’aperçus tout de suite que cette espèce de purification était due, plus encore qu’aux actrices, au public. Les paysans prenaient un intérêt très vif à l’histoire. Les villes, les fleuves, les montagnes dont on parlait n’étaient pas loin d’ici. Ainsi ils les connaissaient, ils habitaient des terres semblables à la leur et poussaient des exclamations, en entendant ces noms. Les esprits et les démons qui traversent la tragédie et qu’on sent à l’arrière-plan étaient les mêmes esprits et démons qui habitent ces grottes et ces argiles. Tout devenait naturel, replacé par le public dans son atmosphère véritable qui est le monde fermé, désespéré et sans expression des paysans.
Dépouillée ainsi par les acteurs et le public de tout son fatras d’annunzien, il ne restait plus de la tragédie que la matière brute, élémentaire et les paysans la sentaient leur. C’était une illusion, mais elle décelait la vérité. D’Annunzio était un des leurs, mais c’était un littérateur italien et il ne pouvait pas ne pas les trahir. Il était parti d’ici, d’un monde sans expression et avait voulu le draper dans les oripeaux brillants de la poésie contemporaine qui est toute en recherches d’expressions, sensualité, sentiment du temps. Il avait, par conséquent, réduit ce monde à n’être plus qu’un pur instrument de rhétorique et cette poésie à un vide formalisme linguistique. Sa tentative ne pouvait pas ne pas être une trahison et un échec. De cette union hybride ne pouvait naître qu’un monstre. Les actrices siciliennes et les paysans de Grassano avaient spontanément suivi la route inverse. Ils avaient fait tomber ces vêtements d’emprunt, et retrouvé à leur façon le noyau paysan, et cela les touchait et les enthousiasmait. Les deux mondes, mal amalgamés par l’esthétisme vide du poète, se scindaient à nouveau, tout contact était impossible et sous cette vague de paroles inutiles réapparaissaient pour les paysans la Mort et la Destinée vraies.