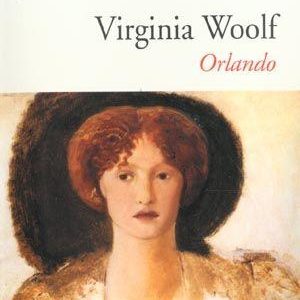Cette année, le flamand Guy Cassiers est invité au Festival d’Avignon pour une unique représentation, celle d’Orlando qu’il a créée en janvier 2013 avec Katelijne Damen. Ce grand lecteur s’empare cette fois du roman de Virginia Woolf, à partir duquel il propose une de ces lectures théâtrales dont il a le secret. Une fois de plus, le maître des images ravit les spectateurs prêts à tenter l’expérience.
 Le spectacle est construit comme un crescendo, qui suppose donc de fait un premier temps piano. Avant de dévoiler la force de sa scénographie, Guy Cassier impose au spectateur une scène entièrement consacrée au texte de Virginia Woolf, uniquement porté par Katelijne Damen dans une scénographie minimale. La barrière du flamand impose à proprement parler une activité de lecture des écrans de surtitres, chargés des phrases de Virginia Woolf.
Le spectacle est construit comme un crescendo, qui suppose donc de fait un premier temps piano. Avant de dévoiler la force de sa scénographie, Guy Cassier impose au spectateur une scène entièrement consacrée au texte de Virginia Woolf, uniquement porté par Katelijne Damen dans une scénographie minimale. La barrière du flamand impose à proprement parler une activité de lecture des écrans de surtitres, chargés des phrases de Virginia Woolf.
Comme s’il ouvrait lui-même le roman, le spectateur découvre donc le portrait d’un jeune Lord anglais du XVIe à l’âme romantique et mélancolique, attiré par la poésie. Proche de la reine Elizabeth 1ère, il vit le grand gel de 1608 au cours duquel il rencontre son premier amour, avant de se réfugier dans la littérature et de fuir la sentence du critique Nicholas Greene en Turquie. Là, il devient femme, passe une partie de sa vie auprès de tziganes avant de retourner à Londres, de vivre le passage du XVIIIe au XIXe siècle et d’assister à la révolution sensible des inventions de l’époque.
 Voilà en quelques lignes la vie de ce personnage extraordinaire, qui traverse les siècles et change de sexe à mi-parcours. Sur la scène, le roman est retracé dans son ensemble, mais avec des coupes en son centre qui tendent à l’amaigrir. Le style particulièrement inattendu de Virginia Woolf dans cette œuvre en pâtit un peu, et peut-être aurait-il été préférable de s’appesantir davantage sur certains épisodes, quitte à en évacuer d’autres. Quoi qu’il en soit, l’originalité de ce roman est en partie due à l’omniprésence d’un biographe, qui sans cesse se sert de la vie d’Orlando pour commenter et critiquer de façon humoristique quatre siècles de l’histoire anglaise en quelques centaines de pages seulement.
Voilà en quelques lignes la vie de ce personnage extraordinaire, qui traverse les siècles et change de sexe à mi-parcours. Sur la scène, le roman est retracé dans son ensemble, mais avec des coupes en son centre qui tendent à l’amaigrir. Le style particulièrement inattendu de Virginia Woolf dans cette œuvre en pâtit un peu, et peut-être aurait-il été préférable de s’appesantir davantage sur certains épisodes, quitte à en évacuer d’autres. Quoi qu’il en soit, l’originalité de ce roman est en partie due à l’omniprésence d’un biographe, qui sans cesse se sert de la vie d’Orlando pour commenter et critiquer de façon humoristique quatre siècles de l’histoire anglaise en quelques centaines de pages seulement.
C’est précisément cette posture qu’adopte Katelijne Damen sur la scène. Redonnant ainsi son importance à ce véritable personnage dans l’œuvre, elle tend néanmoins parfois vers l’incarnation, en particulier lors des tirades envolées d’Orlando sur le sens de la vie et des époques qu’il traverse. Là, son talent se révèle avec le plus d’évidence. Néanmoins, c’est à la mesure des contraintes que lui impose le metteur en scène qu’il convient d’évaluer la prouesse de Katelijne Damen.
 Comme à son habitude, Guy Cassiers accorde une place centrale à la vidéo, qui se manifeste donc dans un second temps, une fois que la posture de lecteur a été imposée au spectateur – posture que certains ne supportent pas, au point de leur faire quitter la salle. Le sol de la scène est fait d’un damier d’images, de huit à seize carrés, filmé par des caméras qui le surplombe, et dont l’image est projetée en direct sur le fond, fait d’un écran pas tout à fait neutre qui porte déjà l’empreinte du passé.
Comme à son habitude, Guy Cassiers accorde une place centrale à la vidéo, qui se manifeste donc dans un second temps, une fois que la posture de lecteur a été imposée au spectateur – posture que certains ne supportent pas, au point de leur faire quitter la salle. Le sol de la scène est fait d’un damier d’images, de huit à seize carrés, filmé par des caméras qui le surplombe, et dont l’image est projetée en direct sur le fond, fait d’un écran pas tout à fait neutre qui porte déjà l’empreinte du passé.
La capacité métamorphique de cette scène est à chaque séquence plus impressionnante, et surtout, à chaque fois plus poétique. Le secret de cette poésie réside dans le fait que l’image finalement construite n’est pas lisible au sol : les carrés placés dans le désordre ne s’agencent correctement que par le prisme des quatre caméras. De la sorte, les déplacements relativement limités de la comédienne sur cet espace constamment filmé sont rendus plus souples, et son apparition à l’écran, en décalage avec la scène, plus imprévisible.
 Ce dispositif particulièrement sophistiqué permet donc de modérer sa présence sur le fond, pour se focaliser plus majoritairement sur les dessins extrêmement soignés qui se trouvent au sol. À plusieurs reprises, comme dans l’œuvre, c’est l’image du chêne qui apparaît, celui-là même au pied duquel Orlando se jette régulièrement dans un élan romantique, et qui donne son titre à l’œuvre de sa vie, son poème tant de fois corrigé et réécrit. Dans ce parcours jusqu’au XXe siècle, il sert ainsi de fil rouge.
Ce dispositif particulièrement sophistiqué permet donc de modérer sa présence sur le fond, pour se focaliser plus majoritairement sur les dessins extrêmement soignés qui se trouvent au sol. À plusieurs reprises, comme dans l’œuvre, c’est l’image du chêne qui apparaît, celui-là même au pied duquel Orlando se jette régulièrement dans un élan romantique, et qui donne son titre à l’œuvre de sa vie, son poème tant de fois corrigé et réécrit. Dans ce parcours jusqu’au XXe siècle, il sert ainsi de fil rouge.
L’inventivité visuelle de cette scène se manifeste le plus clairement pour la première fois lorsqu’Orlando raconte comment le gel qui paralysait la Tamise a soudainement craqué un matin. L’image, bleutée par un filtre et animée d’un mouvement latéral, suggère ainsi les cassures de la glace. À cela s’ajoutent des effets sonores mesurés, qui contribuent eux aussi à redoubler les mots sans les illustrer, à donner à percevoir ce qui est dit, sans le donner à voir.
Par la suite, le départ d’Orlando à Constantinople est signalé par une ambiance tout autre. Comme on tourne les pages d’un livre, la comédienne dévoile d’autres carrés au sol. Apparaît alors une coupole orientale, qui magiquement, grâce à un gros zoom, donne à voir la langueur du personnage : dans les fresques apparemment imprécises de la coupole se cachent des paysages londoniens aux détails multiples.
 Ainsi déplié et déplacé, le damier dévoile sa richesse au fur et à mesure, et découvre de véritables œuvres qui ont une capacité surprenant à toucher le spectateur. Elles sont animées par les caméras, qui saisissent, composent, superposent et zooment, mais aussi par des filtres colorés qui déterminent différentes ambiances. Parfois s’ajoute le mouvement, comme lorsqu’Orlando arrive à Londres et fait l’expérience sensible du mouvement et de la vitesse, comme le narrateur de La Recherche un peu plus tôt. Le fond donne alors à voir un équivalent visuel de cette sensibilité, de plus en plus mise en valeur à mesure que progresse le roman.
Ainsi déplié et déplacé, le damier dévoile sa richesse au fur et à mesure, et découvre de véritables œuvres qui ont une capacité surprenant à toucher le spectateur. Elles sont animées par les caméras, qui saisissent, composent, superposent et zooment, mais aussi par des filtres colorés qui déterminent différentes ambiances. Parfois s’ajoute le mouvement, comme lorsqu’Orlando arrive à Londres et fait l’expérience sensible du mouvement et de la vitesse, comme le narrateur de La Recherche un peu plus tôt. Le fond donne alors à voir un équivalent visuel de cette sensibilité, de plus en plus mise en valeur à mesure que progresse le roman.
L’apogée de cette scénographie est probablement le moment où Orlando ressent physiquement, à son retour de Turquie, l’impératif de la société victorienne de se marier. Le frémissement de son annulaire gauche l’invite à se poser des questions existentielles, cette fois-ci non pas rapportées par la biographe mais bien incarnées. Surgit alors un monstre à deux têtes, qui dit autant l’androgynie d’Orlando, homme puis femme, que le dilemme qui la déchire. Tandis que la comédienne, le visage tourné vers les caméras au-dessus d’elle, exprime alors ses doutes, la technique visuelle de Guy Cassiers et Frederik Jassogne attache deux têtes à un même buste.
 À chaque étape de la vie d’Orlando, la scénographie s’enrichit donc, et révèle des potentialités insoupçonnables au départ. Rien n’est laissé pour compte, et même les côtés longuement laissés noirs finissent par être exploités, suivant la logique d’une construction progressive, de plus en plus raffinée. À mesure que le temps passe, la comédienne se dévêt et parsème le sol de ses fripes désormais anciennes, habitant de plus en plus cet espace au départ effroyablement neutre.
À chaque étape de la vie d’Orlando, la scénographie s’enrichit donc, et révèle des potentialités insoupçonnables au départ. Rien n’est laissé pour compte, et même les côtés longuement laissés noirs finissent par être exploités, suivant la logique d’une construction progressive, de plus en plus raffinée. À mesure que le temps passe, la comédienne se dévêt et parsème le sol de ses fripes désormais anciennes, habitant de plus en plus cet espace au départ effroyablement neutre.
Avec courage et talent, Katelijne Damen porte à elle seul ce spectacle profondément textuel, qui témoigne une fois de plus de l’amour de Guy Cassiers pour la littérature. Plus encore que dans ses spectacles précédents, cet artiste de l’intériorité œuvre ici avec sensibilité et une maîtrise impressionnante sur les perceptions de lecture, à la fois puissance et floues, comme ces images au sol qu’il travaille.
F. pour Inferno
Pour en savoir plus sur ce spectacle, rendez-vous sur le site du Toneelhuis d’Anvers.