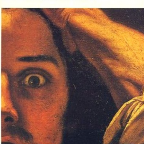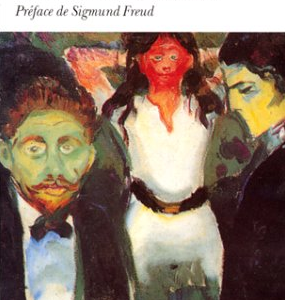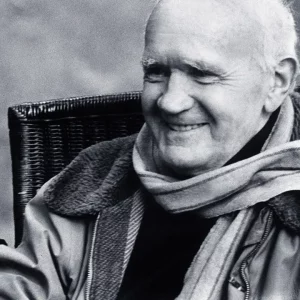En mai 1869, quelques mois après la parution de L’Idiot en feuilleton, Dostoïevski écrit au sujet de ce roman, à sa nièce S. A. Ivanovna :
L’idée principale du roman est de présenter l’homme positivement beau. Rien de plus difficile au monde, surtout actuellement. Tous les écrivains, les nôtres, et aussi ceux d’Occident, qui ont entrepris de représenter le positivement beau ont toujours passé la main. Parce que la tâche est démesurée. Le beau est l’idéal, et l’idéal, le nôtre ou celui de l’Europe, est encore loin d’être élaboré. Il n’existe au monde qu’une seule figure positivement belle : c’est le Christ, si bien que la manifestation de cette figure incommensurablement, infiniment belle est déjà, bien sûr, un miracle infini. (Tout l’Évangile de Jean va dans ce sens ; pour lui, l’unique miracle est dans l’incarnation, la manifestation même du beau.) Mais là je suis allé trop loin. Je me contenterai de rappeler que, de toutes les figures de la littérature chrétienne, Don Quichotte est la plus achevée. Mais il est beau pour l’unique raison qu’il est en même temps risible. Le Pickwick de Dickens (la pensée en est infiniment plus faible que Don Quichotte, mais malgré tout immense) est aussi risible et c’est là qu’il vous prend. De la compassion se fait jour envers le beau tourné en dérision et ignorant son prix, et, donc, de la sympathie chez le lecteur aussi. Cet éveil de la compassion est le secret même de l’humour. Jean Valjean, autre tentative puissante, ne suscite pourtant la sympathie que par son effroyable malheur et l’injustice de la société à son égard. Rien de tel chez moi, décidément rien, aussi ai-je terriblement peur que ce soit positivement un échec.
Le Prince Mychkine, s’il est loin d’être « positivement un échec » dans cette entreprise, offre une incarnation profondément ambivalente de la beauté et de la bonté.
Dans son dernier roman, Les Frères Karamazov, Dostoïevski s’essaie à nouveau à peindre « l’homme positivement beau » avec le personnage d’Aliocha Karamazov, et sa tentative est alors nettement plus concluante.

« Le troisième fils, Aliocha »
Il n’avait alors en tout et pour tout que vingt ans (son frère Ivan était dans sa vingt-quatrième année, alors que l’aîné des frères, Dmitri, était, lui, dans sa vingt-huitième). Avant toute chose, je déclarerai que ce jeune homme, Aliocha, était tout sauf un fanatique, et, à mon avis, même, pas du tout un mystique. J’exprimerai à l’avance mon opinion la plus tranchée : c’était tout simplement un précoce ami de l’humanité, et, s’il s’était lancé sur la voie monastique, c’était pour cette raison unique qu’à ce moment-là c’était la seule qui l’eût frappé et lui eût présenté, pour ainsi dire, l’idéal pour le salut d’une âme qui aspirait, hors de la haine d’ici-bas, à se jeter vers la lumière de l’amour. Et si elle l’avait frappé, cette voie, c’était seulement pour cette raison que c’était là qu’il avait alors rencontré un être qu’il jugeait extraordinaire – notre célèbre starets du monastère, Zossima, auquel il s’était attaché par le premier et brûlant amour de son cœur insatiable. Au reste, je ne le nie pas, même déjà à l’époque il était très étrange, et ce, depuis le berceau. À propos, j’ai déjà mentionné à son sujet le fait qu’ayant perdu sa mère alors qu’il n’avait pas encore quatre ans il avait conservé son souvenir toute sa vie, son visage, ses caresses, « exactement comme si elle était là, ou presque, devant moi ». Ce genre de souvenirs peut se graver (cela, tout le monde le sait) même à un âge encore plus tendre, même quand on a deux ans, mais il ressort alors tout au long de la vie comme par espèces de taches de lumière hors des ténèbres, comme un petit coin arraché à un tableau immense qui s’est tout entier éteint, effacé, à part juste ce tout petit coin-là. Pour lui, c’était exactement pareil : il avait gardé le souvenir d’un soir, un soir d’été, paisible, la fenêtre ouverte, les rayons obliques du soleil couchant (c’est de ces rayons obliques qu’il se souvenait le plus), dans la pièce, dans un angle, une icône, la petite veilleuse allumée devant, et, devant l’icône, agenouillée, comme prise d’une crise d’hystérie, poussant des glapissements, des hurlements saccadés, sa mère, qui l’avait pris dans ses deux bras, qui l’étreignait très fort, jusqu’à lui faire mal, et qui priait pour lui la Mère de Dieu, qui le tendait, lui, des deux bras, vers cette icône, comme pour que la Mère de Dieu le protège… et, brusquement, une nurse fait irruption, et elle l’arrache à elle, dans la frayeur. Voilà le tableau ! Aliocha gardait aussi de cet instant le souvenir du visage de sa mère : il paraissait en transe, disait-il, mais splendide, d’après ce qu’il pouvait s’en souvenir. Mais, ce souvenir, rares étaient ceux à qui il aimait le confier. Dans son enfance et son adolescence, il était resté peu expansif, voire peu bavard, et non pas par méfiance, par timidité ou par une taciturne sauvagerie, non, tout au contraire, comme à cause de quelque chose d’autre, comme une espèce de souci intérieur, proprement personnel, qui ne concernait pas les autres, mais de si important pour lui-même qu’à cause de lui, ces autres, c’était comme s’il les oubliait. N’empêche, les gens, il les aimait : il avait vécu, on pouvait croire, toute sa vie avec une foi complète envers les gens, et, pourtant, personne, jamais, ne l’avait pris pour un petit simplet ni pour un homme naïf. Il y avait quelque chose en lui qui vous disait et vous soufflait (et ce devait être vrai tout au long de sa vie) qu’il ne voulait pas se placer comme juge parmi les gens, qu’il ne voulait pas prendre sur lui de condamner, qu’il ne condamnerait pour rien au monde. On pouvait même croire qu’il admettait tout, sans condamner, mais en étant tout plein, parfois, d’une tristesse très amère. Bien plus, il en était arrivé, de ce point de vue, à ce que personne ne puisse plus ni l’étonner, ni lui faire peur, et ce même dans sa première jeunesse. Se présentant, à dix-neuf ans, chez son père, dans le lupanar absolu d’une débauche crasse, lui, pudique et pur, il se contentait de s’éloigner en silence quand voir lui devenait insupportable, mais sans le moindre air de mépris ou de condamnation pour qui que ce fût. Son père, lui, qui avait été jadis un pique-assiette, et était donc un homme très sensible et très fin sur le chapitre des offenses, qui avait commencé par l’accueillir d’un air méfiant et taciturne (« il se tait, quoi, beaucoup trop, il pense toujours dans sa tête »), s’était mis assez vite, au bout du compte, à le prendre dans ses bras et à l’embrasser à tout bout de champ, en à peine plus de deux semaines, avec, certes, des larmes d’ivrogne, une sensiblerie due à l’ivresse, mais en l’aimant, à l’évidence, d’un amour sincère et profond, et comme jamais, bien sûr, il n’avait su aimer personne…
Ce jeune homme, du reste, tout le monde l’aimait, où qu’il parût, et, cela, depuis ses toutes premières années d’enfance. Se retrouvant chez son bienfaiteur et son éducateur, Efim Pétrovitch Polénov, il s’était tellement attaché toute sa famille qu’on le considérait absolument comme un enfant, ou presque, de la maison. Et il était entré dans cette maison à un âge encore si enfantin, dans lequel il est absolument impossible d’imaginer chez un enfant une ruse calculatrice, une tartufferie ou un art de flatter et de plaire, un talent pour se faire aimer. Si bien que, ce don d’éveiller un amour tout particulier, il le possédait en lui-même, pour ainsi dire, dans sa nature en tant que telle, sans trace d’art aucune, d’une façon innée. Ç’avait été la même chose dans son école, et cependant, pourrait-on croire, il était justement de ces enfants qui éveillent à leur encontre la méfiance de leurs camarades, parfois les moqueries, voire la haine. Lui, par exemple, il restait pensif, c’était comme s’il se mettait à l’écart. Depuis sa toute petite enfance, il aimait se retirer dans un coin et lire des livres, et, néanmoins, ses camarades l’aimaient tellement qu’on pouvait réellement le qualifier de chouchou général, et, ce, pendant tout le temps de sa scolarité. Il était rare qu’on le vît exubérant, et même rarement joyeux, mais il suffisait qu’on le regarde pour se convaincre que ce n’était pas du tout parce qu’il était, je ne sais pas, sombre, non, au contraire, son caractère était égal et clair. Il ne voulait jamais se mettre en avant avec ses condisciples. C’est peut-être bien pour cette raison qu’il n’avait jamais peur de rien, mais, néanmoins, les gamins avaient tout de suite compris qu’il ne fanfaronnait pas du tout avec son courage, que c’était comme s’il ne comprenait pas lui-même qu’il avait du courage, qu’il n’avait jamais peur. Il ne se souvenait jamais des offenses. Il arrivait qu’une heure après l’offense il répondit à l’offenseur, ou que, lui-même, il lui adressât la parole d’un air aussi confiant et clair que c’était à croire s’il ne s’était même jamais rien passé entre eux. Et ce n’est pas que, ce faisant, il ait eu l’air d’avoir fortuitement oublié ou expressément pardonné cette offense, non, simplement, il ne la considérait pas comme une offense, et c’est cela qui, réellement, séduisait et conquérait les enfants. Il n’y avait en lui qu’un seul trait qui, dans toutes les classes du lycée, depuis la première et jusqu’aux toutes dernières, éveillait toujours chez ses camarades le désir de se payer un peu sa tête – et non par moquerie méchante, mais parce que ça les faisait rire. Ce trait était une espèce de pudeur, de pudibonderie frénétique, farouche. Il n’arrivait pas à entendre certains mots et certaines conversations qu’on sait sur les femmes. Ces mots et ces conversations « qu’on sait », malheureusement, dans les écoles, sont indéracinables. Les gamins, purs dans l’âme et le cœur, presque encore des enfants, aiment très souvent parler entre eux pendant les classes, et même à haute voix, de certaines choses, de certains tableaux, de certaines images dont des soldats ne parleraient pas toujours – bien plus, les soldats, justement, il y a plein de choses dans ce genre-là qu’ils ignorent ou qu’ils ne comprennent pas que les enfants si jeunes de notre intelligentsia et de la haute société savent déjà parfaitement. Il n’y a pas encore là, me semble-t-il, de perversité morale, il n’y a pas non plus de vrai cynisme, un cynisme vicieux, intérieur, mais il y en a un extérieur, et c’est celui-là que l’on considère souvent comme quelque chose de fin, de délicat, de drôle et de digne d’imitation. Voyant qu’« Aliochka Karamazov », quand ils se mettaient à parler « de ça », se bouchait très vite les oreilles, ils se plaçaient parfois en foule autour de lui et, lui ôtant les mains de force, lui criaient des saletés dans les deux oreilles, tandis que, lui, il se débattait, s’affaissait sur le sol, se couchait, se couvrait, et toujours sans leur dire un seul mot, sans les invective, en supportant l’offense sans mot dire. À la fin, malgré tout, ils le laissaient tranquille et ne le traitaient plus de « fillette », bien plus, ils le regardaient, de ce point ce vue-là, avec compassion. À propos, à l’école, il avait toujours été parmi les meilleurs à l’étude, mais jamais on ne l’avait vu premier.
À la mort d’Efim Pétrovitch, Aliocha était encore resté deux ans dans le lycée provincial. L’inconsolable épouse d’Efim Pétrovitch, presque tout de suite après sa mort, était partie faire un long séjour en Italie avec toute sa famille, qui n’était composée que de personnes du sexe féminin, tandis qu’Aliocha se retrouvait chez deux certaines dames, qu’il n’avait auparavant jamais vues, des espèces de parentes éloignées d’Efim Pétrovitch, mais, aux frais de qui, lui-même ne le savait pas trop. Un autre des traits de son caractère, et de ses traits les plus frappants, était qu’il ne s’était jamais soucié de savoir qui l’entretenait précisément. De ce point de vue-là, il était le contraire absolu de son frère aîné, Ivan Fiodorovitch, qui avait tiré le diable par la queue pendant ses deux premières années à l’université, en vivant de son travail, et qui, depuis sa petite enfance, avait ressenti avec amertume qu’il vivait sur le pain des autres, chez un bienfaiteur. Pourtant, il était impossible, je crois, de condamner avec trop de rigueur ce trait étrange du caractère d’Aliocha, parce que toute personne qui commençait à le connaître ne serait-ce qu’un petit peu, tout de suite, quand cette question venait à surgir, était persuadé qu’Alexéï faisait évidemment partie de ces jeunes gens qui sont comme des innocents de village, de ces gens qui, s’il leur tombait dessus même un grand capital, ne feraient aucune difficulté pour le donner, et même à la première demande, soit pour une bonne action, soit, peut-être, au premier escroc un peu habile, si ce dernier venait à le leur demander. Et puis, généralement parlant, tout se passait comme s’il ne savait pas du tout la valeur de l’argent, ceci dit, évidemment, pas au sens littéral. Quand on lui donnait de l’argent de poche, que, lui-même, il ne demandait jamais, tantôt, pendant des semaines, il ne savait pas quoi en faire, tantôt il le dilapidait à une vitesse terrible, et tout disparaissait en un clin d’œil. Piotr Alexandrovitch Mioussov, un homme tout à fait chatouilleux sur le chapitre de l’argent et plein d’une honnêteté bourgeoise, ayant, une fois, par la suite, observé Alexéï, avait prononcé sur lui l’aphorisme suivant : « Voilà sans doute le seul être au monde qui, si vous le laissez soudain seul et sans le sou sur la grand-place d’une ville d’un million d’habitants qu’il ne connaît pas, ne se perdra jamais et ne mourra ni de faim ni de froid, parce que tout le monde, en un instant, lui donnera à manger, le logera, et, si on ne le loge pas, c’est lui-même, en un instant, qui se logera tout seul, et ça ne lui coûtera pas le moindre effort, pas le moindre abaissement, et, pour le logeur, pas le moindre dérangement, au contraire, peut-être bien, on prendra ça pour un plaisir. »
Au lycée, il n’avait pas fini ses études ; il lui restait encore à faire une année entière, quand, brusquement, il avait déclaré à ces deux dames qu’il partait chez son père pour une certaine affaire qui lui était venue en tête. Ces dames l’avaient beaucoup plaint, et avaient d’abord refusé de le laisser partir. Le voyage coûtait très peu cher, les dames ne lui avaient pas permis de mettre en gage sa montre – cadeau de la famille de son bienfaiteur avant leur départ pour l’étranger –, mais l’avaient somptueusement fourni en moyens, renouvelant même sa garde-robe et son linge de corps. Lui, néanmoins, il leur avait rendu la moitié de l’argent, déclarant qu’il voulait absolument voyager en troisième.
Arrivé dans notre petite ville, il avait laissé les premières questions de son géniteur : « Qu’est-ce qui t’amène maintenant, sans avoir fini le lycée ? » sans réponse directe, mais s’était montré, à ce qu’on rapporte, extraordinairement pensif. On avait su peu de temps après qu’il recherchait la tombe de sa mère. Il l’avait même avoué lui-même sur le moment, qu’il ne venait que dans ce but. Mais je doute que toute la raison de sa venue se fût épuisée là. Le plus probable est qu’à ce moment, la vraie raison, il l’ignorait lui-même, et il n’aurait pas su expliquer ce que c’était précisément qui s’était comme brusquement levé hors de son âme et l’avait entraîné irrésistiblement sur une sorte de chemin nouveau, inconnu, mais inévitable. Fiodor Pavlovitch n’avait pas pu lui indiquer où il avait inhumé sa seconde épouse, parce qu’il n’était jamais retourné sur sa tombe après qu’on eut mis le cercueil en terre, et, vu le temps qui s’était passé, l’endroit de la sépulture s’était complètement effacé de sa mémoire…
Traduction d’André Markowicz