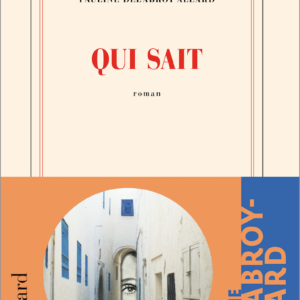Mausolée. Tu as ramassé sur le sol les feuilles par nos corps éparpillées. Je t’ai regardé faire en tirant lentement sur cette cigarette que tu venais de rouler, tes cigarettes épaisses, sans filtre, qui m’avaient toujours un peu brûlé, la gorge, les yeux, mais que j’aimais tant fumer, juste après. Je t’ai regardé les reposer soigneusement sur le bureau, une à une, dans l’ordre, hypnotisée par cette vision. Fascinée et inquiète, d’être soudain, démasquée.
Peut-être as-tu saisi à la dérobée quelques mots, une ou deux phrases. Peut-être est-ce que cela t’a suffi. Je m’étais tant de fois imaginé ce jour-là, celui où tu tiendrais le livre entre tes mains, confus, troublé, ne comprenant pas tout à fait, n’étant pas bien sûr, ou bien, ayant compris tout de suite peut-être, dès la première page, dès la première ligne, ayant toujours su, bien avant moi, même, que c’est ainsi que tout finirait. Tu m’avais demandé, un soir que nous étions l’un contre l’autre, allongés au bord de cette rivière, lassés, épuisés, par L’amour que durant des heures – est-ce que ça aussi tu finiras par l’écrire ?
Mausolée, c’est un beau titre, tu veux pas m’en parler un peu ? J’ai détourné le regard, vaguement souri, haussé les épaules. Alors le titre te plaît, c’est drôle. Si seulement tu savais. Je ne t’ai pas répondu. Qu’aurais-je bien pu te dire ? Que ce mausolée aurait dû être le tien, fragile monument que je m’étais efforcé de bâtir, non pas à ta gloire, mais pour te détruire, saccager pour toujours ton image et cet immense amour que j’avais eu, de toi. Que ce mot avait surgi comme ça un matin, sans que je comprenne vraiment d’où, ni pourquoi, et je l’avais tout de suite choisi comme titre. Alors, quand je ne doutais pas qu’avec tout cela je ferais un livre, un vrai, que rien de tout cela ne serait perdu, qu’elle n’aurait pas été en vain, cette douleur. Oui mais, tu. Te tenais là, nu devant moi, ta silhouette découpée précisément dans la pénombre de la pièce, bien plus dense, bien plus réelle que toutes choses alentour, que le livre. Effondré, le livre, réduit à rien, ces centaines d’heures, ces milliers de mots, anéantis par cet événement-là. Ton corps.
Je croyais pourtant que cela m’aiderait à finir de revenir. Ici, où tout avait commencé. Je croyais qu’il me fallait revoir la ville, parcourir à nouveau les lieux, les couleurs, la scène où l’histoire s’était déroulée. Je suis revenue, je t’ai revu et tu es reparti. Et maintenant je suis. Seule, avec le livre impossible. Et je comprends alors comme je m’étais trompée en croyant qu’il me suffisait de le vouloir pour t’oublier, de le dire pour le faire. Comme si cela avait quoi que ce soit à voir, avec la raison, la volonté. En croyant que les mots, pouvaient pour nous, quelque chose. Pourtant ce soir encore je vais continuer à. Écrire. Juste parce que je ne sais quoi faire d’autre. C’est peut-être pour ne pas m’effondrer tout à fait, tenir. À la page, m’accrocher à ces signes que frénétiquement j’y dépose. Pour tromper l’attente. Pour, passer le temps, cette nuit. Pour les retenir, peut-être. Comme s’il avait été possible, par ce geste-là, le mouvement de ma main et le bruit du stylo sur la feuille, possible de retenir un peu de ce qui s’enfuit à nouveau, déjà, trop vite, qui n’en a pas fini de s’enfuir, dont il ne restera bientôt plus rien. Rien qu’un vague souvenir, sans épaisseur, sans chair et sans odeur. De cette douleur si vive même, bientôt, trop vite, je ne saurai plus rien. Hier, c’était juste hier que je t’ai revu. Déjà tout me semble si loin, il me faut faire vite avant que tout ne m’échappe.
Il me semble pourtant qu’il me suffirait presque de me retourner pour te voir encore là, derrière, moi, rire. On a tellement ri. Comme on riait toujours, de tout et de rien, juste de cette joie d’être ensemble, inépuisable alors. Oui, je riais tout le temps, parce qu’en toi, tout toujours m’étonnait, m’enchantait, cette façon que tu avais de voir le monde, d’y déceler partout l’absurde, de relever toujours les décalages, les petites dissonances du réel, et ces expressions que tu inventais, qui ne voulaient rien dire et pourtant tu jurais toujours les avoir entendues quelque part, et je les adoptais tout de suite, alors on se mettait à les dire beaucoup toi et moi, et l’on s’était forgé à force, une langue qui n’était comprise que de nous. Et je riais chaque fois de l’air surpris de ceux auxquels tu t’adressais ainsi, et il fallait toujours répéter, expliquer, et toujours ensuite tu disais qu’est-ce qu’elle est chiante leur langue à eux, et encore je riais. Alors, quand il y avait eux, et nous. Ton rire qui, à l’instant même où je l’écris, ton rire, doit se perdre dans la clameur de quel bar, mêlé à tant et tant d’autres rires et peut-être, le sien. Où es-tu, toi, dans cette nuit qui commence ? Penses-tu un peu à moi, là où tu es ? Penses-tu un peu à l’amour que nous avons fait, à cette nuit, ou bien l’as-tu déjà, d’un geste, renvoyée dans le passé dont elle n’aurait peut-être jamais dû revenir ? Là où je veux rester encore un peu, moi et penser à toi, encore me rappeler ton corps tel qu’il était cette nuit tout contre moi, tel que déjà il n’existe plus, avant qu’il ne se fonde dans l’épaisseur phénoménale du monde, du temps. Avant que je ne le perde à nouveau. Oui, je vais cette nuit encore écrire, parce que je ne veux pas oublier, pas tout de suite, que je ne suis pas prête encore à, te laisser partir. Demain peut-être, demain. Ce sera fini.