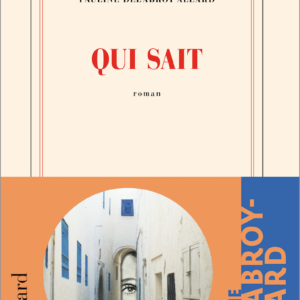J’aurais dû dire que je ne savais pas, mais je n’ai rien dit. « Pourquoi tu me regardes comme ça ? », cela faisait bientôt six mois que j’étais à nouveau seule dans les cafés et que, régulièrement, on me posait la question. Sans m’en rendre compte, manifestement, je fixais les gens. « Pourquoi tu me regardes comme ça ? », c’était la voix d’une femme aux cheveux longs et lisses, noirs, quoique parsemés de quelques fils blancs, une femme que je ne connaissais pas et, c’est vrai, pourquoi la regardais-je comme ça ? J’aurais dû inventer quelque chose, un prétexte, sans doute, mais je n’ai rien dit. Je n’ai rien dit et j’ai pensé : écoute, sans doute parce qu’il n’y a qu’un café ouvert jusqu’à 21 heures à Saint-Jean-des-Oies, 496 habitants à l’année, ce qui ne fait pas grand monde à regarder, un café seulement et en son sein deux serveuses qui sont sœurs, jumelles pour le moins désagréables qui, si vous avez le malheur de demander à manger à 14 heures, vous rétorquent vivement un « Il est un peu tard pour ça, vous ne croyez pas ? ». Un bistrot existe aussi, plus loin, près de l’église, enseigne tenue par Dédé et originalement intitulée « Chez Dédé », où l’on vient échanger quelques idées au comptoir dans la matinée, à partir de 7 heures, mais qui ferme impérativement à 15 et n’espérez pas négocier – « Vous êtes marrant, vous, c’est quand que je fais ma sieste moi, si je ferme pas à ce moment-là ? » Il y a aussi la boulangerie près de l’église, qui accueille régulièrement de nouvelles espèces de bonbons, la boulangerie et son accès pour fauteuil roulant, Dieu soit loué, il y a l’église bien sûr, église qu’on a failli fermer faute de visites, même si la majeure partie des habitants de Saint-Jean-des-Oies – des habitants à l’année s’entend – la fréquentent assidûment, et qu’y peuvent-ils s’ils ne sont pas nombreux même quand ils y vont tous ensemble à l’église, c’est qu’elle est trop grande cette église, plus grande que la boucherie en tout cas, la boucherie juste à côté, où la patronne ressemble à un patron et où le patron ressemble à ses viandes, la boucherie où à la demande on vous sert des plats cuisinés, lasagnes et gratin dauphinois, ça va de soi, dans diverses barquettes ou Tupperware. Il y a encore une poissonnerie avec ça, enseigne qui ouvre seulement pendant quatre mois, une poissonnerie et une sorte d’épicier à son cul, « vendeur de bricoles », comme il se présente lui-même, un vendeur de bricoles et puis c’est tout. Au-dela de ça, à Saint-Jean-des-Oies, il n’y a rien.
Rien que du silence, du vent, des maisons vides et une grande plage rose.
Ce n’est pas la plage d’Elafouissi, pas une plage de Crète scintillante, il n’y a pas de source géothermique faisant remonter la chaleur, aucun de ces tessons de verre polis, sublimés en Californie, on ne s’y baigne ni avec les baleines ni avec les cochons, pas de falaises immenses ni de coins de paradis azur, aucune arche de pierre monumentale mais plutôt : une étendue plate, des cabanes de plastique vidées, des cadavres de méduses échoués, le souvenir du petit garçon qui se noya l’an passé au milieu des touristes et des sorbets à prix cassés, des traces de pique-nique entremêlées aux coquillages, quelques mégots ici, ailleurs un tesson de bouteille et même là, tiens donc, une seringue – et puis sur cette plage partout des algues que personne ne vient plus ramasser l’hiver, des algues qui sont peut-être des bactéries, des algues sombres et des algues roses, d’un rose ambigu, oscillant entre le marron et le pourpre, « bâtard du rouge triomphant », un rose éphémère et autrement plus sale que celui que les gens de culture ont l’habitude de nommer « rose sale ». C’est une plage que d’aucuns diraient laide ou quelconque, une plage devant laquelle ne s’ébahissent pas les touristes, ne se contorsionnent pas les acheteurs, s’arrêtent à peine les riverains. C’est une plage rose et abandonnée. Une plage qui n’appartient qu’à moi.
C’est le pays de mon père, celui de ma deuxième enfance, celle qui commença à six ans, quand il me déplaça et, « je ne sais pourquoi on est toujours fier du pays de sa famille ; peut-être ne le reverra-t-on jamais mais le pays de notre père a sans doute plus d’importance que notre propre lieu de naissance ». De Rennes, où j’étais née, je ne connaissais plus aujourd’hui que la rue de la Soif, une blague de cul sur les Bretons et sa place honorable au « palmarès des villes où il fait bon vivre ». De Saint-Jean-des-Oies en revanche, je savais tout. Je savais tout parce que je l’avais appris par cœur, parce que ce village m’avait structuré le cœur, même, et que malgré ses manques, j’éprouvais du réconfort à me trouver près de la mer alors que je ne savais plus bien qui j’étais, quelles études je faisais, ou j’allais et pourquoi. Je ne possédais plus qu’un lambeau d’identité, mais, sans doute – et c’est Saint-Jean qui me le rappelait –, j’avais une histoire. À défaut d’être quelque chose, j’étais quelque chose comme un chemin.
Un chemin semé de méduses, cela étant. Créatures qui avaient été la grande affaire de mon enfance, et sur lesquelles, désormais, je m’arrêtais.
Bien forcée de s’y arrêter, l’été, oui, tous les vingt mètres, empêchée dans chaque parcours sur la plage par ces sortes de cerveaux géants, masses blanches et lisses, poids gélatineux dans lequel les enfants, à commencer par moi, aimaient à jeter des cailloux, des couteaux, tout coquillage pointu sur lesquels, d’ordinaire, ils se blessaient eux mais à l’aide desquels, là, mus par une hargne d’autant plus terrible qu’elle était amusée, ils blessaient le corps de l’animal mort. Pourquoi aimions-nous tant à souiller les cadavres, sans une once de culpabilité, qu’est-ce qui, au juste, nous prenait ? Il faut dire que ces bêtes, immenses ombrelles gorgées d’eau, n’étaient pas des méduses banales mais des sortes de créatures dégénérées, propres à l’océan Atlantique. Dans notre tête des animaux hors normes, qui avaient des noms si compliqués que c’était humiliant ; on n’arrivait pas à les retenir et encore moins a les prononcer. Rhizostoma octopus, elles s’appelaient – je viens de vérifier sur Wikipédia. Saletés. Saletés, oui, mais pas même mortelles ; les méduses de Saint-Jean-des-Oies n’étaient pas dangereuses, à peine venimeuses, on aurait dit des méduses lâches, qui venaient s’échouer ici faute d’autre chose à essayer. Des méduses ayant lâché l’affaire. Leur nombre, exponentiel à mesure que le climat se réchauffait, nous alarmait. Ces créatures, signes de la fin des temps, étaient symptômes d’une catastrophe, mais d’une catastrophe qui n’avait rien de romantique, rien de vaillant : c’était une catastrophe molle, la catastrophe de l’ennui et de la lâcheté. Nos méduses signalaient le désastre visqueux qui vient. À les voir, on sentait bien que quelque chose n’allait pas dans ce monde, et que pourtant tout continuerait.
Paraît-il que la méduse est le plus vieil animal terrestre – la Turritopsis Dohrnii du moins, petite méduse d’un centimètre de diamètre originaire de Méditerranée ayant la faculté de rajeunir en cas de manque de nourriture. Les visqueuses nous précédaient, sans doute nous succéderaient, et peut-être qu’à la manière tant on se rappelle aujourd’hui les dinosaures, elles parleraient un jour de nous, nous transformeraient en jouets pour enfants, nous donneraient des surnoms, les yeux écarquillés, à demi ébahies et à demi condescendantes – et sans doute est-ce de pressentir cela qui nous faisait lancer des coquillages pointus sur leurs cadavres, quand le jour tombait sur Saint-Jean-des-Oies. En les blessant, nous nous vengions, comme nous pouvions, de cette espèce qui nous survivrait. En souillant la méduse morte, nous assassinions ce spectre éternel qu’était pour nous la méduse vivante.
Car vivante, la méduse était bel et bien un spectre. Un membre fantôme de l’Océan dont je passais tout mon temps, dans l’eau, à éprouver l’absence. Je ne me baignais jamais l’esprit tranquille, à Saint-Jean-des-Oies, craignant sans cesse l’arrivée de l’octopus, ses tentacules mesquins, son ventre de caoutchouc – et je peux affirmer aujourd’hui que l’idée de la méduse a gâché les plus belles de mes heures d’insouciance. Un peu comme le terrorisme, la guerre ou la catastrophe climatique, la méduse était ce que l’on pressentait avec inquiétude sans jamais la voir de nos yeux. Non qu’elle ne fût pas effective, avérée, bien sûr que la méduse vivante existait, mais simplement qu’elle nous faisait moins souvent mal que peur. Et toute l’enfance je fus effrayée par la possibilité d’une méduse vivante et hargneuse dont je ne sentis, pourtant, jamais la chaleur.
La créature absente me rappelait en fait à cette vérité : C’est toujours ce qui n’est pas là qui nous obsède le plus. Dans l’eau m’obsédaient les méduses que je n’avais jamais senties qu’une ou deux fois comme, sur ma plage rose, je songeais sans cesse à Elia. C’était l’hiver, à présent, et ce qui comptait était l’absent.