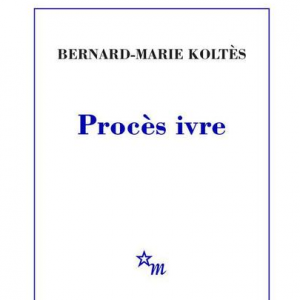Ludovic Lagarde fait partie des rares metteurs en scène aujourd’hui qui montent des textes de théâtre – de Tchekhov, Brecht, Shakespeare, Sarah Kane, Büchner, Jelinek… et d’autres moins renommés qu’il contribue à faire connaître. Avec un tel répertoire, il paraissait inévitable qu’il en vienne à Koltès. Lagarde ne choisit pas l’une des plus connues de cet auteur, mais Quai ouest, qui n’a fait l’objet que d’une vingtaine de mises en scène en France depuis la création de Patrice Chéreau en 1986. C’est justement au même endroit, à Nanterre, qu’est programmé le spectacle, mais dans le bâtiment temporaire, en attendant la fin des travaux. Entouré de ses acteurs fétiches, Lagarde promet un beau spectacle. Le rendez-vous est cependant manqué, ce spectacle ne sera pas mémorable comme ont pu l’être L’Avare ou la trilogie Büchner. À défaut d’être embarqué, on aura pensé à tout ce que pourrait ou devrait être une mise en scène de ce texte.
 Dans la pénombre de la scène, un lieu non identifié, une zone, un de ses endroits où il ne fait pas bon rester trop longtemps. « Un hangar désaffecté de l’ancien port », indique Koltès. Un homme s’approche d’une forme informe et lui donne du bout de la chaussure pour voir si ça vit. Le corps recroquevillé s’élève pour se défendre et quelques flocons volent dans le mouvement. Ce préambule silencieux vient illustrer la longue didascalie initiale de la pièce, préambule narratif qui pose d’entrée de jeu de multiples problèmes à la représentation. Plutôt que de soulever ces problèmes, de s’y confronter, Lagarde prend le parti de les illustrer… partiellement. Viennent ensuite des bruits de voiture dans la nuit, Christèle Tual entre avec une béquille et un sac Gucci, et elle se lance dans le premier monologue. La langue de Koltès s’impose, à la fois écrite et parlée, écrite dans le parler, suivant une tension presque précieuse qui la rend difficile à dire, à jouer. Mais l’actrice tient tête au texte, tant et si bien que ce que l’on voit, ce que l’on entend, c’est ça, ce désir de tenir tête au texte. En quelques minutes, l’essentiel est dévoilé : cette mise en scène consistera à illustrer le texte, autant que possible, et à se débattre avec lui pour le faire entendre.
Dans la pénombre de la scène, un lieu non identifié, une zone, un de ses endroits où il ne fait pas bon rester trop longtemps. « Un hangar désaffecté de l’ancien port », indique Koltès. Un homme s’approche d’une forme informe et lui donne du bout de la chaussure pour voir si ça vit. Le corps recroquevillé s’élève pour se défendre et quelques flocons volent dans le mouvement. Ce préambule silencieux vient illustrer la longue didascalie initiale de la pièce, préambule narratif qui pose d’entrée de jeu de multiples problèmes à la représentation. Plutôt que de soulever ces problèmes, de s’y confronter, Lagarde prend le parti de les illustrer… partiellement. Viennent ensuite des bruits de voiture dans la nuit, Christèle Tual entre avec une béquille et un sac Gucci, et elle se lance dans le premier monologue. La langue de Koltès s’impose, à la fois écrite et parlée, écrite dans le parler, suivant une tension presque précieuse qui la rend difficile à dire, à jouer. Mais l’actrice tient tête au texte, tant et si bien que ce que l’on voit, ce que l’on entend, c’est ça, ce désir de tenir tête au texte. En quelques minutes, l’essentiel est dévoilé : cette mise en scène consistera à illustrer le texte, autant que possible, et à se débattre avec lui pour le faire entendre.
On pourrait croire qu’il y aura quand même plus, quand Koch supplie Charles de le guider jusqu’au bord du fleuve et de lui trouver deux pierres, et qu’il se dépouille pour le convaincre de ses cartes de crédits, de ses bagues, de sa montre (mais pas les chaussures quand même). Le contre-jour est saisissant dans le clair-obscur maintenu depuis le début, ce sont deux jambes que Laurent Poitrenaux affronte, sans l’ombre d’une ironie. Le haut disparaît car un store, progressivement visible, est à moitié baissé. Charles renvoie tout ce que le riche bourgeois venu mourir dans le fleuve lui propose, il refuse le deal en lui disant : « Rappelez-vous, mon vieux, rappelez-vous que quoi qu’il arrive, je suis d’accord avec vous ». Viennent ensuite Fak et Claire, pour une scène magnifique, la première d’une série qui pourrait constituer une œuvre à elle toute seule. Fak voudrait faire entrer Claire dans un recoin sombre, la faire « passer là-dedans », il argumente en virtuose, maître de la langue autant que de l’art de la manipulation – d’autant plus virtuose que Claire, bien loin de perdre pied, sait se défendre et lui répondre mot pour mot. Alors que les recoins de la scène n’ont toujours pas été révélés au regard, que l’obscurité persiste malgré ses métamorphoses depuis le début, le bras de fer s’intensifie. Nuit ou jour, crépuscule ou aube, le moment est indécidable. La perception de Claire, qui boit trop de café et passe ses nuits sans dormir, s’interpose peut-être. Des fils paraissent se tisser et ainsi faire entrer dans les arcanes du texte.
 Mais non. Le corps de Koch tombe à l’eau, eau figurée sur un écran en fond de scène – quand ce n’est pas la pluie, ou le ressac grâce à des lignes troubles, ou des étoiles. Le clair-obscur qui nous sollicite depuis le début car il nous résiste, laisse place au soleil qui dérange Charles. Désormais, les lumières seront constamment changeantes, la résistance laisse place à une variété qui plutôt que de susciter la curiosité laisse progressivement indifférent. Il apparaît progressivement qu’il n’y a pas de parti pris qui permette d’entrer dans l’œuvre de Koltès, la mise en scène est littérale. S’enchaînent les confrontations ménagées par Koltès dans ce non lieu, cet endroit où il n’y même plus d’eau, dernier signe d’abandon, ce piège dont personne ne peut se libérer, où tous les personnages errent en se donnant l’impression de prendre des décisions : les bourgeois qui s’y retrouvent pour mourir comme ceux qui y vivent, émigrés d’Espagne ou d’ailleurs. Le seul combat qui reste n’est pas celui des personnages entre eux, qui échangent tout (clés de voiture, kalach, botte, briquet, corps, mouchoir…), mais celui des acteurs avec le texte.
Mais non. Le corps de Koch tombe à l’eau, eau figurée sur un écran en fond de scène – quand ce n’est pas la pluie, ou le ressac grâce à des lignes troubles, ou des étoiles. Le clair-obscur qui nous sollicite depuis le début car il nous résiste, laisse place au soleil qui dérange Charles. Désormais, les lumières seront constamment changeantes, la résistance laisse place à une variété qui plutôt que de susciter la curiosité laisse progressivement indifférent. Il apparaît progressivement qu’il n’y a pas de parti pris qui permette d’entrer dans l’œuvre de Koltès, la mise en scène est littérale. S’enchaînent les confrontations ménagées par Koltès dans ce non lieu, cet endroit où il n’y même plus d’eau, dernier signe d’abandon, ce piège dont personne ne peut se libérer, où tous les personnages errent en se donnant l’impression de prendre des décisions : les bourgeois qui s’y retrouvent pour mourir comme ceux qui y vivent, émigrés d’Espagne ou d’ailleurs. Le seul combat qui reste n’est pas celui des personnages entre eux, qui échangent tout (clés de voiture, kalach, botte, briquet, corps, mouchoir…), mais celui des acteurs avec le texte.
Leurs affrontement se déroulent dans la scénographie d’Antoine Vasseur, proprette à l’exception de quelques taches d’eau au sol qui viennent troubler sa monochromie. Elle retient cependant l’attention car elle est multiplement trouée, par des passages, des fenêtres, la porte du hangar qui s’ouvre et se ferme – ouvertures par lesquelles se laisse apercevoir l’écran du fond sur lequel sont projetées les textures aquatiques. On se prend à regretter les containers de Chéreau, mais l’espace a pour qualité d’être ludique, poreux. Il peut être pénétré par tous les côtés, dans tous les sens, sans qu’il ne soit jamais possible de trancher où est la frontière entre le dedans et le dehors. En outre, il permet un enchaînement cinématographique des scènes : le temps d’un noir, un nouveau duo ou trio prend place pour un nouvel affrontement.
 Il est cependant dommage que la seule ambition de Lagarde et son équipe soit de donner le texte à voir et à entendre. Qu’il n’y ait pas de déplacement sensible permettant de mieux le pénétrer – d’autant que de tels déplacements sont suggérés par Koltès. Monique demande à Claire et Fak s’ils n’ont pas entendu un plouf ; la didascalie qui indique qu’un corps est tombé dans l’eau n’arrive qu’après. Ce genre d’indice ouvre des brèves dans le texte, des failles vertigineuses dans lesquelles il faudrait s’engouffrer tout entier. Les décalages sonores de ce type invitent à adopter des perspectives subjectives – celles qui s’entremêlent au point de faire perdre toute tangibilité aux dialogues Procès ivre –, à déréaliser la scène et les situations pour rendre possible cette langue qui ne colle pas avec ces personnages, car elle est trop sophistiquée. Plutôt que s’assujettir au texte, il faudrait l’aborder de biais, le prendre par surprise, avec non pas pour seule ambition de le faire entendre, mais d’y faire entrer (comme Fak). Lagarde dit avoir voulu sa mise en scène onirique, elle l’est malheureusement bien peu…
Il est cependant dommage que la seule ambition de Lagarde et son équipe soit de donner le texte à voir et à entendre. Qu’il n’y ait pas de déplacement sensible permettant de mieux le pénétrer – d’autant que de tels déplacements sont suggérés par Koltès. Monique demande à Claire et Fak s’ils n’ont pas entendu un plouf ; la didascalie qui indique qu’un corps est tombé dans l’eau n’arrive qu’après. Ce genre d’indice ouvre des brèves dans le texte, des failles vertigineuses dans lesquelles il faudrait s’engouffrer tout entier. Les décalages sonores de ce type invitent à adopter des perspectives subjectives – celles qui s’entremêlent au point de faire perdre toute tangibilité aux dialogues Procès ivre –, à déréaliser la scène et les situations pour rendre possible cette langue qui ne colle pas avec ces personnages, car elle est trop sophistiquée. Plutôt que s’assujettir au texte, il faudrait l’aborder de biais, le prendre par surprise, avec non pas pour seule ambition de le faire entendre, mais d’y faire entrer (comme Fak). Lagarde dit avoir voulu sa mise en scène onirique, elle l’est malheureusement bien peu…
S’il y a rêve, c’est celui d’autres mises en scène, et il est malgré tout nourri par certaines scènes, certaines visions, certains acteurs qui pendant un instant captent l’attention. Dépassée la gratuité des cheveux blonds de Charles, dont la féminité retombe comme un soufflet alors qu’elle semblait ouvrir des pistes possibles, ou le style eighties de Fak, il est possible d’apprécier le jeu de Micha Lescot et Antoine de Foucauld. Le jeu corporel de l’un, dégingandé comme à son habitude, mais ici aussi campé, et la puissance de l’autre, qui ne court pas après le texte mais s’en sert comme moteur, le place à l’intérieur de ses entrailles et non devant lui. Quelques moments fugaces d’émotion surgissent aussi avec Cécile, la mère de Charles et Claire, incarnée par Dominique Raymond, ou avec Claire, interprétée par Léa Luce Busato. La présence muette d’Abad, Kiswendsida Léon Zongo, sert à d’autres moments de point d’accroche. La dernière image du spectacle, qui donne à voir tous les personnages pour la première fois réunis dans l’espace de la scène saisit un instant avant les applaudissements, comme, d’une autre façon, le fait que Christèle Tual s’avance avec sa béquille pour saluer (ce n’était donc pas un choix dramaturgique). Mais il paraît manquer une ligne de basse pour unir ces notes disparates, une direction profonde pour traverser l’œuvre et non s’y perdre, comme les personnages réunis dans ce hangar désaffecté.
 Cette errance dramaturgique sans fin – d’autant plus infinie que le dénouement est flouté alors qu’il est très net dans l’œuvre de Koltès – ne redouble pas celle des personnages grâce à un habile effet miroir. Les questions posées par Monique au début du spectacle – « Et maintenant : où ? par où ? comment ? » – restent sans réponses. Ce silence surprend de la part de Lagarde, capable de faire de l’Avare et ses enfants nos exacts contemporains, de tisser les pièces disparates de Büchner entre elles, ou simplement d’offrir des souvenirs inoubliables d’acteurs par sa direction. La rencontre, ici, n’a pas lieu. Encore une fois. Car la mise en scène de Chéreau, paraît-il, n’avait pas plu, ni au public ni à Koltès. Quai ouest résiste à la scène. Bien loin de décourager, cette résistance donne envie de s’y mesurer, de l’affronter, pour rendre ce texte possible sur une scène.
Cette errance dramaturgique sans fin – d’autant plus infinie que le dénouement est flouté alors qu’il est très net dans l’œuvre de Koltès – ne redouble pas celle des personnages grâce à un habile effet miroir. Les questions posées par Monique au début du spectacle – « Et maintenant : où ? par où ? comment ? » – restent sans réponses. Ce silence surprend de la part de Lagarde, capable de faire de l’Avare et ses enfants nos exacts contemporains, de tisser les pièces disparates de Büchner entre elles, ou simplement d’offrir des souvenirs inoubliables d’acteurs par sa direction. La rencontre, ici, n’a pas lieu. Encore une fois. Car la mise en scène de Chéreau, paraît-il, n’avait pas plu, ni au public ni à Koltès. Quai ouest résiste à la scène. Bien loin de décourager, cette résistance donne envie de s’y mesurer, de l’affronter, pour rendre ce texte possible sur une scène.
F.
Pour en savoir plus sur « Quai ouest », rendez-vous sur le site du Théâtre Nanterre-Amandiers.