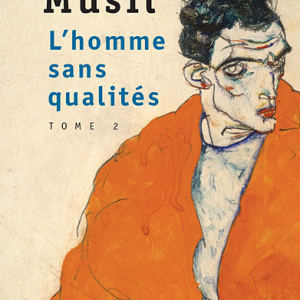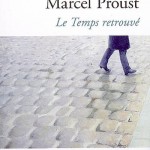La forme de l’excès
L’excès était ce que j’adorais.
Thomas De Quincey, Les Sociétés secrètes.
Le roman est le monde de l’excès, l’excès est le domaine du roman. Ce lieu si libre, si incontrôlé qu’il fut longtemps méprisé pour son absence de règles, est une forme accueillante, mais elle accueille sans contrôle, son autorité est celle, instable, de sa liberté. Le roman excède la forme. Est-ce à dire que l’excès est sa forme ? Le roman dépasse la mesure, et en cela peut-être est-il l’asocial de la littérature, uniquement calé dans le plaisir éphémère qu’il procure, plaisir improductif dans le discours social, plaisir obligatoirement tu.
Le roman est toujours plus qu’un roman. Je devrais l’énoncer plutôt ainsi, à la manière d’un règlement : un roman est un roman à la condition d’exprimer la volonté d’être plus qu’un roman, jusqu’à en exténuer le lecteur. Surgit alors la difficulté de le nommer : son nom de roman n’est en rien sa caractérisation. Des lecteurs refusent d’ailleurs de se contenter de la simple appellation de « roman » pour certaines œuvres « excessives », leur assignent d’autres noms et les rangent parfois dans des catégories nouvelles. Les formes romanesques naissent dans ce relativisme terminologique et générique. Entre le roman-monde qui cherche à représenter le monde et celui qui constitue un monde propre et parfois autonome, les formes de l’excès s’imposent en se distinguant. Le roman permet ainsi le développement de formes extrêmes sans pour autant remettre en cause l’existence du genre romanesque, mais en exhibant sa liberté et ses ultimes possibilités. Ainsi le roman devient ce qui ne peut plus se nommer et l’innommable se voit soumis à la question : qu’est-ce qu’un roman qui est plus qu’un roman ?

Le roman est la forme « informe » de l’excès, la débauche du langage. La perfection ne peut lui convenir puisqu’il défait toujours quelque chose. C’est pourquoi le roman classique peut apparaître comme un oxymore ou comme un paradoxe : La Princesse de Clèves n’est pas un roman, pas plus que ne l’est La Confusion des sentiments, ni L’Étranger. Ces textes, si beaux soient- ils, idéalement logés dans leur forme pure, dévoilent trop nettement les arcatures de leur perfection sous la fine membrane de leur langage pour être des romans. Sans doute le sont-ils néanmoins : je ne chercherai décidément pas à imposer des normes pour dire ce qui est un roman et ce qui ne l’est pas ; le paradoxe serait encore plus grand de vouloir en faire un monde hors des normes. Je veux dire ici mon sentiment du roman, je veux parler d’une forme de folie du roman, celle qui le rend universel et qui ne le fait jamais finir. Lorsque je suspends ma lecture dix ou vingt pages avant la fin de peur de disparaître avec lui, lorsque je relis indéfiniment Du côté de chez Swann ou que je me dis que la seule chose possible à faire maintenant serait de le recopier, je suis saisie par la folie du roman, je deviens son intranquillité même.
Je crois habiter le roman, c’est en fait le roman qui m’habite. Car il est souvent l’exact contraire de ce que l’on croit saisir.
L’excès vient au roman comme au corps. Chercher à le régir par des règles serait une illusion scolastique, à laquelle se sont essayés nombre de théoriciens et de législateurs. Ces derniers parlent plus souvent de « l’art du roman » que de sa forme (Nathalie Sarraute le remarque dans L’Ère du soupçon), mais étrangement, c’est pour dire ses courbes imprécises, ses arabesques imprévisibles, ses feuilles d’acanthe. Le flou de l’art contre la rigueur de la théorie. Les ouvrages sur la théorie du roman, s’ils parviennent encore, au XVIIe siècle, à en constituer un modèle d’intelligibilité abstraite, concluent davantage, trois siècles plus tard, que la théorie du roman se trouve dans les romans eux-mêmes. Le Temps retrouvé et sa double théorie de la mémoire et du livre : « Il fallait tâcher d’interpréter les sensations comme les signes d’autant de lois et d’idées, en essayant de penser, c’est-à-dire de faire sortir de la pénombre ce que j’avais senti, de le convertir en un équivalent spirituel. » La nécessité de l’œuvre s’inscrit dans cet équilibre de la sensation et de sa réflexion dans l’écriture. Le roman ménage en son monde un espace critique qui tout à la fois commémore et prolonge : il rappelle en effet le moment très ancien qui initia l’écriture et redouble son univers en le réfléchissant.

Le poème semble toujours porté par la question de ce qu’il est, question indissociable de la vertu performative de la parole poétique elle-même. Le roman s’interroge moins directement sur ses fondements et son sens. Même lorsqu’il s’accompagne de son effort théorique, il ne peut pas être absolument auto-poétique. Son redoublement, souvent, le défait ou le reconduit à l’hétérogène ; à propos de Paludes, qui semble redire indéfiniment son propre geste, Gide écrit : « J’aime aussi que chaque livre porte en lui, mais cachée, sa propre réfutation […]. J’aime qu’il porte en lui de quoi se nier, se supprimer lui-même. » Le roman contredit parfois sa matérialité : bloc de pages au sens renfermé, virtuellement dégradable, il devient diffusion – au sens physique du terme, c’est-à-dire séparation -, propagation du sens, désœuvré mais vivant (comparable à l’espace contradictoire du cimetière pour celui qui croit à la résurrection). Mais la contradiction du roman ne l’abolit pas. Forme élastique, ouverte à toutes les intégrations (Hugo Friedrich en fait rien moins qu’un « supergenre », capable d’être tous les genres à la fois et néanmoins rétif au système), il est prêt à accueillir jusqu’à sa négation, à admettre son propre renversement. Là se dit une dimension de son excès, de son inévitable désordre. Ce désordre ne doit pas être compris comme une tentative d’autodestruction, mais plutôt comme la possibilité d’offrir aussi cela, d’être à proprement parler un monde, incluant la perte de repères comme condition de traversée.
L’excès du roman est le sujet de ce livre, et non l’excès dans le roman : il y sera plus question de flacon que d’ivresse, les artifices n’y conduisent pas au paradis, le furor n’y sera présent qu’au titre de la démesure formelle. La réflexion sera ainsi conduite autour des formes : elles ont l’intérêt de proposer un sens à la fois historique, ontologique et esthétique. La forme est irréductible à l’œuvre mais elle profère en même temps un sens du monde et du temps dans lequel elle apparaît. Jean Rousset l’affirme dans « Les réalités formelles de l’œuvre », « il faut reconnaître à la forme une vertu inventive et heuristique ; “trouver en faisant”, écrit Delacroix, ou Balzac ; “penser les brosses à la main” ; “faire” ou “brosser” signifiant ici : créer des formes. La forme n’est pas un squelette ou un schéma, elle n’est pas plus une armature qu’un contenant ; elle est chez l’artiste à la fois son expérience la plus intime et son seul instrument de connaissance et d’action. La forme est son moyen, comme elle est son principe. Pourquoi ne serait-elle pas aussi notre principe, à nous lecteurs et explorateurs du livre ? ». Par rapport au concept de genre, la notion de forme permet de sortir de la poétique pour dessiner une ontologie du roman, pour dire l’étrangeté de son être. Lorsque l’heuristique et l’invention se croisent dans la visée de composer une forme- monde, la forme comme instrument de connaissance se trouve singulièrement plus significative : elle est à la fois son élément ; elle est sa question et elle est en même temps sa réponse. Elle devient bien sûr aussi son inquiétude, celle de l’œuvre tout autant que celle de l’excès de l’œuvre : comment formaliser une forme informe ? Comment formaliser une forme de folie ? Si l’excès n’est ni réductible, ni récupérable, comment l’atteindre dans la forme ? Les œuvres elles-mêmes donnent parfois une forme à l’excès, en imposant par et dans le livre un excès de temps, de monde, de savoir ou encore un excès du langage. Lorsqu’elles ne le font pas, il reste à chercher, au plan de l’esthétique comme de l’ontologie, à donner une forme, même paradoxale, aux romans de l’excès. Le débordement est peut-être alors du côté d’un excès dans la lecture.

« La littérature ne peut vivre — écrivait Calvino peu de temps avant sa mort — que si on lui assigne des objectifs démesurés, voire impossibles à atteindre. Il faut que poètes et écrivains se lancent dans des entreprises que nul autre ne saurait imaginer, si l’on veut que la littérature continue de remplir une fonction. Depuis que la science se défie des explications générales, comme des solutions autres que sectorielles et spécialisées, la littérature doit relever un grand défi et apprendre à nouer ensemble les divers savoirs, les divers codes, pour élaborer une vision du monde plurielle et complexe2. » C’est un rêve de la littérature qui a quelque chose d’universel et quelque chose d’historique : le roman – mais est-ce encore le rêve des écrivains d’aujourd’hui ? – remplirait une tâche que ne peut plus (ou ne peut pas) s’assigner la philosophie, dire un surplus du monde sur le savoir, relayer une défaite épistémique ; Deleuze et Guattari l’exposent ainsi dans Mille plateaux : « le monde est devenu chaos, mais le livre reste image du monde, chaosmos-radicelle au lieu de cosmos-racine ». Le roman est sans doute le contre- monde où peut s’élaborer cette vision nouvelle, où peut se dire une exigence de totalité dont il faut mesurer le défi à l’aune de la temporalité. Cette mesure est formelle, tant il est vrai que la littérature s’installe dans cette tension : donner une forme à la totalité du monde.
Excès du roman, Tiphaine Samoyault, éd. Maurice Nadeau, 1999.