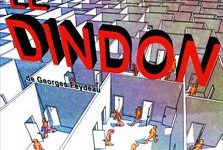La nouvelle saison est inaugurée à la Comédie de Caen avec Le Dindon, première création d’Aurore Fattier en tant que directrice de ce CDN. À cette occasion, l’artiste revient à un auteur qu’elle a déjà côtoyé et avec lequel elle a même inauguré son geste de mise en scène : Georges Feydeau. Sans que l’on cerne bien sous quel signe elle place son mandat avec ce choix – celui de la relecture subversive des classiques ou celui du divertissement, ou peut-être les deux –, ce spectacle n’en propose pas moins une fête du théâtre, grâce à une équipe de personnalités riches en couleur qui parvient à faire rire à partir d’un matériau désigné comme profondément anachronique.
 Si les premières minutes du spectacle suggèrent qu’on a fait du chemin depuis Feydeau – avec la découverte d’une scénographie contemporaine qui mobilise la vidéo en direct, surplombée par une citation de Lacan sur l’inexistence des rapports sexuels, et avec l’interprétation aussi engagée que dérisoire de la chanson « Vous les femmes… » de Julio Iglesias par un homme nu dont les parties intimes sont décorées de franges colorées –, Aurore Fattier revient au texte qu’elle a choisi de monter avec le premier dialogue. La scène embarrasse d’emblée notre époque : un homme poursuit une femme jusque chez elle contre son gré et parvient à s’introduire chez elle. Cette scène de harcèlement qui paraît loin d’être comique souligne d’entrée de jeu le temps qui nous sépare de cette pièce de 1896.
Si les premières minutes du spectacle suggèrent qu’on a fait du chemin depuis Feydeau – avec la découverte d’une scénographie contemporaine qui mobilise la vidéo en direct, surplombée par une citation de Lacan sur l’inexistence des rapports sexuels, et avec l’interprétation aussi engagée que dérisoire de la chanson « Vous les femmes… » de Julio Iglesias par un homme nu dont les parties intimes sont décorées de franges colorées –, Aurore Fattier revient au texte qu’elle a choisi de monter avec le premier dialogue. La scène embarrasse d’emblée notre époque : un homme poursuit une femme jusque chez elle contre son gré et parvient à s’introduire chez elle. Cette scène de harcèlement qui paraît loin d’être comique souligne d’entrée de jeu le temps qui nous sépare de cette pièce de 1896.
Pour la jouer malgré tout, la metteuse en scène mobilise de manière d’abord raisonnable les ressorts de la théâtralité. L’intrusion se fait par la porte par laquelle le public est entré dans la grande salle du Théâtre d’Hérouville, et la poursuite, ponctuée de répliques, est menée au travers d’une rangée obligée de se lever pour laisser passer Vanessa Fonte et Maxence Tual. La première saisit aussitôt par la manière dont elle surimpose au rôle de femme poursuivie par un homme qu’elle interprète une puissance et une fermeté qui lui permettent de remettre son harceleur à sa place. Dans son tailleur un peu court, Lucienne apparaît comme une femme contemporaine qui refuse le statut de proie et de victime.
 La scène suivante confirme cette position de pouvoir lorsque Lucienne découvre que celui qui la suit depuis une semaine, Pontagnac, connaît son mari, Crépin Vatelin. Elle maîtrise alors le double-sens et sait fragiliser la complicité des hommes qui font des femmes de purs objets de désir, cette complicité que mettait en valeur une partie de badminton pendant l’installation du public, retransmise sur écran. Le pot aux roses que la femme finit par dévoiler ne suffit cependant pas à discréditer totalement Pontagnac aux yeux de son mari, et le combat reste à mener pour éprouver l’amour et la confiance de ce dernier. À ce stade, les costumes sont encore classiques dans l’espace à la fois contemporain et neutre élaboré par Marc Lainé et Stéphan Zimmerli. La seule chose qui dénote dans ce bureau encombré de tampons, de buvards et de dossiers colorés, décoré de plantes vertes, ce sont les messages projetés sur un écran télévisé qui font la promotion de l’activité notariale de Vatelin à coup de slogans d’un goût douteux.
La scène suivante confirme cette position de pouvoir lorsque Lucienne découvre que celui qui la suit depuis une semaine, Pontagnac, connaît son mari, Crépin Vatelin. Elle maîtrise alors le double-sens et sait fragiliser la complicité des hommes qui font des femmes de purs objets de désir, cette complicité que mettait en valeur une partie de badminton pendant l’installation du public, retransmise sur écran. Le pot aux roses que la femme finit par dévoiler ne suffit cependant pas à discréditer totalement Pontagnac aux yeux de son mari, et le combat reste à mener pour éprouver l’amour et la confiance de ce dernier. À ce stade, les costumes sont encore classiques dans l’espace à la fois contemporain et neutre élaboré par Marc Lainé et Stéphan Zimmerli. La seule chose qui dénote dans ce bureau encombré de tampons, de buvards et de dossiers colorés, décoré de plantes vertes, ce sont les messages projetés sur un écran télévisé qui font la promotion de l’activité notariale de Vatelin à coup de slogans d’un goût douteux.
Les choses se dérèglent cependant un peu plus à chaque entrée – car comme dans tout vaudeville qui se respecte, quantité de personnages se retrouve au même endroit au même moment, les amis, les amantes, les rivaux, et les maris et les femmes qui ne devraient rien avoir à faire là. Le défilé est de plus en plus excentrique, chaque entrée est surlignée par un coup de projecteur qui attire l’attention sur des costumes de plus en plus extravagants qui perturbent l’ordre initial. À l’échelle du spectacle, la musique d’ambiance première deviendra musique de night-club lorsqu’on passera du bureau de Vatelin à une chambre d’hôtel à la salle de bain miteuse, puis à la garçonnière de Rédillon, espaces qui chaque fois accueillent un ballet de personnages, de quiproquos et de désirs plus contrariés que réalisés.
 Le parti pris majeur de cette mise en scène est de ne compter qu’une seule actrice dans la distribution – Vanessa Fonte, remarquable d’un bout à l’autre dans son rôle pourtant difficile. Tous les autres personnages féminins sont interprétés par des hommes queer ou trans : Ivandros Serodios, Geoffroy Rondeau et Marie-Noëlle. Alors que leurs rôles sont désespérément futiles, ces femmes prennent une consistance extraordinaire grâce au travestissement (ce qui n’est pas sans soulever des interrogations qui restent irrésolues). Face à elles, les rôles masculins sont à l’inverse profondément ridiculisés, même si Vincent Lécuyer parvient à rendre son personnage attachant et si Thomas Gonzalez, en Anglais de Marseille, se révèle plutôt séduisant.
Le parti pris majeur de cette mise en scène est de ne compter qu’une seule actrice dans la distribution – Vanessa Fonte, remarquable d’un bout à l’autre dans son rôle pourtant difficile. Tous les autres personnages féminins sont interprétés par des hommes queer ou trans : Ivandros Serodios, Geoffroy Rondeau et Marie-Noëlle. Alors que leurs rôles sont désespérément futiles, ces femmes prennent une consistance extraordinaire grâce au travestissement (ce qui n’est pas sans soulever des interrogations qui restent irrésolues). Face à elles, les rôles masculins sont à l’inverse profondément ridiculisés, même si Vincent Lécuyer parvient à rendre son personnage attachant et si Thomas Gonzalez, en Anglais de Marseille, se révèle plutôt séduisant.
Ces choix de distribution suffisent à reconfigurer en profondeur le texte de Feydeau et à rendre possible son interprétation sur scène. Le travestissement révèle à chaque instant que cette pièce est devenue illisible au premier degré, car elle repose sur des représentations sexistes et une morale patriarcale trop réactionnaires pour nous amuser. Pour faire fonctionner la mécanique comique très précise de Feydeau, Aurore Fattier conserve très scrupuleusement la lettre du texte, mais elle le subvertit par des corps qui échappent à la norme qu’il cultive, et le déborde par une esthétique placée sous le signe de l’excès, tout à la fois trash, camp, potache et burlesque. Après le crescendo initial, toute forme de bride est lâchée : l’amante anglaise Maggy se drogue dans les toilettes, Vatelin laisse entrevoir des désirs homosexuels, et des sculptures de pénis malades ou dévorants finissent par tomber des cintres. La libération paraît totale, même si on aurait pu imaginer plus de noirceur encore, plus de désordre, et un refus encore plus radical d’ordre et d’intellectualisme d’inspiration allemande.
 Ce reste de mesure est heureux dans l’usage de la vidéo, qui sert essentiellement à étoffer l’espace approfondi à chaque acte, à donner de la consistance au hors scène en laissant notamment entrevoir l’agitation qui règne à la réception de l’hôtel Ultimus autour de l’impériale Peggy Lee Cooper. Une semblable impression de consistance est apportée par la participation massive de personnes jeunes et moins jeunes qui envahissent la scène en déshabillé pour se plaindre du timbre sur lequel s’est endormie une sourde – vision saisissante et réjouissante. Cette courte apparition confirme la pertinence de l’intuition d’Aurore Fattier, selon laquelle ce texte peut être monté de manière littérale à condition de le confier à des personnalités saillantes invitées à cultiver à partir de ses moindres détails leur excentricité. Dans ces conditions, même les domestiques peuvent s’offrir le luxe d’un numéro et faire trembler une desserte au moment d’apporter du thé, et ainsi mettre en exergue un rapport de classe nerveux.
Ce reste de mesure est heureux dans l’usage de la vidéo, qui sert essentiellement à étoffer l’espace approfondi à chaque acte, à donner de la consistance au hors scène en laissant notamment entrevoir l’agitation qui règne à la réception de l’hôtel Ultimus autour de l’impériale Peggy Lee Cooper. Une semblable impression de consistance est apportée par la participation massive de personnes jeunes et moins jeunes qui envahissent la scène en déshabillé pour se plaindre du timbre sur lequel s’est endormie une sourde – vision saisissante et réjouissante. Cette courte apparition confirme la pertinence de l’intuition d’Aurore Fattier, selon laquelle ce texte peut être monté de manière littérale à condition de le confier à des personnalités saillantes invitées à cultiver à partir de ses moindres détails leur excentricité. Dans ces conditions, même les domestiques peuvent s’offrir le luxe d’un numéro et faire trembler une desserte au moment d’apporter du thé, et ainsi mettre en exergue un rapport de classe nerveux.
En poussant tous les curseurs d’un cran, le comique de Feydeau se révèle très efficace, et il devient possible de traverser cette pièce du début à la fin. Il y a trois ans, au même endroit, Émilie Anna Maillet dégoupillait Mais n’te promène donc pas toute nue grâce à des textes de Lars Norén et Virginie Despentes. Le montage n’est pas ici nécessaire. Faire de chaque scène une performance cabarétique queer et prendre le parti de la farce plutôt que du dindon suffit à dénaturaliser cet humour et ces situations, à mettre en déroule la norme sur laquelle ils reposent et à renverser ce monde anachronique et réactionnaire qui n’est désormais plus capable de faire rire pour lui-même.
F.
Pour en savoir plus sur Le Dindon, rendez-vous sur le site de la Comédie de Caen.