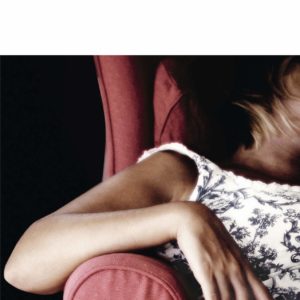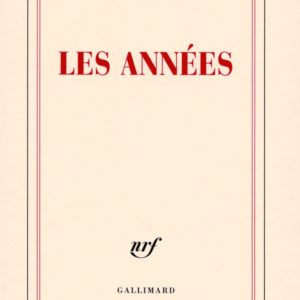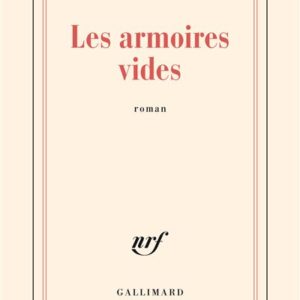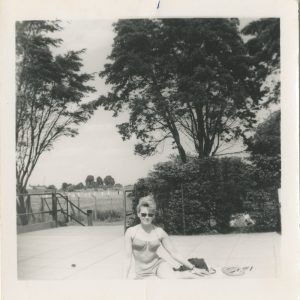Nous qui en étions restés au PSU pour changer la société, on découvrait les maos, les trotkistes, une énorme quantité d’idées et de concepts d’un seul coup au grand jour. Sortaient de partout des mouvements, des livres et des revues, des philosophes, critiques, sociologues : Bourdieu, Foucault, Barthes, Lacan, Chomsky, Baudrillard, William Reich, Ivan Illich, Tel Quel, l’analyse structurale, la narratologie, l’écologie. D’une façon ou d’une autre, que ce soit Les Héritiers ou le petit livre suédois sur les positions sexuelles, tout allait dans le sens d’une intelligence nouvelle et d’une transformation du monde. On baignait dans des langages inédits, ne sachant où donner de la tête, surpris de ne pas avoir entendu parler de tout cela avant. En un mois on avait rattrapé des années. Et on était rassurés de retrouver, vieillis mais plus pugnaces que jamais, émouvants, Beauvoir avec son turban et Sartre, même s’ils n’avaient rien de neuf à nous apprendre. André Breton, malheureusement, était mort deux ans trop tôt.
Rien de ce qu’on considérait jusqu’ici comme normal n’allait de soi. La famille, l’éducation, la prison, le travail, les vacances, la folie, la publicité, toute la réalité était soumise à examen, y compris la parole de celui qui critiquait, sommé de sonder le tréfonds de son origine, d’où tu parles toi ? La société avait cessé de fonctionner naïvement. Acheter une voiture, noter un devoir, accoucher, tout faisait sens.
Rien de la planète ne devait nous être étranger, les océans, le crime de Bruay-en-Artois, nous étions partie prenante de toutes les luttes, le Chili d’Allende et Cuba, le Vietnam, la Tchécoslovaquie. On évaluait les systèmes, on cherchait des modèles. On était dans une lecture politique généralisée du monde. Le mot principal était « libération ».
Il était accordé à chacun, pourvu qu’il représente un groupe, une condition, une injustice, de parler et d’être écouté, intellectuel ou non. Avoir vécu quelque chose en tant que femme, homosexuel, transfuge de classe, détenu, paysan, mineur, donnait le droit de dire je. Il y avait une exaltation à se penser en termes collectifs. Des porte-parole s’élevaient spontanément, de prostituées, de travailleurs en grève. Charles Piaget, l’ouvrier de Lip, était plus connu que le psychologue du même nom dont on nous avait rebattu les oreilles en philo [ignorant qu’un jour ni l’un ni l’autre ne nous évoquerait rien d’autre qu’un joaillier de luxe dans les revues chez le coiffeur].
Les garçons et les filles étaient maintenant partout ensemble, la distribution des prix, les compositions et la blouse supprimées, les notes remplacées par les lettres de A à E. Les élèves s’embrassaient et fumaient dans la cour, jugeaient à voix haute le sujet de rédaction débile ou génial.
On expérimentait la grammaire structurale, les champs sémantiques et les isotopies, la pédagogie Freinet. On abandonnait Corneille et Boileau pour Boris Vian, Ionesco, les chansons de Boby Lapointe et de Colette Magny, Pilote et la bande dessinée. On faisait écrire un roman, un journal, puisant dans l’hostilité des collègues qui s’étaient terrés en 68 dans la salle des profs et celle des parents criant au scandale parce qu’on faisait lire L’Attrape-Cœurs et Les Petits Enfants du siècle un surcroît de persévérance.
On sortait des débats de deux heures sur la drogue, la pollution ou le racisme, dans une espèce d’ébriété avec, tout au fond de soi, le soupçon de n’avoir rien appris aux élèves, est-ce qu’on n’était pas en train de pédaler à côté du vélo, mais l’école de toute manière servait-elle à quelque chose. On sautait sans fin d’interrogation en interrogation.
Penser, parler, écrire, travailler, exister autrement : on estimait n’avoir rien à perdre de tout essayer.
1968 était la première année du monde.