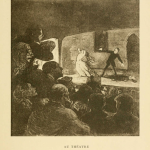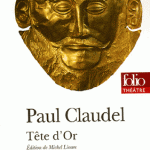Le drame, c’est quelque chose qui arrive, le Nô, c’est quelqu’un qui arrive. Un peu comme cette porte, quand le Théâtre en Grèce a commencé et qu’une communication à travers le mur a été frayée avec l’invisible, où viennent l’un après l’autre s’inscrire les personnages de l’Orestie. Ici la scène se compose de deux parties : le Chemin ou Pont et l’Estrade. Le chemin est une longue galerie couverte accolée à la paroi du fond et divisée par des supports verticaux en trois parties égales. L’Estrade, encadrée par quatre colonnes sous un toit, est une plate-forme de bois polie comme un miroir. Elle est placée sur le côté droit de la salle et fait angle et avancement dans le parterre. C’est une disposition essentielle. Car ici le spectacle n’a pas lieu pour le spectateur qui, désormais anéanti et obscur, va prendre le temps à cette action sur la scène ; il n’y a pas un drame un public face à face correspondant de chaque côté d’une fissure de fiction et de feu. Ils entrent l’un dans l’autre, de sorte que par rapport à nous les acteurs marchent et se déploient latéralement et sur deux plans, avec lesquels chacun des assistants de par sa place forme une géométrie personnelle, suivant l’angle correspondant de son œil et de son oreille. Tout se passe à l’intérieur du public qui ne perd jamais une impression à la fois d’enveloppement et de distance : simultanément avec nous, à notre côté. D’impermanence aussi. Le Pont, même quand les simulacres solennels ont cessé de s’y avancer, ne perd pas ses possibilités majestueuses d’introduction et de retraite, ni l’Estrade sous son dais qui est le pavillon du rêve, pareil à ces kiosques de cinabre et de corail dans les peintures chinoises où festoient au-dessus des nuages des bienheureux en robes turquoise et azur, ne cesse de faire perpétuellement ostension d’une présence ou d’une absence.
À droite et à gauche, sur le bois couleur de beurre frais on a peint des bambous verts et sur le panneau du fond un grand pin. Cela suffit pour que la nature soit là.
Les choses se passent dans cet ordre :
À petits pas glissés arrivent d’abord les musiciens et les hommes du Chœur. Les premiers se placent au fond de l’estrade, sur une partie pour eux délimitée par un changement de dessin du parquet, appelée Koza. Il y a une flûte, deux tambourins doubles en forme de sablier, un petit qui se tient sur l’épaule droit, un plus grand qui se tient sur le genou gauche, et qui heurtés avec violence par les doigts à plat produisent une espèce de détonation sèche ; plus, pour les apparitions de dieu, de démons et de fantômes, un tambourin à baguettes ; c’est tout. Les instruments à coups sont là pour donner le rythme et le mouvement, la flûte funèbre est la modulation par intervalles à notre oreille de l’heure qui coule, le dialogue par derrière les acteurs de l’heure et du moment. À leur concert viennent souvent s’ajouter de longs hurlements poussés par les musiciens sur deux notes, l’une grave et l’autre aiguë : hou-kou, hou-kou. Cela donne une étrange et dramatique impression d’espace et d’éloignement, comme les voix de la campagne pendant la nuit, les appels informes de la nature, ou encore c’est le cri de l’animal qui se travaille obscurément vers le mot, la poussée sans cesse déçue de la voix, un effort désespéré, une attestation douloureuse et vague.
Le Chœur n’est pas partie à l’action, il y ajoute simplement un commentaire impersonnel. Il raconte le passé, il décrit le site, il développe l’idée, il explique les personnages, il répond et correspond par la poésie et par le chant, il rêve et murmure accroupi au côté de la Statue qui parle.
Il y a deux personnages seulement dans le Nô, le Waki et le Shité, chacun d’eux accompagné ou non par un ou plusieurs Tzuré, suivants, serviteurs, auxiliaires, conseil, ombre, pompe, amplification solennelle par derrière de la traîne.
Le Waki est celui-là qui regarde et qui attend, celui qui vient attendre. Il n’a jamais de masque, c’est un homme. Préparé par la musique qui a tendu d’avance sous ses pieds un chemin sonore, le lourd rideau de brocart s’est soulevé, on le voit successivement passer par la triple ouverture de la galerie, et le voici enfin sur la scène, il se tourne lentement vers nous, il apporte son visage. Pour commencer, le plus souvent, il profère deux vers, dont le premier deux fois répété, et le Chœur en sourdine à son tour se redit à lui-même trois fois de suite la sentence. Puis en une longue tirade où chaque pas, un vers de sept syllabes affermi sur un vers de cinq, se laisse pour ainsi dire considérer, il déclare qui il est, le chemin qu’il a parcouru. C’est un moine par exemple qui a exploré, pour retrouver la concubine défunte d’un Empereur désespéré, les régions de l’arrière-monde. C’est une folle à travers la campagne déserte qui va à la recherche de son fils mort. Car le sexe du personnage englouti sous le vêtement n’importe pas, mais seulement sa fonction. Puis le Waki, accompagné ou non de son escorte, va s’asseoir au pied du pilier de droite en avant qui lui est réservé, et, les yeux fixés sur le côté par où l’on arrive, il attend.
Il attend et quelqu’un apparaît.
Dieu, héros, ermite, fantôme, démon, le Shité est toujours l’Ambassadeur de l’Inconnu et à ce titre il porte un masque. C’est quelque chose de secret et de voilé qui vient demander au Waki sa révélation. Sa marche et ses mouvements sont fonction de ce regard qui l’a attiré et qui le maintient captif de ce sol imaginaire. Voici la femme outragée dont le fantôme pas à pas se rapproche de son assassin ; lui, pendant une longue heure, tiendra l’œil fixé sur elle, toute la salle le surveille, il ne doit pas cligner un cil. Voici l’âme de l’enfant Atsumori sous la forme d’un faucheur et seule la flûte merveilleuse a révélé qui il est. Le Waki interroge, le Shité répond, le Chœur commente, et autour de ce visiteur pathétique qui sous le masque vient apporter à son suscitateur le Néant, il construit avec la musique une enceinte d’images et de paroles.
Alors c’est l’intermède et, sur le ton de la conversation, un passant vient qui demande ou donne, comme à voix basse, au Waki dans un récit au ras du sol des explications.
Et la seconde partie du Nô commence. Le Waki a fini son rôle, ce n’est plus qu’un témoin. Le Shité qui s’était retiré un moment reparaît. Il est sorti de la mort, de l’ébauche ou de l’oubli. Il a changé de costume, parfois de forme. Parfois même c’est un personnage différent dont celui de la première partie était l’annonce, l’enveloppe et comme l’ombre préalable. Maintenant toute la scène est à lui et le voilà qui s’en empare, avec tout ce qui s’y trouve. Tout un fragment de cette vie dont jadis il a été le fondement ou l’expression s’est réveillé avec lui et remplit le Pavillon dormant au milieu du Lac des Songes de son volume imaginaire. D’un geste de son éventail magique, il a balayé le présent comme une vapeur et du lent vent de cette aile mystérieuse il a ordonné à ce qui n’était plus d’émerger autour de lui. Par le prestige d’une parole qui s’efface à mesure qu’une autre lui succède, le jardin de dessous le monde peu à peu s’est dessiné dans la cendre sonore. Le Shité ne parle plus, il se borne en quelques paroles, en quelques intonations, à fournir des thèmes, des invitations et des élans, et c’est le Chœur qui se charge de déployer le site physique et moral à sa place en une espèce de psalmodie impersonnelle. Lui se promène au travers, affirme, atteste, développe, agit, et par ses changements d’attitude et de direction il indique toutes les vicissitudes du drame somnambulique. Par un étonnant paradoxe, ce n’est plus le sentiment qui est à l’intérieur de l’acteur, c’est l’acteur qui se met à l’intérieur du sentiment. Il est vraiment devant nous l’acteur de sa propre pensée et le témoin de sa propre expression.
Le tout donne l’impression d’un rêve matérialisé qu’un mouvement trop brusque ou étranger à la convention détruirait sur-le-champ. Il est essentiel que l’attention des acteurs par un moment ne divague, qu’ils se meuvent dans une espèce de transe et que, même pour pleurer ou tuer, ils ne lèvent qu’un bras amorti par le sommeil. Tous les gestes sont dictés par une espèce de pacte hypnotique, en harmonie avec cette musique là-bas qui est notre douleur, un flux inépuisable entrecoupé de ressauts, et ce Chœur qui est notre mémoire. L’acteur ne prend pas appui sur le sol, de ce pas qui est un effort contre le poids ; il glisse sur une surface lumineuse et seuls les doigts de pieds qui se relèvent et s’abaissent constatent chacun de ses progrès. On dirait que chaque geste a à surmonter, avec le poids et le repli de l’immense vêtement, la mort, et qu’il est la lente copie dans l’éternité d’une passion défunte. C’est la vie telle que, ramenée du pays des ombres, elle se peint à nous dans le regard de la méditation : nous nous dressons devant nous-mêmes, dans l’amer mouvement de notre désir, de notre douleur et de notre folie. Nous voyons chacun de nos actes à l’état d’immobilité, et du mouvement il ne reste plus que la signification. À la manière d’un maître qui reprend et qui explique, quelqu’un lentement devant nous reproduit ce que nous avons fait afin que nous comprenions de quelle attitude éternelle chacun de nos pauvres gestes au hasard était l’imitation inconsciente et improvisée. Comme une statue qui se constitue pour un moment devant nos yeux, quelle tendresse dans ce bras que l’époux, au moment où il passe devant elle sans la regarder, pose sur l’épaule de celle qu’il aime, et ce geste banal de la douleur que l’on voit dans tous nos journaux illustrés, quelle signification ne prend-il pas quand nous le voyons lentement et soigneusement exécuté ! C’est un poids, le poids du malheur, que l’on soulève avec peine, c’est une coupe qu’on porte à ses lèvres, c’est le désir de se cacher, c’est le miroir où nous allons nous regarder avec désespoir, c’est l’arrêt fatal que l’on nous donne à lire.
« Le Nô », Paul Claudel (Mes Idées sur le théâtre)