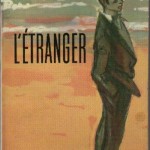Après plusieurs rebondissements liés à la pandémie, le spectacle de Nicolas Stemann, Contre-enquêtes, vient enfin au Théâtre de la Ville, où l’attendent plusieurs groupes de lycéens qui chahutent un peu au moment de s’installer. Certains sont cependant venus avec L’Étranger de Camus et garderont le livre posé sur leurs genoux tout au long du spectacle. Tous ou presque pourront, grâce à leur professeur de français, répondre oui à la question de Mounir Margoum : qui a lu ce livre ? Et tous seront ainsi en capacité d’apprécier le dialogue mis en place par le metteur en scène entre l’œuvre de Camus et la Contre-enquête de Kamel Daoud, publiée en 2014, comme l’envers de L’Étranger, sa réponse à soixante-dix ans d’écart. La confrontation de ces deux œuvres, menée par deux acteurs au plateau, soulève une question délicate : qui peut légitimement prendre en charge le récit des victimes ?
 La démarche de Kamel Daoud dans Meursault, contre-enquête est à plusieurs égards comparable à celle de Louis-Philippe Dalembert dans Milwaukee Blues, roman paru en août 2021 finaliste du Prix Goncourt. Dans les deux cas, il s’agit de renverser la perspective des dominants aux dominés et de livrer le point de vue des victimes – l’Arabe tué sur la plage par Meursault dans L’Étranger de Camus, ou George Floyd, mort à la suite de son interpellation par la police en mai 2020, rebaptisé Emett par Louis-Philippe Dalembert. Pour leur rendre justice, l’un et l’autre auteurs donnent la parole aux proches de ces victimes : le frère de l’Arabe, Haroun, d’un côté, et tous ceux qui ont côtoyé Emett de l’autre (son institutrice, ses amis d’enfance, son coach de football à l’Université, sa première petite amie, son ex…). Comme pour nous rappeler que c’est avant tout d’êtres humains dont il est question, ils repartent du plus intime et s’attachent à relater la façon dont les proches ont appris la nouvelle de la mort, avant d’entremêler le récit de l’enterrement à une collection de souvenirs qui dessinent progressivement le portrait de la victime. La différence majeure de ces deux romans réside dans le fait que Dalembert s’inspire du réel, de l’actualité brûlante même, alors que Daoud, lui, répond à une œuvre de fiction.
La démarche de Kamel Daoud dans Meursault, contre-enquête est à plusieurs égards comparable à celle de Louis-Philippe Dalembert dans Milwaukee Blues, roman paru en août 2021 finaliste du Prix Goncourt. Dans les deux cas, il s’agit de renverser la perspective des dominants aux dominés et de livrer le point de vue des victimes – l’Arabe tué sur la plage par Meursault dans L’Étranger de Camus, ou George Floyd, mort à la suite de son interpellation par la police en mai 2020, rebaptisé Emett par Louis-Philippe Dalembert. Pour leur rendre justice, l’un et l’autre auteurs donnent la parole aux proches de ces victimes : le frère de l’Arabe, Haroun, d’un côté, et tous ceux qui ont côtoyé Emett de l’autre (son institutrice, ses amis d’enfance, son coach de football à l’Université, sa première petite amie, son ex…). Comme pour nous rappeler que c’est avant tout d’êtres humains dont il est question, ils repartent du plus intime et s’attachent à relater la façon dont les proches ont appris la nouvelle de la mort, avant d’entremêler le récit de l’enterrement à une collection de souvenirs qui dessinent progressivement le portrait de la victime. La différence majeure de ces deux romans réside dans le fait que Dalembert s’inspire du réel, de l’actualité brûlante même, alors que Daoud, lui, répond à une œuvre de fiction.
Daoud choisit en effet de prendre le contrepied exact de l’œuvre de Camus, et répond au célèbre incipit « Aujourd’hui, maman est morte » mot pour mot : « Aujourd’hui, M’ma est encore vivante ». De même, il répond au meurtre d’un Arabe par un blanc vers deux heures de l’après-midi, sur une plage ensoleillée, par le meurtre d’un blanc par un Arabe, en pleine nuit, vers deux heures du matin. L’objet de la contre-enquête n’est cependant pas simplement d’écrire le versant nocturne de ce roman solaire. Daoud s’en prend plus largement à l’aura de L’Étranger, premier roman du Prix Nobel de littérature de 1957, œuvre aujourd’hui multiplement traduite et parmi les trois francophones les plus lues au monde. De manière éloquente, le metteur en scène Nicolas Stemann l’érige au haut d’une tour de parpaings – afin de mieux la faire tomber de son piédestal. Daoud cherche en effet à voir au-delà de la beauté de sa langue – lisse et carrée comme des blocs, mathématique presque – pour mettre au jour les présupposés sur lesquels elle repose. Lui paraît symptomatique de la posture de colon de Camus (ou de son personnage narrateur, c’est là ce qui prête à débat) le fait que l’homme tué par Meursault ne soit pas nommé. Qu’il soit simplement appelé « l’Arabe ». Daoud l’assène : il y a deux morts dans ce livre ! Deux ? On pense en premier à l’Arabe en réalité, et non à Meursault. Il est certes condamné à mort – non pour son homicide mais pour avoir enterré sa mère « avec un cœur criminel » –, mais son récit s’arrête avant sa mort (Camus ne pousse pas l’illusion du journal aussi loin qu’Hugo dans Le Dernier jour d’un condamné).
 Il faut dépasser l’accroche choisie par Kamel Daoud, qui laisse volontairement mais injustement de côté l’enjeu littéraire et philosophique de cette désignation, « l’Arabe », révélatrice du rapport de Meursault au monde et de l’ampleur de son sentiment de l’absurde. Dépasser cette accroche pour entendre la justesse de son hypothèse, quand il affirme que le meurtre de l’Arabe est en réalité un crime passionnel, celui d’un auteur qui aime profondément le pays dans lequel il est né, l’Algérie, mais dont l’Algérie ne veut pas, « ni vivant ni mort ». La relation de Camus à ce pays et de ce pays à Camus est en effet on ne peut plus complexe, ceci avant même le début de la guerre d’indépendance qui l’amène à prendre des positions controversables. Dépasser cette accroche enfin, pour comprendre que Daoud ne fait pas tant le procès de Meursault, ni de Camus, qu’il ne trouve avec L’Étranger un prétexte pour réfléchir à la colonisation et à ses conséquences aujourd’hui, à la question de la culpabilité de la France et à la politique du bouc émissaire adoptée par l’Algérie à l’égard de la France pour justifier les travers actuels.
Il faut dépasser l’accroche choisie par Kamel Daoud, qui laisse volontairement mais injustement de côté l’enjeu littéraire et philosophique de cette désignation, « l’Arabe », révélatrice du rapport de Meursault au monde et de l’ampleur de son sentiment de l’absurde. Dépasser cette accroche pour entendre la justesse de son hypothèse, quand il affirme que le meurtre de l’Arabe est en réalité un crime passionnel, celui d’un auteur qui aime profondément le pays dans lequel il est né, l’Algérie, mais dont l’Algérie ne veut pas, « ni vivant ni mort ». La relation de Camus à ce pays et de ce pays à Camus est en effet on ne peut plus complexe, ceci avant même le début de la guerre d’indépendance qui l’amène à prendre des positions controversables. Dépasser cette accroche enfin, pour comprendre que Daoud ne fait pas tant le procès de Meursault, ni de Camus, qu’il ne trouve avec L’Étranger un prétexte pour réfléchir à la colonisation et à ses conséquences aujourd’hui, à la question de la culpabilité de la France et à la politique du bouc émissaire adoptée par l’Algérie à l’égard de la France pour justifier les travers actuels.
Nicolas Stemann orchestre donc la rencontre sur scène de ces deux œuvres, qui déjà dialoguaient dans l’intimité des pages du roman de Daoud. Pour mener la confrontation de ces deux œuvres, de leurs deux auteurs, de leurs deux personnages, le metteur en scène mobilise deux acteurs. Leur statut est cependant pour le moins trouble. Mounir Margoum commence seul et s’adresse d’emblée au public, sans citer le nom de Camus ni celui de Meursault, ni le titre de l’œuvre, mais le livre à la main pour se faire comprendre. Les lycéens se demandent s’il ne s’agit pas en fait d’un stand-up quand il se met à asticoter ceux qui osent lever la main quand il demande qui n’a pas lu L’Étranger, ou quand il propose de baptiser l’Arabe non nommé « Quatorze heures », parce que pourquoi pas, après Vendredi chez Tournier, tout est possible. L’acteur est-il lui-même ? est-il Daoud ? est-il Haroun, le frère de l’Arabe Moussa tué – car Daoud lui donne un nom, un frère, une mère, un physique et des bouts d’histoire ? Un autre acteur entre sur scène, Thierry Raynaud, et prend le flambeau. Mounir Margoum laisse entendre qu’il est peut-être Camus, assis à la table du même café que lui, tous les soirs, mais à son tour Thierry Raynaud annonce qu’il va prendre en charge le récit de l’autre victime du roman, de l’Arabe. Puis il redit les mêmes phrases que Mounir Margoum. Leur identité et leurs relations restent troubles jusqu’au bout, d’autant qu’ils ne cessent de se traiter de fantômes, alors que les fantômes sont déjà nombreux sur scène. Ils seront donc tout à la fois Camus, Daoud, Haroun, Meursault, Moussa, Mounir et Thierry. Tout se mêle tandis qu’ils se chamaillent, se passent le relais, se donnent la réplique pour lire l’une ou l’autre œuvre, en commenter des passages, résumer grossièrement celle de Camus, rejouer telle ou telle scène – celle du meurtre en premier lieu, et les cinq coups de pistolet
 Pour les accompagner dans cette traversée, les acteurs ont plusieurs appuis sur scène : des parpaings, un sac plastique contenant les cendres de l’Arabe (alors que son cadavre est resté introuvable), une table de café en marbre, un micro, un cercueil orné de quelques bougies, et bien entendu, les deux livres, ouverts, manipulés, détournés de leur usage. Leur sert également d’écrin un écran en fond, qui permet de scruter en gros plans les couvertures des livres, de les feuilleter, d’en faire percevoir des phrases, des mots soulignés ou entourés. D’autres fois, sont projetées des photos en noir et blanc ou en couleur, pour illustrer l’Algérie passée et ainsi donner corps aux mots, de Camus ou de Daoud.
Pour les accompagner dans cette traversée, les acteurs ont plusieurs appuis sur scène : des parpaings, un sac plastique contenant les cendres de l’Arabe (alors que son cadavre est resté introuvable), une table de café en marbre, un micro, un cercueil orné de quelques bougies, et bien entendu, les deux livres, ouverts, manipulés, détournés de leur usage. Leur sert également d’écrin un écran en fond, qui permet de scruter en gros plans les couvertures des livres, de les feuilleter, d’en faire percevoir des phrases, des mots soulignés ou entourés. D’autres fois, sont projetées des photos en noir et blanc ou en couleur, pour illustrer l’Algérie passée et ainsi donner corps aux mots, de Camus ou de Daoud.
Thierry Raynaud a beau répéter à plusieurs reprises qu’il faut revenir à la chronologie, la structure du spectacle est lâche. Après un procès peu élégant fait à Catherine Camus, fille de l’auteur et ayant-droit de ses œuvres, qui laisse entendre qu’elle n’a pas autorisé l’utilisation de L’Étranger pour ce spectacle, le commentaire du spectacle lui-même l’emporte sur l’œuvre de Daoud, qui déjà l’emportait sur celle de Camus. Les acteurs révèlent qui ils sont. Mounir Margoum décline notamment toutes les nationalités qu’il a été amené à porter sur scène (syrien, égyptien, turc…), tandis que Thierry Raynaud partage une partie de son histoire de descendant de pieds-noirs. Le metteur en scène, Nicolas Stemann, est lui-même désigné, en tant qu’Allemand qui au lieu de monter Faust vient se mêler de l’histoire franco-algérienne pour soulever la question de la culpabilité de la France et lui rendre son rôle de bourreau. La question que posent ici les artistes est la suivante : qui a le droit de s’approprier cette contre-histoire ? qui peut légitimement porter la parole des victimes ? qui peut prétendre être le frère de Moussa ? le Marocain né à Clermont-Ferrand ? le fils de pieds-noirs dont les parents et grands-parents sont nés en Algérie ? l’Allemand qui n’a rien à voir avec tout ça ?
 La question surgie de ces multiples entre-deux paraît juste. On regrette simplement, au moment de repartir, de n’avoir été abreuvé d’aucune des deux œuvres mises en dialogue. Le paradoxe de ce spectacle est qu’il met en déroute le projet de Daoud. Comme d’autres, avec ce roman, Daoud revendique la capacité de la fiction à bouleverser nos conceptions et notre appréhension du réel, à « donner la parole à des personnes silenciées, publier des récits qui ont été étouffés ou n’ont pas eu la place de se former » comme le formule Alice Zeniter dans Je suis une fille sans histoire. Ce pouvoir de réparation que Daoud veut attribuer à la fiction se dissout dans cette dramaturgie qui se commente elle-même en même temps que les deux œuvres sur lesquelles elle s’appuie. La puissance de représentation de l’œuvre de Daoud, comme de celle de Camus, s’évanouit. Haroun ne prend pas corps en tant que vieil Arabe assis dans un bar qui attend « des condoléances que jamais personne ne [lui] présentera ». Mounir Margoum ne deviendra pas indissociable de son frère Moussa, comme Marcello Mastroianni l’est devenu de Meursault. D’enquête en contre-enquête, la fiction perd en substance. Même la portée des réflexions de Daoud sur l’Algérie actuelle et son rapport ambivalent à l’histoire coloniale se dilue aussi. Ce qui reste est la confrontation de deux œuvres au plateau, et à partir d’elle, la question insoluble de savoir qui est le mieux placé pour faire entendre le récit des victimes.
La question surgie de ces multiples entre-deux paraît juste. On regrette simplement, au moment de repartir, de n’avoir été abreuvé d’aucune des deux œuvres mises en dialogue. Le paradoxe de ce spectacle est qu’il met en déroute le projet de Daoud. Comme d’autres, avec ce roman, Daoud revendique la capacité de la fiction à bouleverser nos conceptions et notre appréhension du réel, à « donner la parole à des personnes silenciées, publier des récits qui ont été étouffés ou n’ont pas eu la place de se former » comme le formule Alice Zeniter dans Je suis une fille sans histoire. Ce pouvoir de réparation que Daoud veut attribuer à la fiction se dissout dans cette dramaturgie qui se commente elle-même en même temps que les deux œuvres sur lesquelles elle s’appuie. La puissance de représentation de l’œuvre de Daoud, comme de celle de Camus, s’évanouit. Haroun ne prend pas corps en tant que vieil Arabe assis dans un bar qui attend « des condoléances que jamais personne ne [lui] présentera ». Mounir Margoum ne deviendra pas indissociable de son frère Moussa, comme Marcello Mastroianni l’est devenu de Meursault. D’enquête en contre-enquête, la fiction perd en substance. Même la portée des réflexions de Daoud sur l’Algérie actuelle et son rapport ambivalent à l’histoire coloniale se dilue aussi. Ce qui reste est la confrontation de deux œuvres au plateau, et à partir d’elle, la question insoluble de savoir qui est le mieux placé pour faire entendre le récit des victimes.
F.
Pour en savoir plus sur « Contre-enquêtes », rendez-vous sur le site du Théâtre de la Ville.