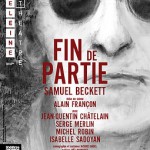Trois ans après La Seconde Surprise de l’amour, et quarante-deux ans après La Double inconstance à ses débuts, Alain Françon revient à Marivaux pour Les Fausses Confidences, programmé pour une vingtaine de dates au Théâtre Nanterre-Amandiers en cette fin d’année. Ce spectacle confirme la permanence du geste artistique de ce metteur en scène de près de 80 ans, qui monte depuis plus de cinquante ans des œuvres du répertoire et qui en offre chaque fois des lectures claires et justes. Cette dernière création offre plus précisément le plaisir d’un texte, d’une direction d’acteur très vivante et de partis pris scéniques qui mettent en lumière l’un et l’autre.
 La scénographie est exemplaire des espaces contraint par l’unité spatiale : elle représente un lieu de passage, qui peut à la fois être extérieur et intérieur selon les lumières et les meubles amenés pour une scène ou l’autre, et un lieu ouvert aux quatre vents, avec pas moins de six ouvertures qui assurent quantité de possibles pour les entrées et sorties. Les déplacements sont encore dynamisés par des fenêtres et des petites marches rehaussées de moulures aux textures différentes. À l’arrière-plan un paysage naturel est suggéré par des ombres d’arbres sur un cyclo, créant une ambiance à la Watteau ou François Boucher qui renvoie discrètement au XVIIIe siècle de Marivaux.
La scénographie est exemplaire des espaces contraint par l’unité spatiale : elle représente un lieu de passage, qui peut à la fois être extérieur et intérieur selon les lumières et les meubles amenés pour une scène ou l’autre, et un lieu ouvert aux quatre vents, avec pas moins de six ouvertures qui assurent quantité de possibles pour les entrées et sorties. Les déplacements sont encore dynamisés par des fenêtres et des petites marches rehaussées de moulures aux textures différentes. À l’arrière-plan un paysage naturel est suggéré par des ombres d’arbres sur un cyclo, créant une ambiance à la Watteau ou François Boucher qui renvoie discrètement au XVIIIe siècle de Marivaux.
Mais le signal qui indique le début du spectacle brouille un peu les repères temporels : une musique est lancée qui mêle clavecin, violons, guitare électrique et batterie. Ces instruments ne se rencontrent cependant pas sur le mode du choc. L’ensemble suggère plutôt qu’un orchestre les réunit et leur permet de jouer alternativement leurs parties sans se disputer. Cet alliage anachronique donne tout à la fois le la et le tempo de cette mise en scène : face au Comte Dorimont, que la mère d’Araminte voudrait voir épouser pour qu’elle gagne en noblesse, vêtu de chausses en cuir, d’une lavallière, d’un gilet tapissé et d’une perruque soignée, se tient Dorante, les cheveux ébouriffés jaune vif et les habits simples, nouvel intendant d’Araminte qui meurt d’amour pour elle et qui a pris ce poste pour se tenir au plus près d’elle, sans espérer prétendre s’en faire aimer en retour parce qu’il est ruiné.
 Avant même que la musique s’achève et laisse place aux premières répliques qui vont mettre en place l’intrigue débouchant sur l’union d’Araminte et Dorante, passe à l’arrière-plan de la scène une silhouette tout en noir : il s’agit de Gilles Privat, qui interprète le rôle-clé de Dubois, ancien domestique de Dorante désormais au service d’Araminte qui œuvre à leur union, contre deux autres projets de mariage. Dubois est le grand metteur en scène de cette pièce, convaincu que les vérités qu’il assène vont triompher. Il orchestre donc fausses confidences et rebondissements causés par un portrait ou une lettre, parfois sans même prévenir son ancien maître qu’il juge complètement dépourvu de bon sens tant l’amour l’aveugle. Au début du deuxième acte, Dubois déclare : « Il faut qu’elle nous épouse ». Il œuvre donc sans relâche en mêlant ses propres intérêts à ceux de Dorante, et Françon le rappelle à quantité de reprises en le laissant voir dans l’embrasure d’une porte, derrière une fenêtre ou passant devant une ouverture, quand il n’est pas à l’avant-scène en train de manœuvrer avec les uns et les autres, confident qui impulse les actions et suggère les sentiments plutôt qu’il ne recueille les secrets.
Avant même que la musique s’achève et laisse place aux premières répliques qui vont mettre en place l’intrigue débouchant sur l’union d’Araminte et Dorante, passe à l’arrière-plan de la scène une silhouette tout en noir : il s’agit de Gilles Privat, qui interprète le rôle-clé de Dubois, ancien domestique de Dorante désormais au service d’Araminte qui œuvre à leur union, contre deux autres projets de mariage. Dubois est le grand metteur en scène de cette pièce, convaincu que les vérités qu’il assène vont triompher. Il orchestre donc fausses confidences et rebondissements causés par un portrait ou une lettre, parfois sans même prévenir son ancien maître qu’il juge complètement dépourvu de bon sens tant l’amour l’aveugle. Au début du deuxième acte, Dubois déclare : « Il faut qu’elle nous épouse ». Il œuvre donc sans relâche en mêlant ses propres intérêts à ceux de Dorante, et Françon le rappelle à quantité de reprises en le laissant voir dans l’embrasure d’une porte, derrière une fenêtre ou passant devant une ouverture, quand il n’est pas à l’avant-scène en train de manœuvrer avec les uns et les autres, confident qui impulse les actions et suggère les sentiments plutôt qu’il ne recueille les secrets.
Le texte étant suivi à la lettre, le geste de mise en scène se situe ainsi dans ses marges et ses interstices : dans les interludes musicaux hybrides qui ponctuent les actes, dans l’omniprésence diabolique de Dubois, dans les lumières non mimétiques, souvent sombres alors qu’on voudrait tout observer de plus près. Mais encore dans le débit parfois rapide qui permet d’expédier la complication de l’intrigue non nécessaire à la compréhension, dans l’enchaînement tuilé des apartés et des répliques, dans le jeu de face qui diffère le moment de la confrontation et permet un jeu complice avec le public. Enfin et surtout, de manière plus spectaculaire, dans le jeu physique des acteurs et actrices, qui expriment l’agitation et les mouvements dont font part Araminte et Dorante, dans les décharges qui font sauter à plusieurs reprises la bienséance comme un ressort à force d’effondrement, rebond, chute ou enlacement furtif. Les corps tendus, contenus, relâchent pour quelques instants la pression que la raison leur impose et laissent entrevoir dans ces moments-là l’intensité des sentiments qui les animent.
 Dans le terrain de jeu ainsi créé, les rares accessoires amenés des coulisses constituent des appuis multiples pour les acteurs et actrices qui prennent à bras le corps le texte de Marivaux, sa mécanique parfaitement huilée et sa langue parfois sinueuse qu’ils s’approprient pour la rendre la plus fluide possible. Le tempo allegro adopté embarque, rend tout très limpide et laisse une belle place à l’émotion, tout particulièrement celle de Georgia Scalliet en Araminte et de Pierre-François Garel en Dorante, dont on embrasse la cause en complices de Dubois. Autour d’eux deux, les autres personnages sont campés avec précision : Yasmina Remil en Marton, Dominique Valadié en Madame Argante, Séraphin Rousseau en Lubin et Guillaume Lévêque en Monsieur Rémy.
Dans le terrain de jeu ainsi créé, les rares accessoires amenés des coulisses constituent des appuis multiples pour les acteurs et actrices qui prennent à bras le corps le texte de Marivaux, sa mécanique parfaitement huilée et sa langue parfois sinueuse qu’ils s’approprient pour la rendre la plus fluide possible. Le tempo allegro adopté embarque, rend tout très limpide et laisse une belle place à l’émotion, tout particulièrement celle de Georgia Scalliet en Araminte et de Pierre-François Garel en Dorante, dont on embrasse la cause en complices de Dubois. Autour d’eux deux, les autres personnages sont campés avec précision : Yasmina Remil en Marton, Dominique Valadié en Madame Argante, Séraphin Rousseau en Lubin et Guillaume Lévêque en Monsieur Rémy.
Chacun défend une certaine singularité – par sa voix, sa posture physique ou les préciosités de son rôle – , sans l’emporter sur les autres et sans verser dans la caricature. Alexandre Ruby en Comte n’est pas ridicule malgré son costume ni antipathique malgré son projet de mariage qui contrevient à celui que nous fait désirer Marivaux, et conserve à chaque instant une hauteur qui l’honore. L’ensemble crée un équilibre qui permet de prendre toute la mesure de la sensibilité extrême de Dorante, fébrile, fragile, submergé par les sentiments qu’il tente de dissimuler et dépourvu de toute vénalité, et d’accompagner la découverte progressive de son attirance pour lui par Araminte, saisissante Georgia Scalliet, mise à nu par sa robe blanche qui laisse entrevoir les moindres souffles et inflexions de son corps, qui rend attentif à ses gestes, ses expressions, ses regards – à la façon dont le texte qu’elle porte la traverse tout entière et la fait parler et vivre au-delà des mots.
 « L’amour fait naître l’amour-propre » écrit Françon dans sa note d’intention. Il donne ainsi le sens d’une émancipation au mariage de la veuve et de l’intendant. Si la décision d’Araminte est une conséquence des manigances de Dubois et des sentiments que cultive pour elle Dorante depuis qu’il l’a aperçue à la sortie de l’opéra, elle découle aussi du charme qui l’a frappée dès sa rencontre avec Dorante, de sa sensibilité qu’elle met à l’épreuve quand elle veut le contraindre à avouer son amour et de sa sincérité et sa probité quand il lui avoue les stratagèmes de Dubois. En déclarant sa préférence pour l’intendant plutôt que le Comte, Araminte démontre son indépendance face à l’autorité maternelle et à des considérations sociales qui l’indiffèrent. Ce prisme délicatement féministe achève de séduire et de convaincre de la justesse de cette mise en scène classical rock.
« L’amour fait naître l’amour-propre » écrit Françon dans sa note d’intention. Il donne ainsi le sens d’une émancipation au mariage de la veuve et de l’intendant. Si la décision d’Araminte est une conséquence des manigances de Dubois et des sentiments que cultive pour elle Dorante depuis qu’il l’a aperçue à la sortie de l’opéra, elle découle aussi du charme qui l’a frappée dès sa rencontre avec Dorante, de sa sensibilité qu’elle met à l’épreuve quand elle veut le contraindre à avouer son amour et de sa sincérité et sa probité quand il lui avoue les stratagèmes de Dubois. En déclarant sa préférence pour l’intendant plutôt que le Comte, Araminte démontre son indépendance face à l’autorité maternelle et à des considérations sociales qui l’indiffèrent. Ce prisme délicatement féministe achève de séduire et de convaincre de la justesse de cette mise en scène classical rock.
F.
Pour en savoir plus sur Les Fausses Confidences, rendez-vous sur le site du Théâtre Nanterre-Amandiers.